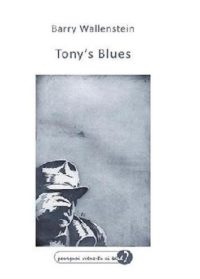Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond , Chambre avec vues précédé de Arguments pour un graveur (mythographies)
« notre impuissance et se trouver toujours coupable » (p.57)
Il y a cet effort, cette tension vers ce qui s’élabore. Un projet de gravures, des planches, des sujets, des noms, de grands noms mythiques convoqués, Orphée, Méduse, Minotaure, Antigone, Icare, Thésée, Oreste. Chacun de ces personnages en proie aux ténèbres, aux « courants noirs », à la « haute mer » au « labyrinthe », au « sang très noir ». Le langage technique de la gravure : « bercer la matrice », « pointe sèche », « taille-douce » « brunissoir » « manière noire » « presse » charrie des connotations multiples et très riches, le plus souvent sombres mais le « bon de commande » et le « programme » sont très clairs : « le moins possible. on évitera le sentiment (…) ». Pourtant, « pitié de Méduse », « soulagement d’Orphée », « sanglots de Minotaure » « Antigone (…) la bourreau de soi-même » (nous soulignons) ? C’est que les actes sont manqués. « Toujours recommencer », cette phrase revient souvent, complainte et devise. C’est que la mer déborde, le noir et les ténèbres engloutissent, la chambre chavire, le tragique de notre condition oblige.
La beauté de ce recueil double tient à cette tension extrême entre ce qui contient d’une part : les murs de la chambre, les marges de la page, la presse, et ce qui ouvre et peut dissoudre d’autre part.
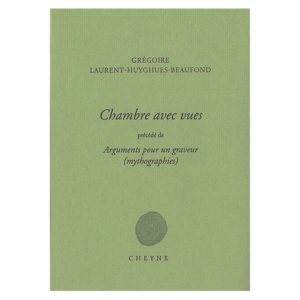
G. Laurent-Huyghues-Beaufond, Chambre avec vues précédé de Arguments pour un graveur (mythographies), CHEYNE.
La mer monte la nuit et submerge la chambre, on n’y peut rien, image de l’inconscient ou du « Réel » pour parler comme Lacan ? Cette marée qui dépasse l’estran n’est pas sans évoquer celle que décrit Yves Bonnefoy dans sa section « La maison natale » de son recueil Les Planches courbes. Quoi qu’il en soit, il y a d’un côté la précision d’un projet, l’exactitude et la technicité d’un geste d’artisan, qu’il soit graveur ou poète et, de l’autre, le désir de « dire cela et ne vouloir écrire que cela, ce qui n’a pas de nom, ne parle pas (…) » (p.39). Pas de sentiments explicites, en effet, mais l’approfondissement du tragique de notre condition dans ces contradictions irréductibles. Notre identité appelle ce qui la dissout. On ne déposera ni plainte ni main courante, on ne battra pas la mer, on approfondira « notre impuissance » (p.40).
Exigence à hauteur de souffrance et d’angoisse le ton du recueil est « grave » (le terme revient souvent dans la multiplicité de ses sens) et, dans sa deuxième partie, comme en écho et symétrique à la première, s’élabore une autre « mythographie », sans icone ni nom propre cette fois, en sourdine et de façon tout implicite, une parabole chrétienne, celle de St Christophe le passeur portant sur ses épaules et dans sa barque cet enfant trop lourd, qui est en même temps le Christ et le monde. Ce seul mythe discret mais bien lisible s’oppose ainsi à la pluralité affichée de ceux de la première partie, ces « prête-nom ». Le lecteur se trouve « embarqué » dans cette aventure qui dépasse. Mais j’en dis trop déjà, ce mythe n’est que suggéré et vaut non pas pour ce qu’il dessine ou représente mais par ce qu’il suggère et ce vers quoi il ouvre : peut-être les tragédies actuelles des migrants et de la mer mais, surtout, ce désir et cette crainte de la dissolution poussés ensemble à un point tel qu’il n’est, comme issue, que les très humbles « MORALES EN ATTENDANT » qui ferment le texte. Mais cette écriture en « acqua alta » de la section « MARINES », comme un flux et reflux, un ressac permanent, emporte par sa beauté.
Une hauteur de ton et de projet qui évoque le St-John Perse d’Amers et le Paul Valéry du Cimetière marin et un goût parfois pour une « asyntaxie » pouvant ouvrir sur la verbigération voire la glossolalie, que je me permettrais d’encourager.