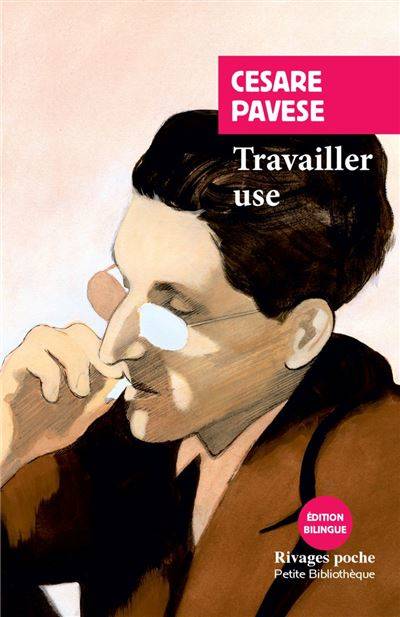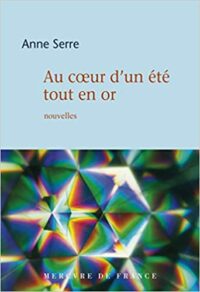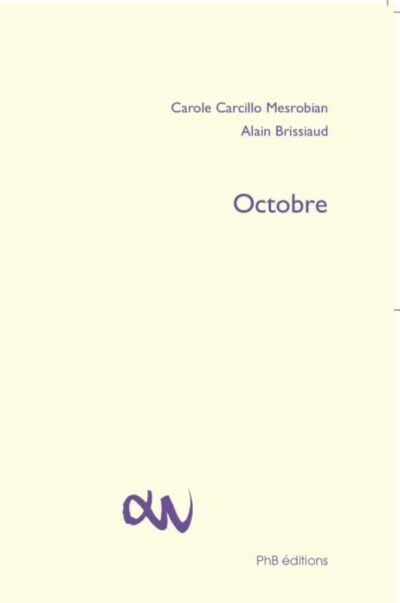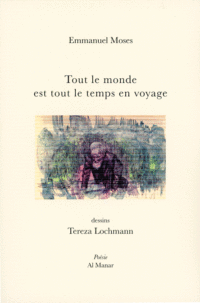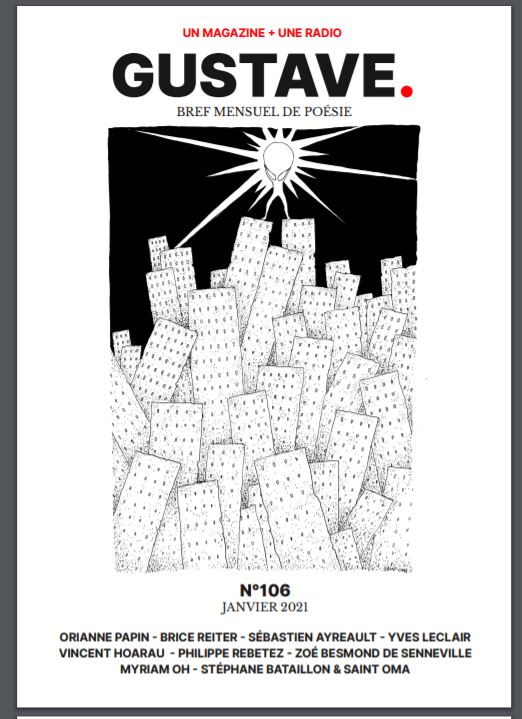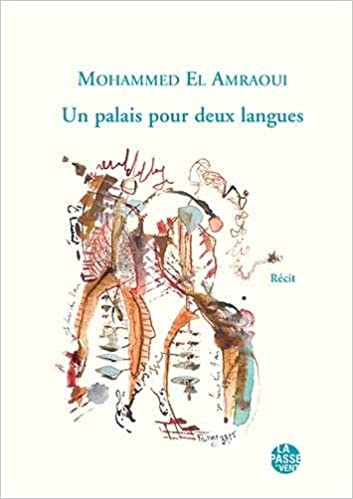Perrin Langda, poésie assistance 24h/24, Fabien Drouet, Je soussigné, attestations dérogatoires de sortie
Vers de nouvelles zones libres !
À l'heure où tout se trouve réduit, les éditions la Boucherie littéraire proposent, avec les recueils de Perrin Landga et de Fabien Drouet, de reconquérir de nouveaux territoires de poésie, comme une nécessité intérieure, déjouant les réseaux et les réalités virtuelles, pour mieux étendre les possibles aux sentiers ouverts et aux dérives arrogées, dont on arrache, au quotidien, l'autorisation administrative, pour mieux goûter un parfum qui ne saurait se respirer qu’à l’air libre !
Loin des fenêtres internautes qui sont aussi cages et menottes, loin de la surveillance obligée d’un pouvoir qui flirte avec l’autoritarisme, rongeant nos droits les plus élémentaires, sous couvert de sécurité et santé prioritaires, l’écriture de ces deux auteurs se cherche avec un humour affûté, se trouve dans l’évidence des mots, et en montre les interstices pour tracer de nouvelles zones d’émancipation…
Après avoir placé son ouvrage sous l’influence de l’auteur de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Perrin Langda déploie comme « un livre dont vous êtes le héros », entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, son « assistance en ligne », dont les chapitres égrainent les choix éventuels d’un clavier, simulacres d’options à moquer par le tranchant du regard déchiffrant la misère des impostures derrière la variabilité des touches : « pour des / sonnets mobiles / tapez 1 », « pour un / parlé-réalité / tapez 2 », « pour une / intelligibilité artificielle / tapez 3 », « pour des suites / incertaines radicalisées / tapez 4 », « pour des textes / aux logiques numériques / tapez 5 »…
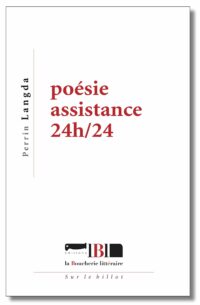
Perrin Langda, poésie assistance 24h/24, collection Sur le billot, la Boucherie littéraire, 14 euros.
Dénonciation sous un trait d’esprit de cette forme d’aliénation moderne dont nous serions tous plus ou moins les cobayes, le tyran que nous supportons désormais, reposerait pourtant encore, comme le suggérait déjà Etienne de La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire, sur notre volonté complice à désillusionner !
Ironie mordante, le poème éponyme de son livre, accompagné de la parenthèse un brin piquante : « (veuillez renouveler votre lecture ultérieurement) », renvoie l’exigence d’un salut personnel, d’un sens à la vie de chacun, à la vacuité des démarches sans retour, innombrables, absurdité et solitude de notre condition d’interconnectés : « ce poème vous sera facturé / 16 secondes de temps libre / pour toute question / sur le sens de votre vie / tapez 1 / pour un bref aperçu / de l’avenir de notre monde / tapez 2 / si vous souhaitez seulement / parler à un être humain / tapez… bip / nous sommes désolés / en raison du trop grand nombre d’usagers de la Terre / nous ne pouvons donner suite à votre demande »
Cette recherche d’une communication directe, simple, essentielle, dans l’évidence d’un rapport humain authentique, anime également le style des « attestations dérogatoires de sortie » de Fabien Drouet dont les multiples exemples de messages amusés ou poignants forment autant de requêtes à rejoindre des amis, des proches, tous ces visages des autres dont nous nous trouvons, là encore, coupés par le qui-vive d’un surplace, tout mouvement arrêté pour se résoudre à l’immobilité de la mort programmée de l’amour et du partage si nécessaires au genre humain ! Pourquoi renoncer au plaisir d’une belle balade d’un moment de convivialité, quand la dérogation espiègle suffirait en mot de passe ?
Alors derrière la variété malicieuse de telles attestations, aux motifs affichés et aux masques d’auteurs si divers, se révèle, dans un ultime dialogue entre le poète et sa grand-mère, la sagacité et l’autodérision mêlées, signes caractéristiques de nos deux plumes enclines à susciter un rire franc et réparateur, propice à la découverte de tels moments de joie libre :

Fabien Drouet, Je soussigné, attestations dérogatoires de sortie, collection Carné poétique, la Boucherie littéraire, 10 euros.
« - C’est quoi toutes ces attestations qui traînent dans l’appartement avec ces noms et ces bêtises écrits dessus ça me met un bazar dans la baraque c’est catastrophe mais je te dis ils me foutent un bazar » ; bazar des brouillons de nos existences à reprendre enfin leurs droits !