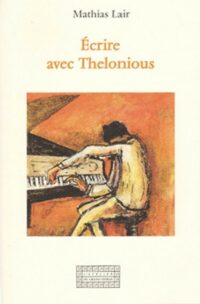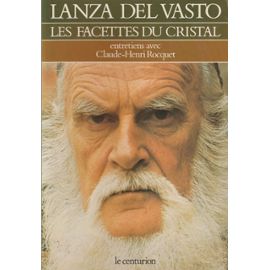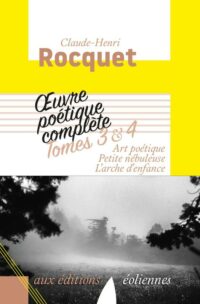Biagio Marin, Les Litanies de la Madone et autres poèmes spirituels
Une magnifique édition de près de trois cents poèmes de Biagio Marin nous est ici proposée en version bilingue (dialecte de Grado et français).
Les litanies de la Madone, ce sont quatre-vingt-seize poèmes écrits en 1937 (le poète a alors quarante-six ans) dont la première publication en Italie n’aura lieu que douze ans plus tard. Elles sont suivies de « poèmes spirituels » dont les derniers datent de 1982 soit peu de temps avant la mort du poète (1985). En outre, Laurent Feneyrou, le traducteur, nous fait cadeau d’une importante étude d’une centaine de pages avec photos d’époque pour accompagner cette œuvre qu’il qualifie d’« insulaire ».

Biagio Marin, Les Litanies de la Madone et autres poèmes spirituels, Traduction de Laurent Feneyrou, Éditions Conférence, collection Lettres d’Italie, 432 pages, 23 euros.
Un lieu cher au cœur du poète lequel s’exprime dans le dialecte de son île, preuve s’il en était besoin de l’attachement à sa terre natale marquée par le culte marial et les rites sacrés, terre de son enfance qu’il a choisie pour y finir sa vie. Grado, où souffle le vent et l’esprit, est présente tout au long du livre et dans le très beau poème intitulé Né au cœur (p.213) dans lequel il écrit : De Grado « je me suis nourri/ de Grado j’ai grandi […] au nuages seuls j’ai donné voix/et aux vents les plus tendus, / je leur ai donné le nom du village/ quand enfant, j’étais un Doge. »
Dans Les litanies, tout comme dans les Poèmes spirituels, l’auteur utilise des procédés stylistiques qui évoquent les formes liturgiques (répétitions). Outre la reprise de fragments de prières (Notre père) et de cantiques (Je crois en toi…), il donne pour titre à ses poèmes, dans Les litanies de la madone, les noms latins de l’invocation à la Vierge. Il commence à la dixième, celle qui porte de nom de sa mère : Maria, morte à l’âge de vingt-six ans. Quant aux Poèmes spirituels – est-ce un choix du traducteur ? – leur nombre, deux cents, n’est pas sans rappeler le rosaire (quatre chapelets de cinquante oraisons).
Entre célébration et prière, supplications et actions de grâces, images du passé et réalité du présent, le poète nous dévoile un mysticisme ancré dans le monde sensible, dans le cœur, dans la chair. Loin d’une statuaire éthérée et inaccessible, l’art de Biagio Marin nous dévoile une madone dans son corps terrestre, vivant, un corps protecteur et nourricier. D’incantations en incarnations, au cours d’invocations emplies d’humilité, de douceur et de passion, le poète « chante le mystère de la maternité et de la créativité par laquelle Dieu lui-même s’avère1 ».
Dans un temps hors du temps, on assiste à une quête mystique fondée sur un hommage émouvant à sa mère et, au-delà de sa mère, à toutes les mères du monde. Poète de l’amour, Marin sacralise la femme et instille une sensualité à fleur de mots. On pense à « l’âme charnelle2 » chez François Cheng ou encore à Christian Bobin quand il dit que : « la foi, ce n’est pas la récitation d’un dogme, c’est l’attention portée au vivant, c’est toucher, par moments, le plus brûlant de cette vie3 ». Marin, lui, écrit : « Je veux la brûlure que donne l’amour » …
Dans des poèmes embaumés de jasmins et de roses, dans un enchantement de sons et de danses, Marie « née d’une âme, de l’envol d’un être en prière », apparaît sous les traits d’une adolescente au regard bleu, aux boucles blondes, à la fois divine et profondément humaine. Marie, « adolescente aux grands yeux resplendissants », « lumière de l’âme », « épouse enfant », mère de tous qui console et pardonne « reine et amour des pécheurs et des saints », qui donne « à l’adultère même/ la chaste odeur de la virginité » !
Nombreux sont les vers de Marin qui témoignent d’un éloignement par rapport au catholicisme. Plus qu’un poète religieux, Marin est un troubadour mystique : « Je ne sais pas prier, je ne sais que chanter Dieu ». De l’église officielle il rejette les dogmes. Il écrit : « Je ne comprends pas qu’il y ait des prières… Les mots que je dis doivent être miens… Les mots d’autrui en rien ne comptent… ».
Il prie, ou plutôt chante avec ses mots à lui, ancrés dans sa propre vie dont il distille des fragments dans ses textes, en particulier dans les « Poèmes spirituels » : si sa mère en est la figure centrale, sa grand-mère, qui l’a élevé, est aussi présente dans ses souvenirs.
Il remercie Dieu pour ses dons, « Pour chaque bouche close/qui » à lui « s’est ouverte à l’aube », Dieu qu’il voit « dans les yeux des femmes enchanteresses » et ceux d’une fille de Grado, Dieu qu’il boit aux sources des montagnes, aux étoiles et dans le silence, la contemplation, la méditation, le rêve « Prière à Dieu n’est pas parole : c’est floraison silencieuse dans le ciel/l’ouverture au soleil d’une fleur de pommier/ et, au sommet d’un rosier, d’une rose seule. »
« In interiorie homine habitat veritas ». Fraternisant avec les idées de Saint Augustin, Marin sait que Dieu est partout et en chacun de nous : ainsi écrit-il « Notre père avant d’être aux cieux/tu te serres dans les cœurs… » Ses poèmes sont un long chant d’amour et de communion avec la nature et l’univers entier « Je te chante des psaumes/ en tout lieu/ matins calmes/soirs de feu. », « À l’église je te perds :/je te trouve en chemin/, dans chaque pensée/de mon obscurité », Dieu, au plus profond de l’homme mais aussi dans les eaux de la lagune, dans la mer, « flamme d’amour dans le désert », et l’on comprend que pour l’auteur, la création poétique et la foi sont intimement liées.
« Flamber un instant/brûler dans le vent/ la seule éternité » Le doute parfois l’assaille. L’éternité promise, « terrible, seule » est perçue comme l’anéantissement de l’individu : « Nous serons tous fondus/dans la grande unité/pour toujours, pour l’éternité/ sans plus de visages et muets. », et s’il parle de la mort comme de « l’Ombre sacrée », son évocation le remplit de tristesse et de nostalgie « elle était belle la lumière/là sur la terre, d’été… »
« Mourir : c’est perdre Dieu dans sa joie, / dans sa gloire pure de poète ». La mort et les fêtes votives traversent nombre de poèmes. Étrange coïncidence : Biagio Marin qui a chanté Noël « avec au cœur une épine qui fait plus mal qu’un clou » mourra un 24 décembre !
Ces textes d’ombre et de lumière rassemblés et commentés par Laurent Feneyrou révèlent toute la beauté de l’écriture d’un poète méconnu en France et qui ne peut nous laisser indifférents : Biagio Marin a écrit autant parce qu’il avait la foi que parce qu’il doutait. Seul, bien qu’habité par Dieu, il nous apparaît dans une dualité que peut-être seule la poésie permet d’unifier. Une dualité à laquelle fait écho celle de ce paysage que l’on croit immobile où « rien ne coule, et rien ne change » mais où tout est mouvement car tout passe, tout s’enfuit, emporté par le vent. Même Dieu… « Dieu même est perdu, mais reste une rime ».
Sortis de l’ombre, les mots de Marin deviennent alors des éclats d’éternité brillant dans une lumière toute vénitienne et à notre tour, nous sommes pénétrés d’enchantement.
Co me te baso, letta da Mimmo Pelini, une vidéo proposée par Domenico Pelini.
BIAGIO MARIN – poèmes extraits de Les litanies de la Madone et autres poèmes spirituels(traduits par Laurent Feneyrou)
Domus aurea (p.69)
Maison d’or des rêves enfantins,
flamboyante sur les nuages du couchant,
en gloire dans les cieux matutinaux,
couronnée d’étoiles aux firmaments.
Ma maison, pleine d’anges aux ailes
seulement faites de lumière silencieuse,
retentissant dans les flots d’un choral,
qui s’ouvrait au cœur d’une rose ;
je te vois encore au soir de ma vie
et je m’abandonne encore à ta paix,
et pleure le cœur de grande nostalgie
quand les passions se taisent.
Oh mère (p.143)
Oh mère, oh mère
après une vie entière
voilà que c’est le soir
tu regagnes mon cœur.
D’un aussi lointain
tu viens comme une aurore
avec mes boucles qui te dorent,
avec le silence du soleil.
Et moi, le cœur tremblant,
je regarde la merveille
qui en moi s’éveille,
s’ouvre comme une fleur.
De la sainteté (p.199)
De la sainteté
je ne sais que faire ;
je veux la brûlure
que donne l’amour ;
Je veux le tourment
que me donne le vent
de la passion
faite chanson ;
Je veux l’enfer
du feu éternel
qui me détruit
et crée la lumière.
Verbe, mon seul refuge (p.189)
Verbe, mon seul refuge,
mon intime demeure
loin de toute plage
au-delà de tout ciel de juillet.
Le chemin qui mène
dedans mon séjour
n’a ni asphalte ni pavé
ni ciel avec nuit et avec jour.
Sans répit coule
l’éternel avec les heures
et dedans ce ruisseau
parfois je vis.
La lumière m’a apporté le message (p.211)
La lumière m’a apporté le message
de l’autre monde, de Marie :
sans bruit, elle a fait le long voyage
au rythme d’une litanie.
Dans la modulation de l’air le visage
lentement a souri,
la bouche s’est ouverte sans un mot :
belle bouche violette,
proche-lointaine, elle est restée seule.
Je voulais, oui, l’appeler au sacrement :
j’ai tendu mes mains pour l’effleurer,
de lumière une aile
me l’a emportée avec le vent.
Notes
1. Edda Sera, Les litanies de la Madone, préface
2. Cinq méditations sur la mort Le livre de poche 2013 page 114
3. Interview France Culture « La poésie comme chemin spirituel ».