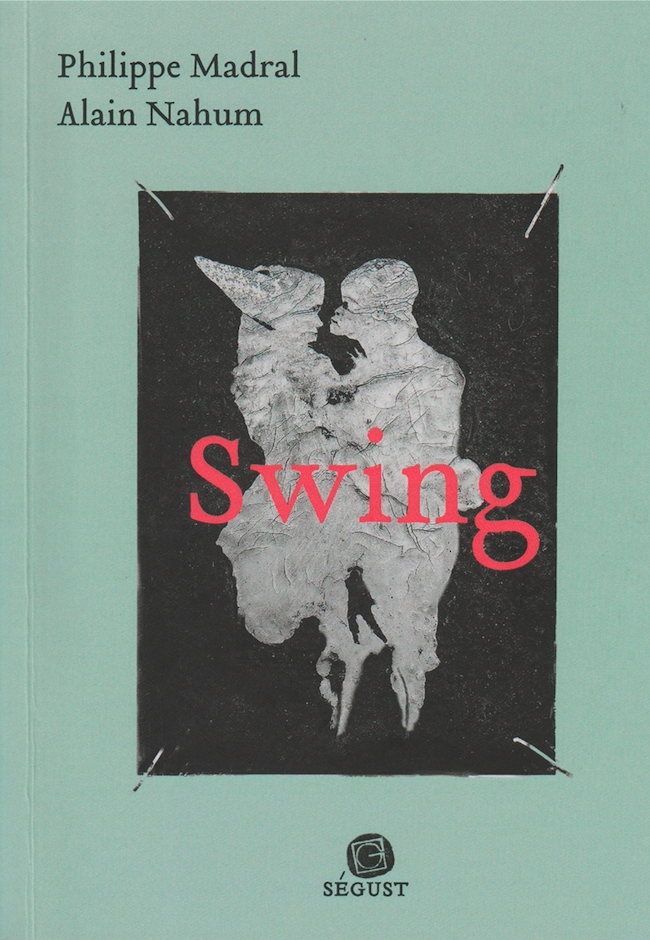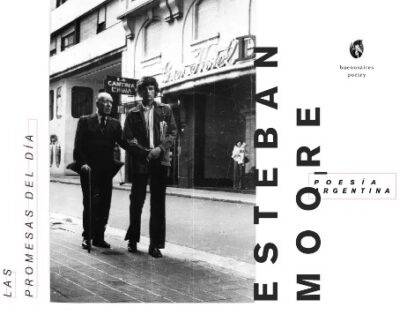Les promesses du jour
La ville se réveille sous les accords monotones
/d'une musique mécanique, moteurs et métal
en mouvement
Le soleil éclaire le firmament trouble – sa vaste palette de gris
les formations vaporeuses de combustible brûlé
l'air fétide, aigre, acide
est accompagné
par la fumée sombre des décharges à ciel ouvert en feu
/qui flotte létale au sud
La radio, entre des chanteurs latinos / rock banlieusard
et cumbia
des critiques travestis, histoires de sexe, secrets d'alcôve, drogue, crimes,
la vie intime des joueurs de football
les implants mammaires
des vedettes – les botineras[1] – les starlettes de service,
transmet les dernières nouvelles -arguments politiques-visions du monde
cuites en leur propre intérêt dans la cuisine
/ des « savoirs conventionnels » -q.v : J.K Galbraith-
conçues par les propriétaires des vies et des biens
qui tendent les fils qui guident leurs marionnettes parlantes
La ville se rend déjà à la solitude de la foule,
dans les rues -restes de nourriture
-bouteilles
-ordures
l'odeur pénétrante de l'urine, de la merde
/tellement humaines
Las promesas del día
La ciudad despierta a los monótonos acordes
/de una música mecánica, motores y metal
en movimiento
El sol ilumina el firmamento turbio -su dilatada paleta de grises
las vaporosas formaciones de combustible quemado
el aire fétido, agrio, ácido
se acompaña
del humo oscuro de los incendiados basurales a cielo abierto
/que flota letal desde el sur
La radio entre cantantes latinos / rock chabón
y cumbia
críticos travestidos, historias de sexo, secretos de alcoba, drogas, crímenes,
la vida íntima de los jugadores de fútbol
los implantes mamarios
de las vedettes -las botineras --las estrellitas de turno
transmite las últimas noticias -argumentos políticos–visiones del mundo
horneadas en beneficio propio en la cocina
/de los ‘saberes convencionales’ –q.v.:J.K. Galbraith-
concebidas por los propietarios de vidas y hacienda
quienes tensan los hilos que guían a sus marionetas parlantes
La ciudad ya se entrega a la soledad de la multitud,
en las calles -restos de comida
-botellas
-basura
el penetrante olor de la orina, de la mierda
/tan humanas
* * *
Perspectives
« ...une mer de verre mêlée de feu... »
Apocalypse 15,2
Tu pourras écouter ---pendant que le commandant entame
la descente annoncée
les mots du passager assis près du hublot
qui, tout en observant depuis les hauteurs les lumières de la ville
commente à haute voix
la ferme vocation européenne qui y habite
/il souligne son importance pour le monde
Il décrit avec profusion de détails
les particularités de certains endroits
/bâtiments et monuments qui la caractérisent
Il indique leur placement sur la plaine indéchiffrable
/semée de grappes serrées de lumière
Magique -verrerie électrisée -qui scintille dans la nuit noire
/au rythme d'allez savoir quelles musiques
dans cet océan d'ombres et de brumes qui amplifie
/la sombre profondeur de sa vacuité
La voix aux prétentions élevées
de cet interprète improvisé de ta ville
se mélange avec tes pensées et
….................................................tes souvenirs
La sienne n'est ni ne sera ta ville
celle qui s'étend incontrôlable -traînée par les désirs d'un grand nombre
dans les régions encore nues du pur espoir
Perspectivas
"…un mar de cristal mezclado con fuego…"
Apocalipsis 15.2
Podrás escuchar----al tiempo que el comandante inicia
la anunciada maniobra de descenso
las palabras del pasajero ubicado en la ventanilla
quien observando desde la altura las luces de la ciudad
comenta a viva voz
la decidida vocación europea que la habita
/destaca su relevancia para el mundo
Describe con abundancia de detalles
las particularidades de algunos de los lugares
/edificios y monumentos que la caracterizan
Señala su ubicación en la indescifrable llanura
/sembrada de apretados racimos de luz
Mágica -electrizada cristalería -que titila en la noche cerrada
/al compás de vayan a saber qué ritmos
en ese océano de sombras y brumas que magnifica
/la oscura profundidad de su vacío
La voz alta en pretensiones
de este improvisado intérprete de tu ciudad
se mezcla con tus pensamientos y
.................................................... recuerdos
La suya no es o será tu ciudad
esta que se expande incontrolable -arrastrada del anhelo de muchos
en las aún desnudas regiones de la pura esperanza
* * *
Notes sur un week-end dans la campagne
Nuit
La nuit noire
a sa lune blanche
pâle; froide.
Aube
Le ciel sombre
promet par sa couleur
l'eau et la grêle
Midi
Les fleurs blanches
qui tremblent sous le ciel
absorbent la lumière
Soir
Les coups de queue soudains du brouhaha font frémir la joncheraie
troublent les eaux tièdes et peu profondes de la lagune
on n'entendra plus l'âpre -rauque chant de la grenouille
les ramiers qui s'éloignent en battant leurs ailes avec désespoir
/annoncent la présence des rapaces
Notas de un fin de semana en el campo
Noche
La noche negra
tiene su luna blanca
pálida; fría
Amanecer
El cielo oscuro
promete de su color
aguas, granizo
Mediodia
Las flores blancas
temblando bajo el cielo
absorben la luz
Atardecer
Los repentinos coletazos de la tararira estremecen el juncal
enturbian las aguas bajas y tibias de la laguna
ya no se escuchará el áspero -bronco canto de la rana
las torcazas que se alejan batiendo sus alas con desesperación
/anuncian la presencia del ave rapaz