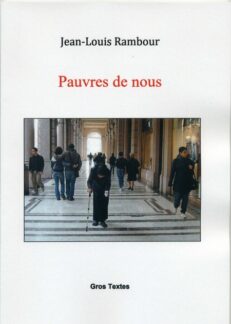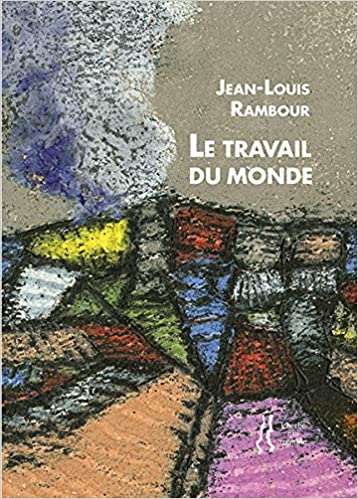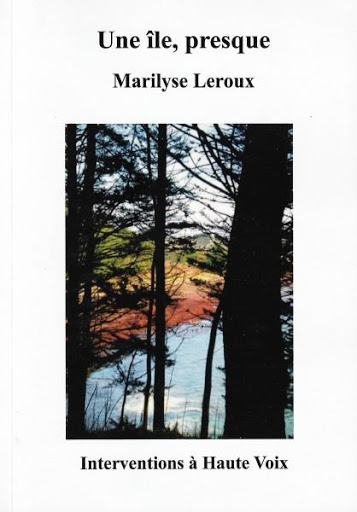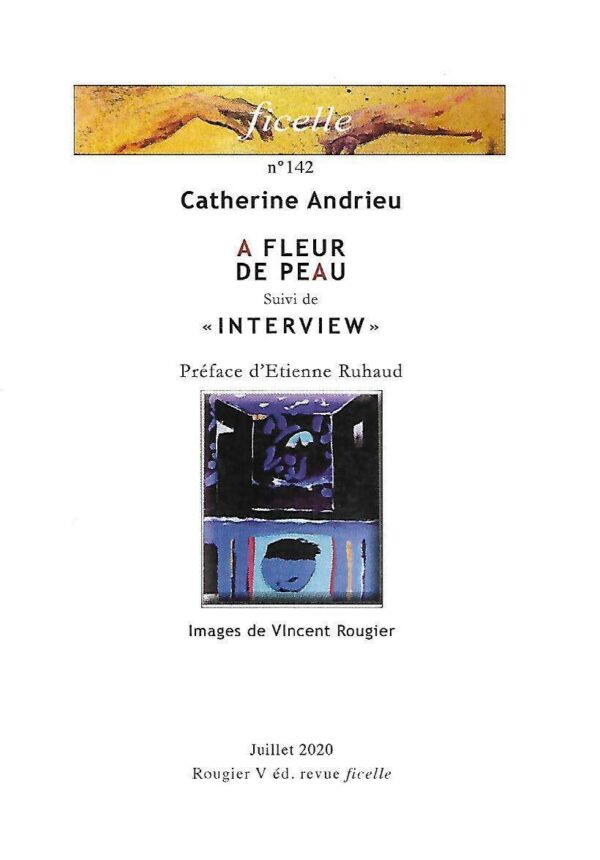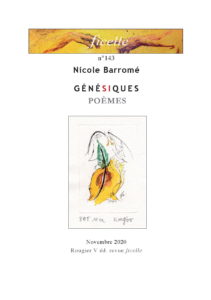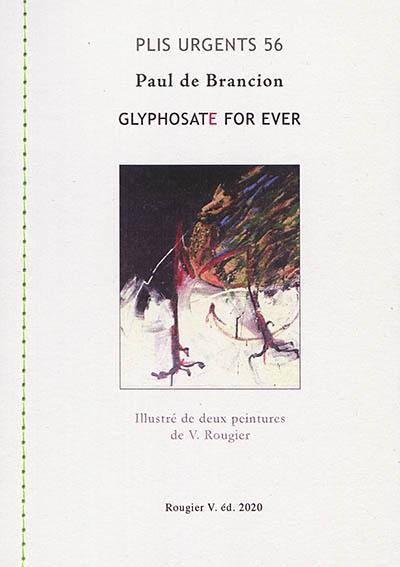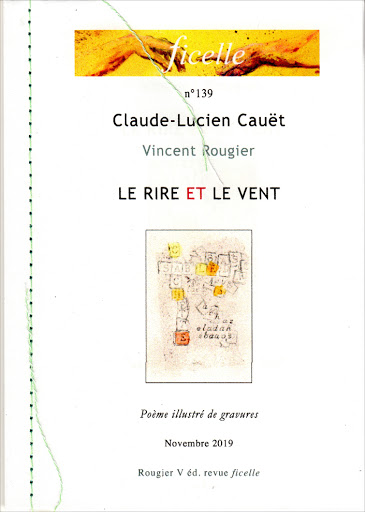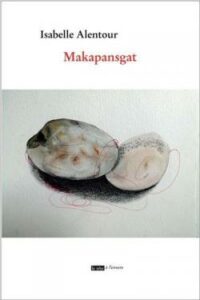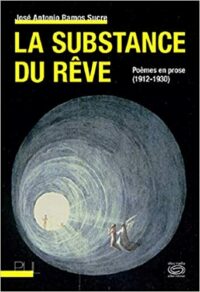Dans la collection Encres blanches : Gérard Le Goff, L’élégance de l’oubli, Vincent Puymoyen, Flaques océaniques
Gérard Le Goff, L'élégance de l'oubli
Ce voyage dans le temps commence en feuilletant un album de photographies, ou en retrouvant dans une boîte à biscuits en métal peint des images du passé. D'emblée, ces gestes quotidiens sont sublimés, puisqu'on adopte la candeur inquiète de l'orpailleur sur le point de séparer le sable de l'or.
Se dresse alors un portrait de famille, à travers des textes en prose et des poèmes qui parlent des parents et grands-parents de l'auteur. Les souvenirs se confondent parfois avec les rêves d'un enfant qui joue dans des paysages qui deviennent une jungle de haut sainfoin, d'où jaillissaient des constellations de papillons. Dans cette famille humble, le train miniature que le père, marin, ramène de New York devient un morceau d'Amérique. On retrouve aussi le plaisir des jeux d'un âge innocent, où l'on dresse face aux marées des barrages de sable, dans l'espoir de faire face au temps et à la réalité.
Une nostalgie douce enveloppe le récit, qui se termine quand l'auteur entre au lycée et sent que l'enfance venait de s'achever. Il voit alors comment le temps s'accélère, et assiste aux transformations de son environnement -immeubles construits, routes inutiles- pour affirmer : Ils se sont acharnés sur le moindre recoin de mes territoires de songes.
Le style tendre et lumineux de l'auteur reflète parfois l'histoire familiale à travers des objets hérités, comme une médaille de guerre, pour en garder une mémoire étonnée. Il ne s'agit surtout pas de réécrire le passé, mais de nous montrer où se trouve l'élégance de l'oubli à laquelle fait allusion le titre de l’œuvre, afin de mieux nous expliquer comment on façonne les souvenirs.
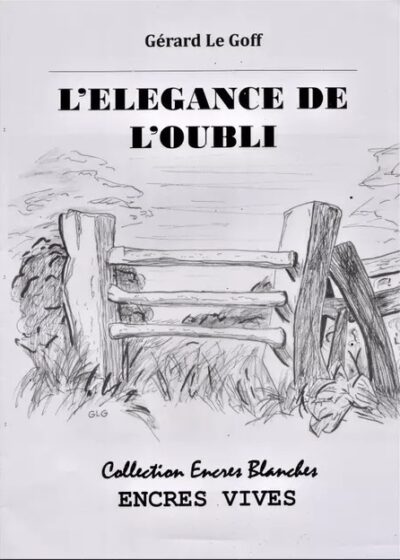
Gérard Le Goff, L'élégance de l'oubli, Encres Vives, Collection Encres Blanches n°802, novembre 2020.
∗∗∗∗
Vincent Puymoyen, Flaques océaniques
L'auteur nous propose vingt-trois poèmes ou textes en prose à travers lesquels s'établit un contact direct avec la nature. Il nous parle notamment des environs de Brest, où il habite : à l'est le lac saumâtre de l'origine / à l'ouest les confins qui rougeoient déjà. L'Auberlac'h, le phare du Minou, le moulin Blanc sont inondés d'eau et de lumière : c'est ainsi que Flaques océaniques cherche à dévoiler nos liens avec les éléments.
Toutefois il ne s'agit pas seulement d'exprimer ses sensations immédiates, mais d'évoquer aussi nos rapports avec le temps qui nous a construit. En ce sens, le regard inquiet et curieux de l'enfance (Métal conducteur de l'enfance / Argent du plateau lisse / Surface où s'étalent des pans de brume) demeure présent et semble être la colonne vertébrale de la pensée du poète.
Loin d'être un simple observateur, Vincent Puymoyen pose des questions existentielles et tisse jour et nuit pour attraper la note rare, et ne pas oublier que L'âme est le souffle chaud qui remplit la tuyauterie complexe du corps, alors tu deviens bouée, radeau ou steamer, selon ton goût de l'aventure. Sans oublier, tout de même, de prendre garde chaque fois de revenir au port.