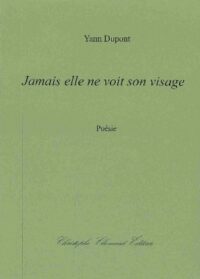Charles Baudelaire, banal contemporain
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère !
(« Au Lecteur »,
poème liminaire des Fleurs du Mal
On a tout dit, en 200 ans, des paradoxes du personnage, de la modernité de sa poésie...
On a tout dit, ou presque, puisque deux siècles après sa naissance, son œuvre suscite toujours les mêmes réactions d'empathie, d'admiration, ou de rejet. Il suffit d'un projet comme celui mené pour le Jeudi des Mots, porté à la connaissance de poètes internationaux, pour qu'affluent les lectures et les témoignages sur l'importance cardinale de Charles Baudelaire, pour la poésie mondiale, et pour l'intime expérience poétique de chacun.
Je recueille des vidéo-lectures et des projets d'illustration démontrant la modernité de l'oeuvre, et je reçois par exemple, à l'instant où j'écris ceci, ces mots de Nedeljko Terzić, écrivain de Serbie:
To read Baudelaire means to live a life called Poetry. My respect for the great Poet. His verses are wisdom, sorrow and admonition.

(c) Ange Pieraggi illustration pour Les Fleurs du Mal, pour jeudidesmots.com
Deux cents ans, et une présence toujours vive, entre les représentations du « poète maudit » (tel que me le présentèrent les auteurs du manuel Lagarde et Michard de ma jeunesse) et la récupération en tant que « grand classique » scolaire, dont on ne lit, au fond, que quelques textes parmi Les Fleurs du Mal, livre « scandaleux » qui fit son succès – et la seule raison de sa notoriété de son vivant. Même s'il était estimé dans le milieu littéraire et artistique (critique d'art, il fréquentait les artistes et les salons dont il rendait compte), le critique Sainte-Beuve, admiré par Baudelaire, et autorité qui faisait les réputations littéraires, ne le cite pas et ne s'intéresse à lui qu'au moment du procès, ainsi que l'écrit Marcel Proust dans son Contre Sainte-Beuve :
il n’a jamais répondu aux prières réitérées de Baudelaire de faire même un seul article sur lui. Le plus grand poète du XIXe siècle, et qui en plus était son ami, ne figure pas dans les Lundis où tant de comtes Daru, de d’Alton Shée et d’autres ont le leur. Du moins, il n’y figure qu’accessoirement.
Le grand public, quant à lui, ne connut que le dandy débauché, vedette qu'on dirait aujourd'hui « médiatique » du procès fait aux Fleurs du Mal, livre défiguré par la censure qui, en supprimant des pièces jugées outrageantes pour la morale, déséquilibra un ouvrage soigneusement construit, pour y faire résonner des échos, interroger les mots et les mythes. Et sa notoriété ne se développe pas avant le premier quart du XXème siècle, avec les surréalistes, adeptes de la beauté convulsive, qui admirent la noirceur et l'éclat surprenant de ses images.
Aujourd'hui, qui n'a pas entendu évoquer à propos du poète sa haine du progrès, ce « mal nécessaire » lié à la civilisation – son mépris de la presse, pour laquelle il écrit ses critiques de peinture en journaliste consciencieux et génial – sa méfiance envers les nouvelles technologies, dont la photo, considérée comme ennemie de la peinture et de l'imagination, grâce à laquelle pourtant nous possédons nombre de portraits de lui, témoignant à tout le moins d'une fascination qui n'est pas sans évoquer, avec un peu d'anachronisme, la passion des selfies qui dévore nos contemporains...

(c) Jacques Cauda proposition de couverture pour Les Fleurs du Mal, pour jeudidesmots.com
Qui ne s'est pas interrogé sur son antipathie pour la ville, pourtant décrite avec une acuité visionnaire, une empathie extrême pour les plus misérables de ses habitants (ce qui amena Charles Péguy à voir en lui un grand poète chrétien, tandis que Walter Benjamin en saluait le marxisme – l'un des nombreux paradoxes de la réception de son œuvre). On pourra aussi parler de sa haine du bourgeois, membre d'une classe au pouvoir à laquelle le rattachent ses origines (fils d'un prêtre défroqué devenu fonctionnaire et d'une fille de militaire, remariée au général Aupick, beau-père autoritaire et détesté) – il appartient à cette bourgeoisie conspuée pour son immoralité et son hypocrisie, qui le pousse à se revendiquer des mouvements contemporains de jeunes révoltés comme lui, fièrement arborant le nom de « satanistes » - et à crier sa haine pour Aupick du haut des barricades de 1848...
Ce dandy pétri de contradictions (jusqu'à sa situation financière, le poussant, sous tutelle pour préserver son patrimoine, à vivre dans l'indigence) a vécu une époque charnière : né pendant les années troubles qui suivent 1815 – terme de la période « postrévolutionnaire », la destitution et l'exil de Napoléon, la seconde restauration, la succession de trois rois en quelques années qui virent se succéder Louis XVIII, Charles X puis Louis-Philippe, « porté » par la révolution de 1820, et sa « monarchie de juillet » qui sombre avec cette révolution de 1848 à laquelle Baudelaire participa... même si sa conscience politique ne sembla pas durer davantage que cette seconde république, écrasée à peine après par l'instauration du second Empire, et le développement du capitalisme, de l'industrie, du commerce, des transports, la radicale transformation des villes et des modes de vie...
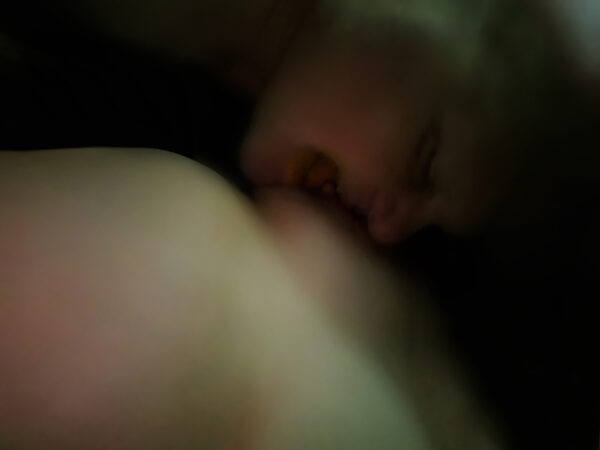
(c) Christine Ellessebée, "Métamorphose du vampire", pour jeudidesmots.com
J'ai tendance à le considérer en quelque sorte, comme un « dernier des Mohicans » : l'un des derniers romantiques, post révolutionnaires, sentimental plus qu'engagé, affecté d'un romantisme noir et désespéré, qui le fait frère des contemporains artistes « maudits » de ma jeunesse - un David Bowie, un Lou Reed du Velvet Underground... J'imagine qu'aujourd'hui, ce dandy écrirait un rock gothique bien gore et s'amuserait de la pruderie renaissante dans notre époque trouble de profonds changements, où la plus grande licence côtoie les anathèmes moraux, et les envolées technologiques permettent et suscitent les « retours à la terre »...
C'est d'abord en cela, selon moi, que Baudelaire – l'homme Baudelaire - est encore vivant à notre époque : son attitude, face aux changements, à bien des égards croise celle des générations actuelles – tellement urbaines, et empêtrées dans ces réseaux numériques dont elles ne peuvent se passer, mais aspirant à un état de simplicité et nature rénové, face aux dégradations que lui a imposée la folle course en avant du « progrès » - Qui ne rêve aujourd'hui d'une « nature temple » au sein de laquelle recréer un monde antérieur et protecteur ? Qui n'est pas nostalgique d'époques rêvées plus douces, de ces « là-bas » où « vivre ensemble », loin de la société individualiste, fragmentée qui est la nôtre – davantage encore en cette période de pandémie, contraignant à des mesures d'hygiène sociale rompant encore un peu plus les liens déjà fragilisés entre les individus ?
Mais Baudelaire est aussi notre contemporain en tant que poète . On le considère - justement - comme le père de la modernité, par son choix de thèmes triviaux – la charogne, la misère, la prostitution – et par sa recherche stylistique, privilégiant au fil des ans la prose non rythmée et non rimée à la versification traditionnelle. (même s'il n'est pas le créateur de cette forme, qui a été utilisée par Aloysus Bertrand, dont le livre Gaspard de la Nuit (1835) influença lepoète qui en fit un usage conceptuel).

(c) Jaume Saïs, illustration pour Les Fleurs du Mal, pour jeudidesmots.com

(c) Lino Canizzaro, "A une passante" pour jeudidesmots.com
Avec lui, c'est la forme mouvante adaptée à la modernité, sa permanente capacité de changements, l'incertitude, la croissance constante (je ne peux m'empêcher de penser à un titre du poète belge (1855-1916) Emile Verhaeren – Les Villes tentaculaires - en parlant de la recherche de Baudelaire d'une forme d'expression «tentaculaire» de la modernité). Cette recherche d'une forme le rapproche et l'éloigne de ses contemporains du Parnasse, adeptes de la « Beauté » immobile «comme un rêve de pierre », qu'il cherche plutôt à retrouver dans le fugace, le singulier – à l'origine même de la sensation, même la plus banale. C'est peut-être un poème comme « A une passante » qui donne la clé de cette esthétique, nourrie de classicisme « revisité » par la modernité du mouvement, cette silhouette fugace d'une « fugitive beauté », « avec sa jambe de statue (…) »
S'il dénonce ailleurs en effet la banalité en peinture, ce n'est pas tant le thème que son emploi systématique, comme des « poncifs », qu'il réprouve. On n'échappe pas au banal, qui correspond à ce qu'on mémorise, au familier qui ne surprend plus parce qu'il se répète – et qui est bien utile au peintre qui doit avoir un regard vif pour saisir une scène, la noter en quelques traits, avec un sens de la « notation » qui n'est pas sans rappeler la vitesse de la sténographie, développée à cette époque). Le poncif, lui, est cette méthode de reproduction par report de charbon à travers un calque pointillé de trous permettant de multiplier un dessin – dont la reproduction mécanique produit des œuvres dégradées, sosies grossiers de l'image princeps - d'où l'emploi du mot technique pour désigner en littérature aussi les stéréotypes, banalités et clichés.

(c) Hans Geiger, illustration pour Les Fleurs du Mal, pour jeudidesmots.com
Ce calque initial évoque bien ce que Baudelaire reproche à une certaine pratique picturale, et ce qu'il attend de l'art : non pas un calque de la réalité, formaté par l'usage, mais sa saisie au vif du réel, du « banal » vrai, dirais-je – de ce qui se présente à nous dans la nudité, la simplicité sans attrait du quotidien - l'élément que la mémoire de l'artiste va transcender, transformer en œuvre.
Le banal baudelairien se nourrit de la surprise recréée pour le lecteur par la perspective proposée, qui renouvelle ou permet la rencontre avec une réalité souvent ignorée par trop de présence. Bousculant le réel, la langue poétique et sa réception, il fait que tout poète aujourd'hui lui est redevable, qu'il le sache ou non, de cet affranchissement des formes et des lieux communs de la poésie. Des surréalistes, aux poètes «accros» de la prose que sont Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet, ou Francis Ponge et ses «proèmes» du XXe siècle, jusqu'au vaste champ de ce nouveau siècle, aux mille ramifications pour l'écriture et la poésie.
Ce bicentenaire de sa naissance est une belle occasion aussi de rendre hommage au Baudelaire traducteur auquel nous devons les magnifiques versions des œuvres d'Edgar Poe, duquel il se sentait si proche qu'il en avait « absorbé » la substance, les intégrant son œuvre par sa présence indiscutable. Sans compter des traductions de Henry Longfellow et Thomas de Quincey, Il publiera, sur une quinzaine d'années, une magistrale version française des trois volumes de contes, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, et l'essai Euréka de l'américain dont il écrivait, dans une lettre à Théophile Thoré de 1864 :

(c) Alma Saporito, collage pour Les Fleurs du Mal, pour jeudidesmots.com
La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi, et écrites par lui vingt ans auparavant.
C'est vers Jean-Michel Maulpoix (dans un article de 1999 " La poésie française depuis 1950") que je me tournerai pour souligner cette filiation dans l'échec aussi des poètes français depuis Baudelaire, devenu aphasique, « Mallarmé que son art même étrangle » :
La poésie moderne n'a cessé de s'initier ; depuis 1850 au moins, à la conscience de sa propre impossibilité(...) Elle est cet espace d'écriture inquiète, perplexe et chercheuse (Philippe Beck reprend volontiers à Baudelaire le mot de « chercherie ») où l'homme se met le plus directement aux prises avec son propre langage. Le lieu de l'invention et de la conscience tout à la fois.
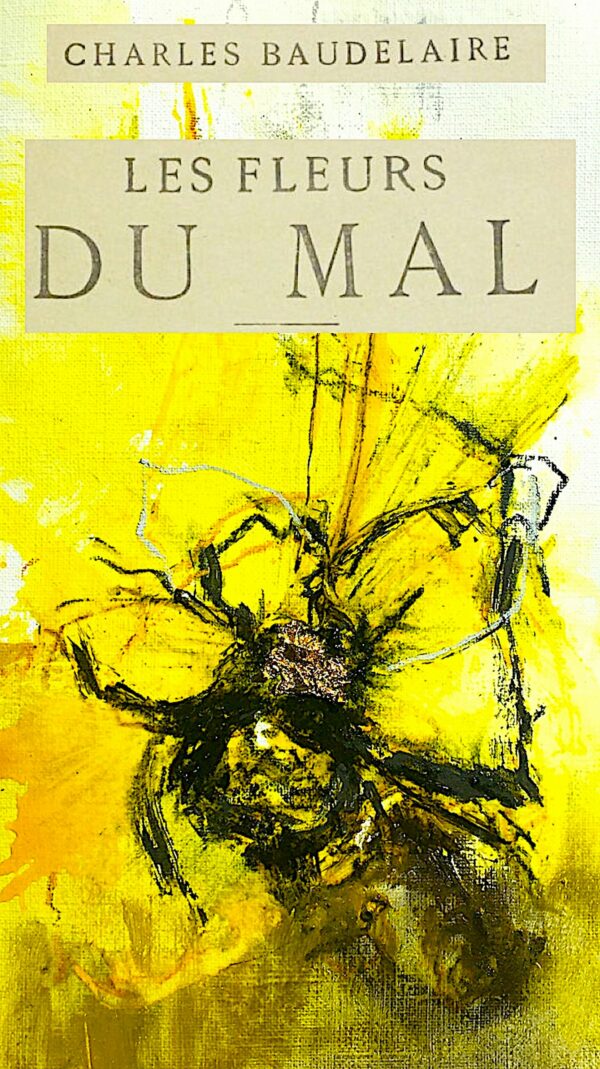
(c) Sophie Brassart, projet de couverture pour Les Fleurs du Mal, pour jeudidesmots.com
La traduction – la translation – sont au cœur de l'activité poétique contemporaine - ainsi que nous avions tenté de le démontrer dans le dossier sur la traduction du numéro 207 de Recours au Poème.
C'est vrai en particulier à notre époque de "globalisation" où se multiplient les échanges d'une façon exponentielle - et la crise de la pandémie a accéléré ce phénomène de communication, contraignant chacun d'entre nous à explorer d'autres modes de rencontres, rendus possibles par les technologies informatiques, qui offrent via nos écrans la présence virtuelle de poètes du bout du monde accueillis dans l'intimité de nos demeures. C'est vrai parce que nous sommes héritiers de la littérature du monde entier, dans l'épaisseur du temps et dans l'étendue de l'espace - et que nous abordons un futur qui s'annonce tout à fait différent de ce que nous connûmes.
Tout comme elle le fut pour l'oeuvre et la vie de Baudelaire - ainsi qu'on le comprend en lisant le poème « Correspondances », ou ses articles sur la peinture démontrant que tout art est traduction du réel, par le biais du « dictionnaire » personnel de l'artiste, qui sublime ce qu'il voit ou qu'il touche ainsi la traduction qui est à la fois rapt et don, mais aussi outil d'exploration de nous-mêmes et du monde - cet acte nous est consubstanciel: nous traduisons, adaptons, interprétons sans cesse... En témoignent les nombreux poètes du monde entier qui ont répondu à des initiatives organisées pour le 9 avril, date de sa naissance, et plus largement au cours de ce mois, par le biais des Jeudis des Mots, l'initiative soutenue par Recours au Poème, et qui recueille des vidéo-lectures de poètes, disant Baudelaire dans leur langue maternelle, ainsi que des propositions neuves d'illustrations pour Les Fleurs du Mal dont certaines illustrent cet article((l'ensemble des contributions, vidéo-lectures, illustrations et propositions de couverture, seront regroupées dans une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de Jeudi des Mots.))