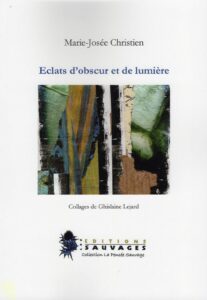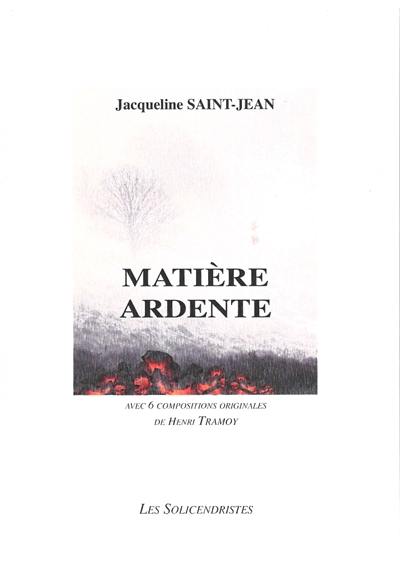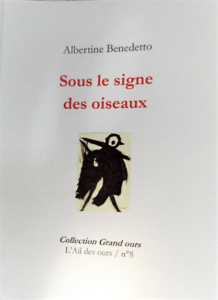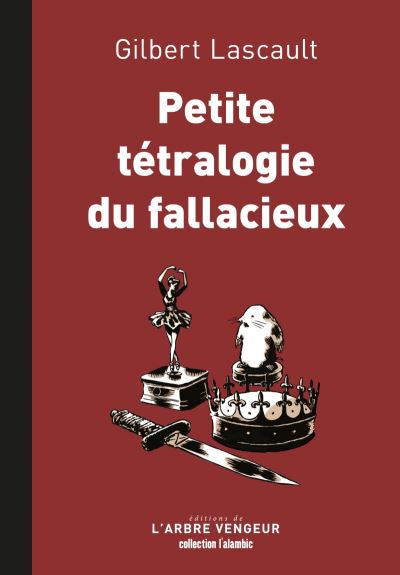Gérard Pfister, Hautes Huttes
1000 poèmes en 10 sections de 100 poèmes. Des « centuries » de 4 vers, en deux distiques, à chaque fois. Dans ce livre impressionnant par sa densité philosophique et poétique, par sa force vitale et spirituelle, les poèmes de Gérard Pfister s’enchaînent, se poursuivent, se reprennent et se prolongent comme sur une partition de musique sérielle.
Ces poèmes ouvrent nos sens, l’ouïe d’abord, l’œil, le toucher, le goût, tout au long d’une séquence d’images (ou de récits gigognes) dont Gérard Pfister nous donne la source à la fin de son recueil dans « Résonances » (pp.373-374), auquel le lecteur peut ou non se référer.
Sur la couverture, le titre Hautes Huttes est à lui seul déjà tout un programme musical et pictural : ainsi les deux H, comme deux échelles de traits ancrés dans la typographie qui, suivies du son O et du son U et des trois t, scandent ce titre, en font tambouriner l’écho et la hauteur de ton, gagnée aussi de « Haute lutte ». Nous apprendrons à la fin du recueil qu’il s’agit d’un lieu situé à Orbey, dans les Hautes-Vosges Alsaciennes et que cette musique que nous entendons à l’approche du livre est une musique de clarines (101-118). Nous voici donc dans la montagne à écouter ces notes verticales et fragiles qui « font résonner le silence » (Mahler a eu un temps une maison – et sa première cabane (ou hutte) de composition – sur les bords de l'Attersee. Ce sont ses longues randonnées dans les montagnes peintes par l'autre Gustav qui lui ont inspiré ses premières symphonies.)
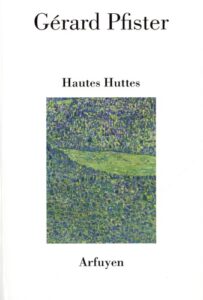
Gérard Pfister : Hautes Huttes,
éditions Arfuyen, 2021, 385 p., 19.50€
Le détail du tableau choisi par Gérard Pfister pour la couverture est lui-même composé d’une mosaïque de touches verticales, vertes, jaunes, bleues, traversées par une forme horizontale qui évoque une feuille d’arbre mais qui est, en fait, une prairie entre deux collines. Le Litzlberg am Attersee1 peint en 1915 représente un pan de montagne au bord d'un lac autrichien. Cette toile fait partie de l'ultime période de Gustav Klimt (1862-1918). Le bas du tableau, avec ses maisons et les bords de lac, a été supprimé par le recadrage. L’image ainsi resserrée fait le choix d’une approche à la fois abstraite et pointilliste qui donne tout son sens à la construction du livre de Gérard Pfister. Le tableau devient tissu végétal, paysage de montagne, peinture all-over, bruissement du monde, champ de ponctuations évocatrices des centuries pouvant se poursuivre à l’infini, mais ici calculées pour donner un cadre à l’illimité.
*
I - L’auteur s’interroge sur le sens de l’écriture, sur la quête qu’il mène avec elle, par la main qui écrit, par l’écoute, par le regard qui contemple, et toute son écriture semble tendue vers une sorte d’ailleurs, ouvert et secret qu’il ne peut nommer. Il se laisse porter par un flux (qui est aussi un creusement) dont les mots sont les jalons provisoires et il les pose dans la page avec un souci de justesse et de mouvement continu. S’il se sent assailli par le temps qui fuit, il le rythme et l’écoute, l’interroge, entre dans sa vibration, respire avec lui et entraîne le lecteur à sa suite. Ici pas d’autre ponctuation que le décompte jusqu’à 1000 des poèmes de 4 vers, disposés en deux distiques, ce qui aère et allège la lecture, l’épure, nous emporte comme sur les rails d’un train. À chacun son voyage, mais ne cherchons pas à retourner sur les traces d’Orphée car « Le dieu des mots / est un être cruel // qui n’admet pas / que nos voix rêvent ».
Dans le remuement de sa vie intérieure, l’auteur suit une pente de dénuement, à la recherche d’un sens originel, peut-être l’éclat d’un premier jour. Mais comme dans un rêve, l’auteur est saisi par des ombres et se tient en équilibre dans un récit qui de page en page va vers la lumière, puis il se retourne, retisse autrement ses pensées quand tout à coup … il voit passer un chevreuil ! léger, fluide, irréel, sorte de messager - mais n’est-ce pas l’écriture elle-même ce chevreuil ? N’est-il pas ce « poème / sans mots // plus vrai / que toute peine » ? Le lecteur entre à ce moment précis dans un autre espace, à la croisée des mots, des images, dans le frôlement fugace de la réalité, qui, si concrète et charnelle qu’elle soit, paraît illusion, féérie « éblouissante / d’absence ».
Cette nudité qui caractérise le recueil de Gérard Pfister, cette décantation qui ne se présente jamais comme une ascèse mais comme un mouvement pacifique, nous déploie et nous accueille dans son rayonnement profond. Rien ne semble séparer la réalité du rêve, le poème de la prière, ou le murmure d’une voix plus ferme, le doute d’une confiance. Chaque poème part à sa propre recherche, se creuse et se prolonge entre présence et absence sans atteindre le fond pur de la conscience. Questions et réponses sont transitoires. Mais peut-on encore appeler poème ces méditations qui sont chant, même dans la peine ou la révolte ? L’auteur recherche les mots de l’enfance qui peuvent l’éclairer, lui redonner joie et grâce - un présent. Aussi nous ne comprenons pas le choc soudain avec la mort ni comment nous « aimons si mal la vie ». Est-ce un jeu ? Et comment supportons-nous « malgré-nous / d’en être les témoins » ?
On croirait que la vie / n’est pas digne de nous.
II. Les sons vivants nés du poème, même « abandonnés », même « désaccordés » se répondent. Ils inventent un temps sonore pour l’espace où « nulle présence », « nulle absence », ne viennent troubler la libre « plénitude » du vide. C’est là que « les timbres varient », à toutes hauteurs et, dans ce jeu musical qui scande les durées, leur musique résonne contre les intervalles de silence, et se répand de page en page, rebondit sur le ciel, dans l’air et les lieux de notre écoute.
C’est un vertige de suivre chaque proposition, ces quatre vers libres et chiffrés, d’entrer dans la marche de la lecture sans s’arrêter, reprendre souffle sur un vers puis se sentir emporté, relancé sur le suivant, qui est sa suite et un pas de côté, un autre temps de la pensée et du regard, d’autres images, des présences animales qui croisent des questions sur le désir, sur nos souvenirs, sur ce que nous avons fait de notre vie, ce qu’il en reste – qui n’est peut-être plus « que la pure joie / d’exister » (186).
Poème et méditation sur l’existence nous interrogent sur la manière dont nous ressentons « l’unité souveraine / du sensible », comme pour un peintre ou un musicien. Et c’est un défi pour le lecteur d’entrer dans cette façon d’avancer le dé du poème sans dévoiler le sens profond qui fait lien entre toutes ces étapes, ces visions. Il nous faut retisser les images, tordre le cou au sens premier pour atteindre cette musique qui libère, sans déchiffrer les signes du hasard ̶ mais en consentant à nous juger, s’il le faut, puisque « Nous l’avons troqué / le pur diamant // contre quelle / pacotille » (199), puisque cette joie, « nous l’avons bradée » (200). Ce livre serait-il un livre de sagesse taoïste ? L’écriture ne va pas sans une éthique rendue publique. Mais l’écriture ici sait aussi combien, malgré les chiffres auxquels elle se raccroche, elle est sans prise ni mesures.
III. Dans ce jeu trouble du mystère avec l’étrangeté, de l’ignorance avec la terreur, comment vivons-nous, si c’est cela vivre ? « Tant nous chérissons / nos manières domestiques // nous avons cru / que c’est aimer la vie » (210). Chaque jour est unique, en sa lumière, mais « comment avons-nous / cessé de vivre // par quel précoce ennui » ? (216).
Pourtant « être encore là » est pour le poète « un privilège », face à l’inéluctable, face à l’inconcevable (245). L’auteur nous tutoie tout à coup et nous n’avons plus qu’ « une urne vide / pour tout corps ». Ainsi l’homme serait toujours le grand absent, à commencer de lui-même.
L’oubli, la cruauté, la bestialité, « qu’est-il arrivé / à cette vie // qu’on ne sache plus / l’aimer » ? (Ici j’ajoute un point d’interrogation, mais l’auteur ne l’inscrit jamais dans ce recueil, c’est le lecteur qui donnera voix à la question. Ici tout reste ouvert, aucun signe de ponctuation ne vient rompre le déroulé rigoureux des mille poèmes – le tissu sans couture de la voix humaine. L’indicible est le premier chiffre et le dernier de cette somme.)
IV. Le chant est source de plaisir, le chagrin chanté peut l’être aussi ; la plainte a son chant, son timbre de violoncelle. C’est le paradoxe de la voix, sa douceur, qui peut aller jusqu’aux larmes : « Chaque parole / dit l’adieu // sans cesse la voix / est naissance » (315) ̶̶ paradoxe de la nuit où surgit la lumière - paradoxe d’être « Si près / de n’être rien » (321). Joie et plainte ne cessent d’apparaître et disparaître « Sont-ils joie sont-ils / plainte les mots » (325) ? et « Quelle taie couvre / nos yeux // quelle poussière / notre corps », puis la couleur, l’homme « travaillant à se perdre » (357), mais comment commencer à vivre à chaque instant accompli ? (376)
V. Les cavaliers de Marino Marini traversent quelques poèmes, le cheval montre ses dents, le garçon « le sexe érigé / droit vers la ville » (406), est tout en tension dans l’espace, nous sommes pour un temps à Venise et recevons cette évocation rayonnante de L’ange de la cité « comme un soleil » (409) souriant et tout s’éclaire, le cœur s’apaise. Mais nous sommes petit à petit réimmergés dans le flux du monde, là où la mort peut venir, quand « tu vois / et tu ne vois rien « (467), « Tu écris / tu n’écris rien » (468). Il faudrait « laisser résonner / la semence des choses » (490) ou encore tels l’enfant qui cherche le lait maternel, se souvenir que « Notre bouche / pressée contre la chair // du monde / reste assoiffée » (499).
VI. Qui pourrait réparer blessures et abandons ? Pourquoi cette répétition du mépris de la vie ? Comment vivre ? Où trouver « ce terme / où tout peut commencer » (517) ? « Comme si vivre : était impossible // et mourir seul / nous sauvait de la mort » (519). Et regardant Méduse peinte par Caravage, ses cheveux « des vipères qui se tordent » (531), son regard qui pétrifie, l’auteur nous convie à apprendre à regarder le monde dans cet autre miroir que le peintre nous présente mais « est-il le seul / voyant » (564) ? Les couleurs de la chair, celle de cet homme torturé, acéphale, peint par Francis Bacon, nous posent cette question : « Jamais l’art / peut-il s’accomplir // que dans l’inguérissable / fragilité de la matière » ? L’inguérissable aussi dans le poème.
VII. A propos d’un autre tableau La peste sur la place du Mercatello, peinture de Micco Spadaro (Museo di san Martino, Naples), l’auteur nous en décrit succinctement les civières et cadavres, le bûcher et sa fumée, sous le ciel « d’un beau jour d’été » (607), puis il poursuit son chemin de vie, songe aux « Pauvres huttes / hantées par nos morts » (609) et goûte un peu de vin, précisant qu’il s’agit du sancerre et du falerne » (615) et cette précision est bonne à entendre, dans ce temps où l’on se demande si nous ne sommes pas nous-même des « pulsations d’ombres » (654) ̶ pourtant « Nos traits / enfin sauvés du temps // à jamais immobiles / dans la lave durcie » (672) ̶ cette évocation de Pompéi revient à plusieurs moments dans ce livre comme une injonction à vivre.
VIII. Depuis le chœur grégorien de la cathédrale de Strasbourg, « le temps devenu chant » (716), le présent est donné sans attente, il est une chance, remise « entre les mains du hasard » (730).
Tout ne vit / que de mourir //ce qui demeure / a-t-il jamais vécu (742)
Léonard de Vinci peint le sourire de Mona Lisa mais avec « cette beauté poignante / qu’au bord de la quitter » (754). Images, souvenirs, peintures, portent tous en eux une étrangeté d’apparence. Il est bon d’en revenir aux choses simples, à la « pure joie d’exister » (793). Odeurs, couleurs, épices, le goût des choses de l’enfance, comme par exemple « les poches pleines / de calots et de billes » (796).
IX. La toile du peintre, le miroir, le reflet, « L’image seule / est véridique » (811), mais où allons-nous si tout devient indistinct si, « sans fin la brume / ne s’ouvre // que sur la brume / nous n’allons nulle part » (819). Nous ne serions personne, sinon « tatoués / du honteux matricule » (840). Et pourtant le chant comme une consolation « S’il pouvait / nous être un baume // tant de fois les mots / nous ont blessés « (854).
Et toujours cette question qui revient « Pourquoi toujours / retardons-nous la joie » ? ou encore « à quoi bon le poème / où ne vibre // cette lumière / que certains jours révèlent »
Ici est notre seul séjour » (884) mais « nous avons manqué / seulement de courage.
X. Fresque de la villa Julia Felix, Pompéi : peintures de fruits, raisins, grenades, pommes, noix, dattes, baies qu’« on croit sentir / dans la bouche » (910). Le chant, « notre patrie », l’harmonie, la musique de Luciano Berio, puis la neige sur les pins noirs et les rochers, puis des barbelés, les baraques, un contraste toujours plus saisissant « ̶ Même dans un camp / dit la voix // il faut un chant / pour dire cette vie-là ̶ ».
Repris plusieurs fois en refrain : « la terre est lasse / de votre tristesse ̶ ». La voix qui parle n’a « Pas de serviteur pas de maître » (972). Rembrandt peint son fils Titus à son pupitre, (Rotterdam), dans une lumière cuivrée, et son regard est dans « l’abîme de ses rêveries ».
Aller vers l’abandon, laisser partir, laisser venir le silence dans la voix : « Laisse le vide / envahir ta vie // laisse ta vie / n’être plus que maintenant » (999), « Laisse / partir // maintenant / laisse - » (1000) Le chant ne cesse pas mais lâche prise, ne devient plus que l’infime murmure de la voix entrée dans le silence, avec le lecteur.
*
L’auteur nous ouvre à la condition même de l’instant qui passe, nous rend disponible à sa révélation ; il dégage de la gangue des souvenirs l’éclat du présent. La perspective donnée par chaque poème n’est pas oblique mais frontale (il n’y a pas de point de fuite mais comme dans une peinture de Rothko, un face à face dans une étendue ouverte). Le choix de la numération reconstitue le temps et relie les lieux avec les instants pour sauver les sensations éprouvées et conjointes de la beauté et de la souffrance du monde. L’auteur nous propose un autre temps non seulement de lecture mais de manière de vivre (pas de poésie sans éthique).
Toutes les créatures et les œuvres rencontrées, musicales, picturales, littéraires, sont des témoins en perpétuelle réinvention. La gravité des questions soulevées est comme allégée par la mutation constante qui s’opère d’un poème à l’autre. Et dans ce mouvement continu dont les changements de tons et d’images se font sans rupture, il y a parfois comme la mise en abîme d’une situation dans une autre, rendant solidaires les lieux, les œuvres, les questions et les blancs intervalles de silences. On ne sort pas indemne de cette lecture qui est une expérience spirituelle pour qui s’y donne entièrement. Nous en devenons à notre tour « la voix » et le silence.