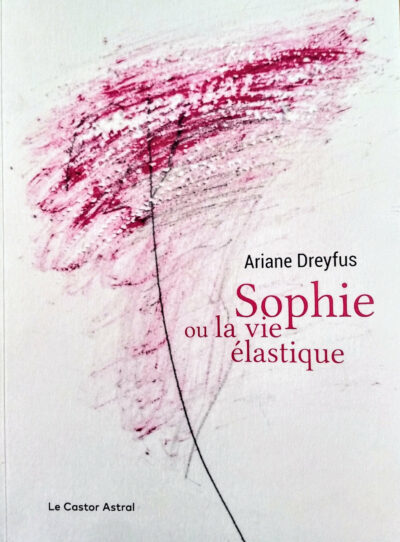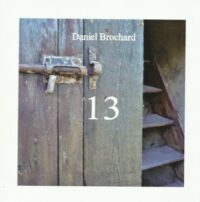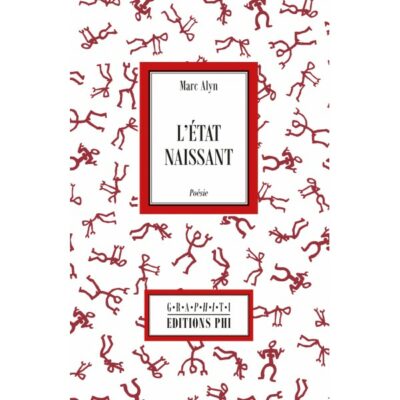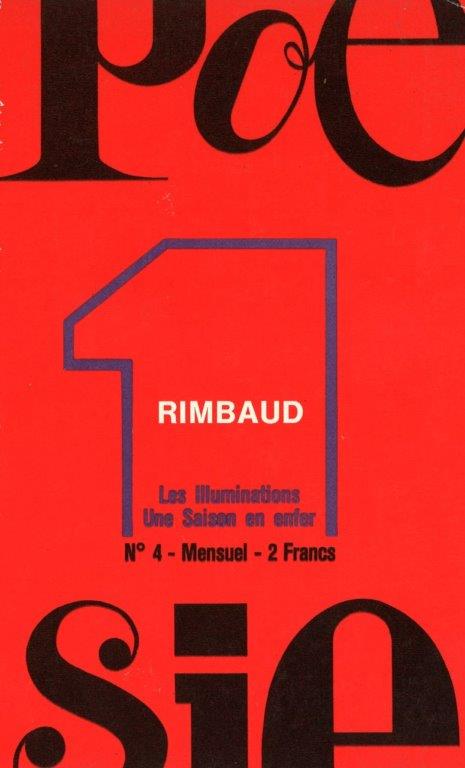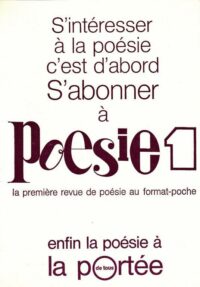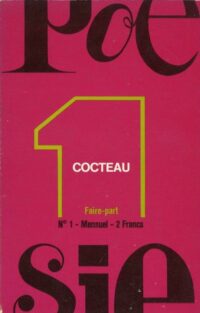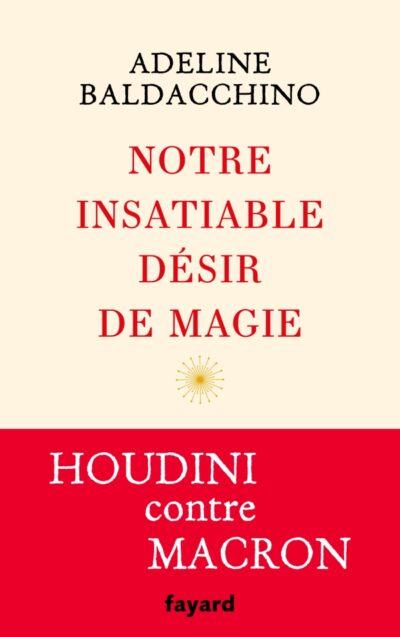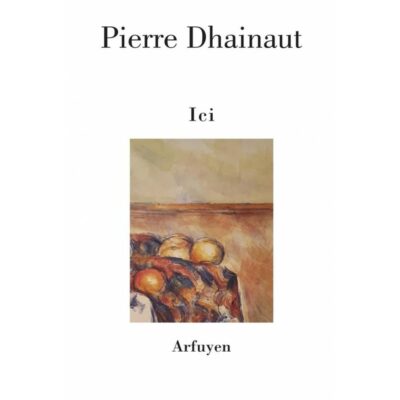Sylvie Durbec, Carrés
Couleur orange et graphie très sobre pour la couverture de ce livre, qui s’ouvre sur une citation de Peter Handke. Cet auteur autrichien est le personnage tutélaire de ce recueil, (qui de Sylvie Durbec ou de lui prend la main de l’autre ! ?), son nom est cité à presque toutes les pages, et l’on comprend que Sylvie Durbec va suivre la démarche d’écriture de ce dernier.
Depuis 1975 Peter Handke a poursuivi un programme de vie et d’écriture de plus en plus axé sur l’observation de soi, la réflexion sur soi, le commentaire de soi. Il s’observe tout en observant le monde et cherche à rendre le présent, car le présent doit selon lui, pouvoir s’écrire. Très tôt Handke s’est voué à une esthétique du non-événement en s’attachant à faire apparaître ce qu’il y a de caractéristique dans le quotidien. Il semblerait que Sylvie Durbec ait voulu lui emboîter le pas, sa recherche est semblable tout au long des carrés, bien qu’elle déplore ne pas être pourvue de la même lucidité que son illustre (mais aussi controversé) modèle. Cependant Sylvie Durbec ne manque ni de sensibilité ni de curiosité ni de références. Au gré des pages, d’associations d’idées en glissements orthographiques, d’assonances en néologismes, elle nous fait part de ses réflexions sur l’écriture, ses joies et ses surprises. Elle « brodécrit », les lignes de trame des lettres et des mots rencontrant les lignes de chaînes du papier, le carré sur la page se présente comme un tissu.
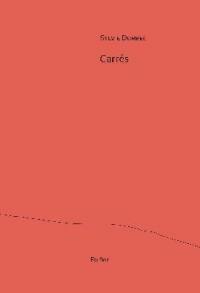
Sylvie Durbec, Carrés, éditions Faï fioc, 2020, 60 pages, 11 euros.
« Un petit bloc de glace à sucer sous la langue attention aux caries du carré la pointe de la langue évacue le trop froid le crache et c’en est fait de la disparition » : qui dit carré laisse entendre carie ainsi que Carinthie, région où est né Peter Handke. Mais le carré peut aussi bien figurer un ring, une caravane qui sert de cabane devient une « carabanne ».
Le mot carré renvoie aussi à jardin, plantation, semaison de mots et de graines, germination : « nos mots usés plantés semés carottes rutabagas tomates et ne rien voir pousser dehors sauf le livre », « çà jardinière d’un texte carré où pousseront des lignes parfaitement parallèles ». Ce livre est un livre de plein-air et Sylvie Durbec une poète de plein-vent, du dehors, où elle s’oblige à écrire malgré le mistral et le froid. Carrés d’écriture pour éviter l’ennui de l’habitude, pour se laisser surprendre par l’inattendu de l’exercice et par le flot de conscience qu’on cultive depuis que Virginia Wolf s’en est faite la championne ; parce qu’écrire n’a rien à voir avec la répétition et la mécanique bien huilée du quotidien.
Ouvrage écrit en l’espace de deux ans, certains carrés écrits lors d’une résidence au Grand Sault chez la poète Anne Calas (à Sault dans le Vaucluse), il s’agit d’une suite de carrés (50 +1) de 24 lignes environ en moyenne, dont la dernière ligne est inachevée et se finit par le mot carré…. Mais alors est-ce bien un carré ! L’auteure elle-même pose la question. Carrés prétextes, carrés mémoire aux souvenir plus ou moins lâches, carrés d’un puzzle dont les pièces forment des angles droits, et dans ceux-ci des anecdotes (la renarde a mangé les poules, les petits enfants dessinent et peignent) ou bien des évocations de paysages : Le mont Ventoux comparé au Fuji Yama, le Larzac. Sont aussi évoqués la vie paysanne d’antan, Pétrarque, l’héritage familial, la mort de la mère, l’idiome de la mère, la terreur que les yeux de la mère inspirent, les déplacements et des lieux visités (Lascaux, grotte de Chauvet), Marseille (la plus belle ville du monde, celle où a grandi Sylvie Durbec), l’enfance et les règles auxquelles obéir… et de fil en aiguille dans la chair même de la vie, défilent sous nos yeux la mort, les migrants et les réfugiés, les EHPAD, les proches qui peuvent se révéler être ceux dont on sait le moins de choses : « parmi tous mes familiers ici, celui dont j’en savais le moins, c’était mon fils ».
Les carrés ont le souci de la parité : autant de mots masculins que féminins, le but défini est d’écrire une biographie, mais « biographie future plutôt qu’appartenant au passé » faite de petits instantanés comme un pique-nique sous la pluie dans la voiture aux abords d’une route monotone, biographie faite de réflexions quasi métaphysiques toujours rapportées au concret du vécu immédiat. Les carrés en prose n’offrent aucune ponctuation, quelques majuscules pour signaler le début d’une nouvelle phrase mais peu (« pour dire non à la hiérarchie à cause de ce travail modeste sur ce qu’est un carré d’écriture »), des mots en Italien, et au hasard des pages sont évoquées les présences éphémères d’artistes ayant croisé la route de l’auteure (autres que P.Handke) tels qu’Edith Azam, Pentti Holappa (poète Finlandais décédé en 2017), Montaigne (celui qui vit, un peu comme Sylvie Durbec, « à sauts et gambades »), Rabelais, Georges Pérec, Robert Walser, Mahalia Jackson, Vincent Van Gogh, Gustave Roud, Soutine, Salvador Dali, les amies Suisses Claire Krähenbühl et Denise Mützenberg … L’évocation du persil fait apparaître Marius Daniel Popescu (poète Vaudois d’origine Roumaine ayant fait des études de sylviculture, et créateur du journal littéraire le Persil), on croise aussi Emily Dickinson (qui pose la question de savoir si l’on doit ou non écrire au singulier un couple alors que deux le font et qu’un rien le défait). Et puis l’auteure s’observant écrire, avec un brin d’auto dérision se demande ce que ferait un « vrai écrivain » : « il est comment au réveil comment commence sa journée café balzacien ou thé anglais j’en sais foutre rien ». Suit alors l’évocation de l’écriture de James Sacré : « un carré d’écriture où subsiste le fouillis des broussailles chères à james sacré ». Et l’on sait combien ce poète, nourri d’enfance, aguerri aux questionnements qui ne trouvent pas de réponses limpides, fait figure de phare pour Sylvie Durbec (James Sacré avait signé la postface de son recueil Femme(s) passagère(s) de l’est paru chez p.i-sage intérieur en 2016).
Dans ce livre de Sylvie Durbec, les carrés quand ils sont au cimetière, sont confessionnels, mais ils peuvent aussi être de chocolat, ou bien des carrés Gervais servis au goûter, ou bien ils ont la forme de mouchoirs agités lors de départs, ou bien ils font penser à chambre et de chambre on en arrive à gaz et aux horreurs de l’histoire : la Shoah, le massacre des villageois brûlés vifs à Oradour sur Glane (« la vézère avec toute cette eau pour éteindre la lettre O qui hurle en silence ici comment habiter dans la Cendre toute une vie »), ou bien encore l’explosion de la centrale nucléaire à Tchernobyl. Les carrés s’écrivent en train, en marchant, en jouant avec les petits enfants : « il est comme ça l’enfant à redresser le monde qui penche sans craindre l’effondrement maniant brouette et balai torchon et fourchette pour que ça marche la vie ». Les passages où sont évoqués les enfants laissent transpirer toute la tendresse et tout le bonheur ressentis au contact de cette jeunesse qui répare, qui renouvelle, qui rafraîchit, qui donne sens, qui émerveille et nous fait nous questionner, mais surtout nous fait nous dépasser.
Si Rimbaud associait les couleurs aux lettres, Sylvie Durbec les regardent en s’attachant à leurs formes. Un B est formé de « deux petits ventres », un C est oreille, un O est ouvert et peut devenir « désert brûlé », O comme une bouche bée, muet d’étonnement ou de sidération. Le A suggère quant à lui l’autorité. Il faut aussi rendre hommage au climat de liberté et de fantaisie que Sylvie Durbec installe dans ses carrés. La fraîcheur de son ton nous aide à affronter les choses tristes évoquées qu’elle partage avec nous, lecteurs-trices. Cela ne nous étonne pas outre mesure, car cela fait partie de son talent que de faire preuve d’humour et de tirer les récits vers le conte, vers l’univers imaginaire des enfants.
Livre attachant, touchant, ouvrage d’autoréflexivité au sens large, et qui déborde l’histoire personnelle de l’auteure, il s’inscrit dans la cohérence d’une œuvre où régulièrement sinon toujours, Sylvie Durbec nous fait traverser des paysages (dont certains, comme la Sibérie, ont valeur particulière sinon symbolique), interroge la peinture et les peintres, navigue entre plusieurs langues : réelles, souvenues et inventées. Nous l’avons retrouvée avec plaisir, elle qui nous a rendu familiers de ses éclats, de ses bribes où l’enfance joue un rôle important, où la vie quotidienne brille de quelques pépites éclairant le continu d’une vie écrite comme d’une écriture vécue dans la chair vivante de l’existence.