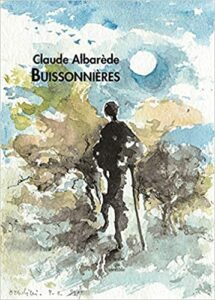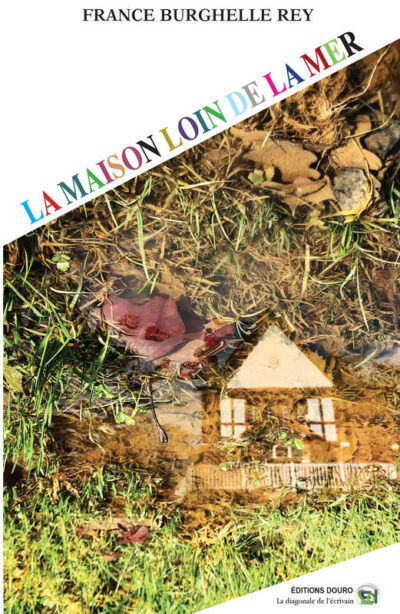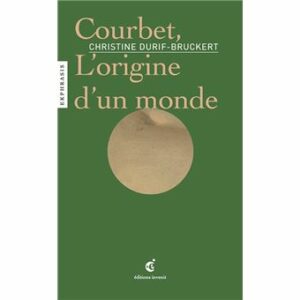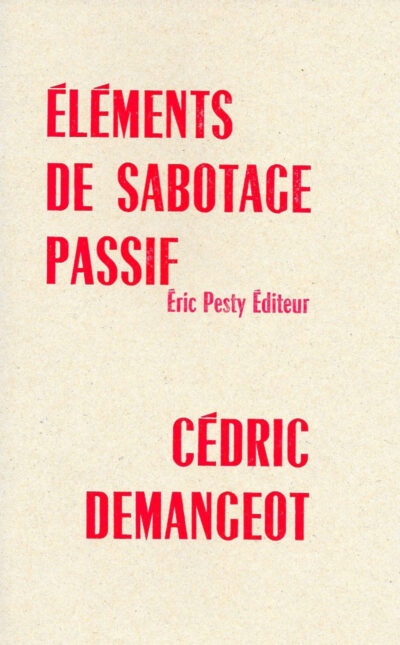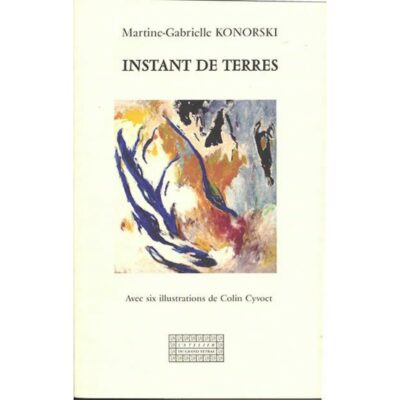Le fragment est espace ouvert, passerelle d’un terrain à un autre, d’un ouvrage à un autre. Il permet de créer des liens sans s’enfermer en eux. Il est essentiellement musical puisqu’il favorise l’enchantement des échos, le rappel des thèmes, des fantasmes, des ravissements, des fulgurances et des obsessions. Il participe de l’infini et de l’inachevable. La citation de Michel Leiris que glisse France Burghelle Rey à la toute fin du livre est emblématique de l’entreprise de la poète : « Un livre qui ne serait ni journal intime ni œuvre en forme, ni récit autobiographique ni œuvre d’imagination, ni prose, ni poésie, mais tout cela à la fois. Livre conçu de manière à pouvoir constituer un tout autonome à quelque moment que (par la mort s’entend) il soit interrompu. Livre donc éventuellement posthume et perpétuel work in progress. »
**
*
L’entreprise dans laquelle la poète entraîne son lecteur s’appelle, dit-elle page 26 une « autobiopoésie ». On y entre in media res par effraction. On doit s’y débrouiller, démêler les écheveaux ou comprendre à mi mot les relations des uns avec les autres. La narratrice n’explique pas, ne présente pas les protagonistes de l’histoire, elle fait comme les enfants quand ils racontent : elle ne se soucie pas que l’énonciation ne soit pas claire pour son lecteur car en ouvrant le petit volume on entre d’emblée et de plain-pied dans le mystère, ce mystère pour lequel elle écrit : « J’aspire à comprendre tout en ayant peur d’éclaircir ce mystère. » (p.23) Et pour y parvenir il faut être dans « ce lieu » de l’enfance où quelque chose a eu lieu.
Ce qui toutefois décide de ce qui a eu lieu c’est ce qui se passe dans le texte même qui s’écrit comme si l’écriture tout à la fois dérobait le mystère et le faisait naître. Dans l’écriture de La Maison loin de la mer la première transformation c’est l’autorisation que se donne l’auteur d’écrire au féminin : « Voici que, pour la première fois, j’écris un livre au féminin. Quinze carnets et comme un refuge, par choix, au masculin. J’ai amputé tant d’adjectifs, de participes de leur dernière voyelle. Mais peut-être l’ai-je fait pour exprimer un neutre, une absence de genre, sans que m’en importât la question. » (p.19) Cette autorisation lui permet de faire resurgir la petite fille qu’elle fut et d’évoquer sa première expérience de la beauté qui se hisse dès l’aube de la vie en expérience mystique : « Le second lien qui correspond à un extrait de La Source que je cherche de Lytta Basset confirme ce rapport entre lieu et spiritualité et me rappelle ce que j’ai dû vivre, enfant, dans mon village : une fillette de quatre ans en vacances, l’été, regardant les hirondelles voler autour d’un clocher, est soudain envahie d’une plénitude, un bonheur absolu, au point de courir le raconter à ses parents. » (p.53) Un flash de joie sans mélange qui s’apparente à une révélation dont la conscience et la signification ne naîtront que bien plus tard. Ce qui compte, dans le parcours sensuel, sensitif, affectif, intellectuel et spirituel plein de méandres, d’obscurités, de douleurs et d’empêchements, c’est cette joie première qui revient – intacte – au cours du temps depuis le lieu de l’enfance et cette joie s’appelle aussi poésie. Que la joie soit à saisir, voilà qui lève un pan du mystère de la vie, de toute vie ! Qu’il faille pour la recueillir pleinement dans sa chair, dans son nid, dans l’art et l’écriture, demande une discipline et une aptitude que les contes (de l’enfance) nous aident à acquérir. Il n’est donc pas étonnant que les références au Petit Poucet, à La Belle au Bois dormant, à Cendrillon traversent l’ouvrage de France Burghelle Rey. Ils ont été la nourriture de la petite fille de la maison de Rose. C’est par eux qu’elle a su la valeur d’un bal, du baiser, la valeur des mots qu’on goûte, malmène, triture, avec lesquels on joue, on se trompe, on se laisse bercer. Et grâce à ces histoires anciennes, elle s’est préparée à filer la métaphore, à se faire piquer par le fuseau, ou par l’épine, à interroger le miroir qui réfléchit pour se demander Qu’ai-je donc filé avant de m’endormir ? (p.41) et d’entrer grâce à toutes ces strates intellectuelles et poétiques dans les problématiques de la modernité d’ici et maintenant.
La dislocation du récit, son opacité, sa fragilité importent peu. Ce qui fait sens c’est une trajectoire qui suggère (car il ne faut pas expliciter afin que la magie du secret continue d’opérer) un lien généalogique entre l’aimé et la narratrice, un lien lié au lieu comme si la relation amoureuse, accomplie ou non, rêvée, fantasmée, esquissée dans cette vie ci, avait déjà eu lieu bien avant, de même que la trahison personnifiée par la belle cousine. « Pourquoi vient-elle me voir cet été là ? Sous la tonnelle ils se connaissent. Regards, sourires dès le premier instant. C’est vrai qu’elle me ressemble. J’ai inventé les mots « miracle noir ». Belle cousine que j’aimais tant ! » (p.26)
Le factuel est réduit à une pincée de sel bien qu’il soit au cœur de l’inquiétude ou de « l’intranquillité » de la narratrice. La force de ce récit discontinu, morcelé c’est d’y avoir mis au centre, l’amour et la joie, qui ne sont pas racontables car ineffables. Seul surgit et s’y inscrit la trace ou « le résidu chantable » (comme a si bien dit Paul Celan), qui est la véritable trame poétique de la vie. « Finalement ce n’est pas lui peut-être que j’aime mais cette terre que j’ai perdue et que j’aimerais aimer encore. Mais il est vrai qu’auprès de lui je me reposais et me remplissais de l’esprit de mon lieu. » (p.27)
Pour que le vif, la vie jaillissante bruisse du récit-poème, la narratrice exclut le « récit chronologique. » Quel sens aurait-il ? « Il ne serait qu’artifice. Seul est naturel le chemin pas à pas de l’écriture : celle-ci, comme la vie, une respiration. » (p.39) D’où l’impression d’une certaine spontanéité presque comme dans un journal intime où les trouvailles, les recherches, les flâneries, les conversations, les douleurs du deuil, les lectures du moment, tout est donné en pâture au lecteur dans un apparent fouillis, cartes sur table, poèmes d’autrui et poèmes personnels jouxtant la prose personnelle à celle d’autrui. Elle rejoint par « ses sauts et gambades » Montaigne qui lui aussi citait en abondance les auteurs latins ! Maintenant les poètes et penseurs du monde entier peuvent être cités et loués. Ils confortent, réconfortent quand chacun à sa manière fait l’éloge des choses de l’esprit. Alors, puisqu’il faut finir, eh bien je finirai (et je ne crois pas que France Burghelle Rey m’en tiendra rigueur), non par elle mais par une citation de René Char qu’elle donne page 58 :
Il n’y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté.