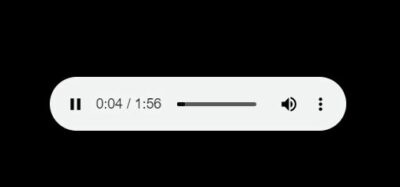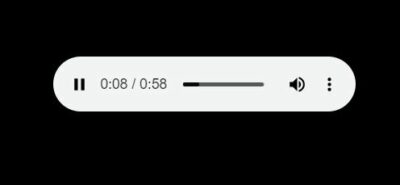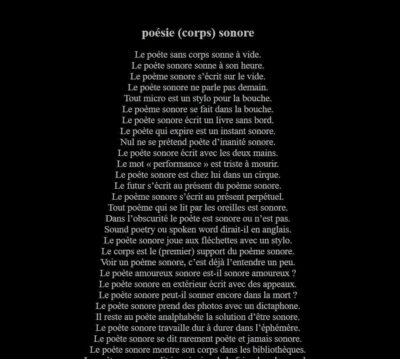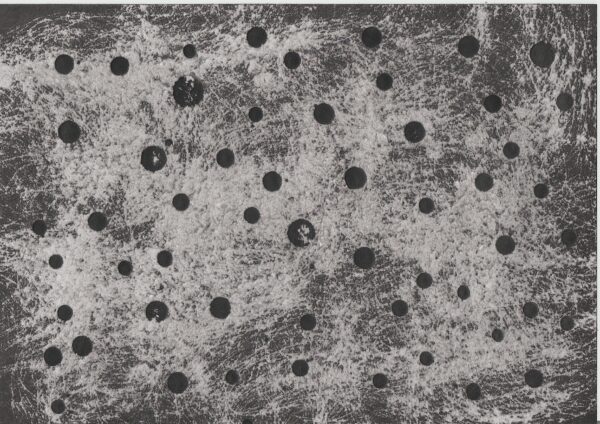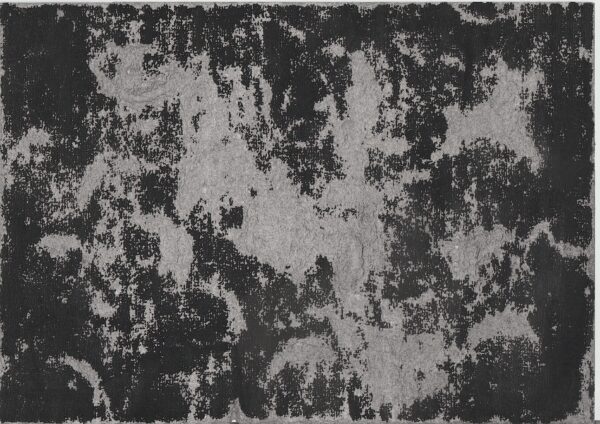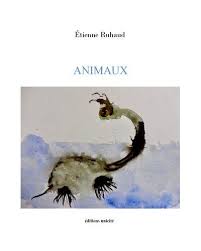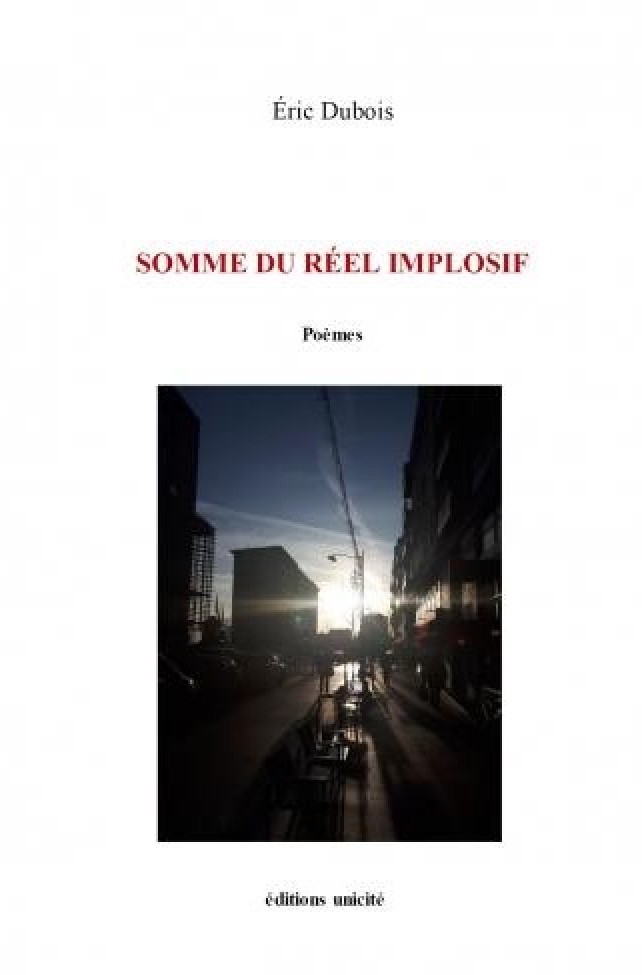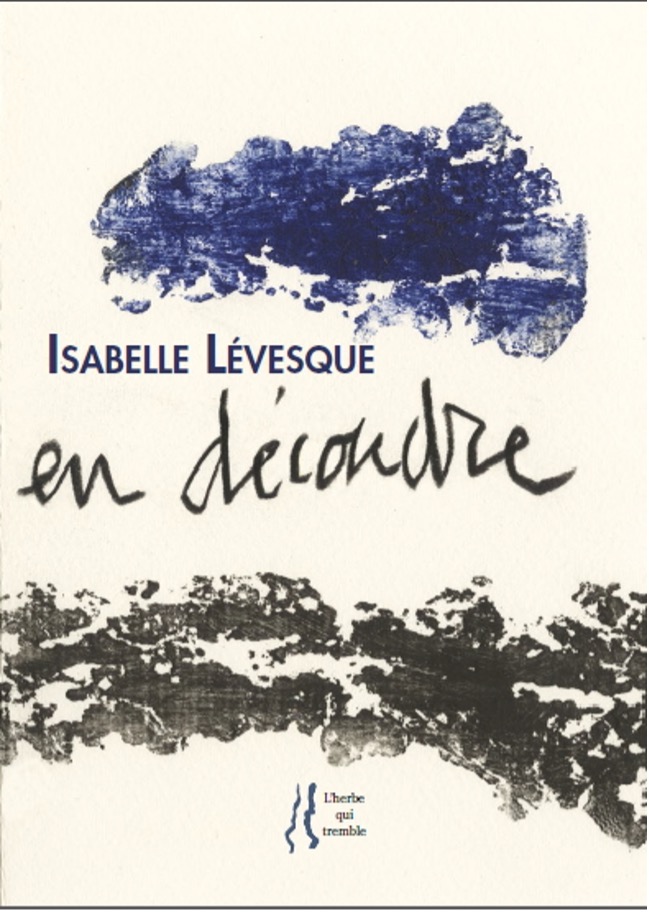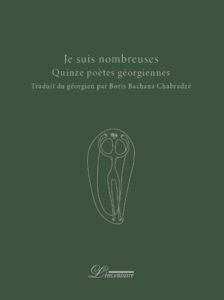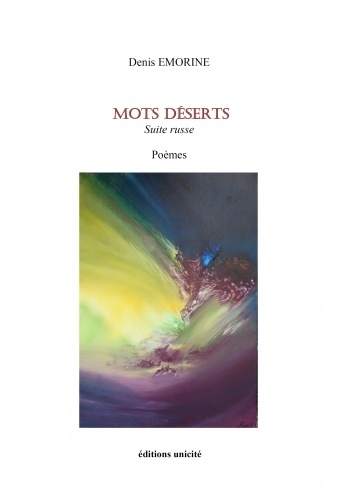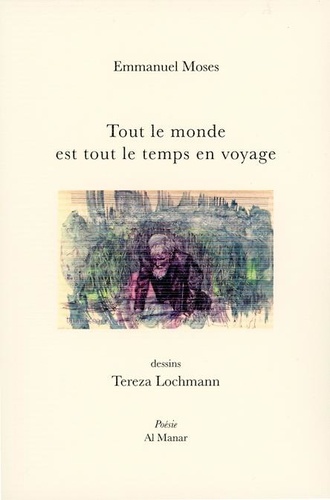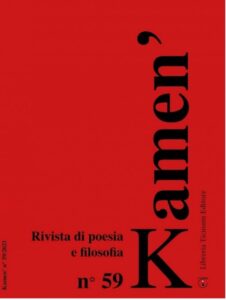Ce livre diffère du précédent, Chemin des centaurées, qui se déroulait mois après mois au cours d’un printemps et ressuscitait une large part du passé, en nommant les lieux, en donnant de nombreux détails géographiques, la vallée de la Seine aux Andelys en particulier. Dans En découdre, une soixantaine de pages seulement, tout se resserre, tout va sans cesse au fondamental.
Comment en irait-il autrement puisque l’action se passe de décembre à mars durant la saison de l’ascèse ? Isabelle Lévesque est privée de ce qui l’exalte et qu’elle célèbre dans la plupart de ses poèmes (et de ses photographies), les fleurs, essentiellement leurs couleurs. Le coquelicot, son emblème, ne fera vers la fin du livre, de l’hiver, qu’une furtive apparition, synonyme d’espérance fragile, mais tenace. Elle ne se détourne pas pour autant de la nature, cela lui serait impossible. La neige, qui depuis toujours lui est chère, celle des jeux d’enfants, ici celle des aimés, intervient dès l’ouverture :
Est-ce un hasard, parole brisée ?
La neige a posé sa couleur.
Nous faisons corps
en ce flambeau.
Sous couvert : l’ardeur.
La neige, pour Isabelle Lévesque, n’est ni froide ni stérile : plus qu’à la contemplation, elle incite à l’action. Isabelle Lévesque y marche, et puis, « d’un bâton », elle y laisse comme sur une page d’écriture « des figures » d’abord « indéchiffrables » qui, la nuit venue, ressembleront à « des dessins de flamme ». Peu après, elle voudra « allumer les traces » et en faire un « brasier ». Rien dans l’univers magique où elle pénètre ne reste immobile, dans un état strictement défini, les contraires s’appellent, la neige brûle. Le vocabulaire du feu est omniprésent, il correspond à tout ce qu’entreprend, amour, poésie, celle qui dit je :
Exécuter le chant :
je ne saurai taire
flamme et le cri
-même métier de braise-
le tissé
libère des cendres.
C’est le poème.
Ce qui était horizontal devient vertical : à la flamme et au poème conviennent également les arbres. Chêne, Peuplier, Olivier, If… Ils sont innombrables à travers tout le livre, appréciés pour leur droiture et pour l’apaisement qu’ils apportent. Ce sont pour la poésie des modèles : « Le chant vise l’ascension. »
Les contraires s’appellent, en effet, ils se déchirent comme ils peuvent s’unir. Libres, ils procurent au livre entier sa mobilité si dramatique. Le cadre réduit d’En découdre l’accentue.
Un cadre semblable à celui que dans le ciel dessinaient les augures afin d’y attendre le passage des oiseaux et de l’interpréter, le templum. Un livre de poèmes est cet espace sacré, aimanté. Isabelle Lévesque qui publie de vrais livres, non de simples recueils, a le souci en les construisant de respecter le rythme du surgissement de l’écriture. S’il est continu, il n’est jamais linéaire. En découdre avance à force de « départs » et de déchirures, de tension et de détente, de « chutes » et de « salves », au gré des heures ou des surprises, néfastes ou fastes. Isabelle Lévesque n’ordonne pas les différents états qu’elle traverse : au cri succède un chuchotement, au constat de détresse l’espoir d’ « un nouveau monde », aucune interruption. Elle accueille ainsi par à-coups, par éclats, tous les temps.
Du passé surgissent des visions brèves : l’être aimé n’est plus que « silence » et « absence », n’appartient-il désormais qu’à la terre et à la nuit ? Non, l’hiver n’est pas définitif. Comment dire ? La perte est absolue, « Où es-tu ? », le sentiment domine, du « manque », mais de la déploration même s’élève un poème où Isabelle Lévesque ose dire : « De l’épreuve, sortirons grandis, / démesurés ». Elle écrit « les lettres de neige », elle poursuit :
Alors si tôt je prends chemin
t’appelant dans le paysage. Entends,
le blanc fait écho, brille,
plus encore que ce soleil
né des nuages comme prairies
forgées de ciel. C’est miracle.
Ce poème n’est pas le dernier du livre. D’autres rediront « le manque ». Une page, est-ce un poème encore ? N’est-ce qu’un « texte » ? Elle est en prose, ira jusqu’à parler de cette « clôture » qui « réduit […] les contours » de ce qu’Isabelle Lévesque écrit, les contours d’une existence meurtrie par la séparation ou la mort. Le mot ultime d’En découdre pourtant, ce sera « vie ». L’abandon au désespoir est interdit.
Ce qui depuis le livre initial, Or et le jour, une fois pour toutes, « obstinément », caractérise la démarche d’Isabelle Lévesque, c’est l’énergie. Question de vie ou de mort, elle a lié son sort à la poésie. Écrire un poème, descendre au fond des ténèbres, se débattre ou pour mieux dire se battre contre les ombres à la façon des preux de la Table ronde, prendre essor de nouveau, recréer une lumière : une catabase et une palingénésie. Au présent du poème, le passé et le futur sont convoqués : dans la perte s’anime une promesse. Et c’est ce qui rend tous les livres d’Isabelle Lévesque si impatiemment intenses, si vivants, ils expriment l’une et l’autre, l’espérance serait-elle précaire :
Un coquelicot prépare en douce
sa percée. À le veiller je mets
en terre le silence.
Les poèmes ne connaissent pas de frontières. Ceux d’Isabelle Lévesque inventent un rituel « qui ne prive plus ce qui n’est plus de battre encore », comme elle le confiait dans un entretien avec Sabine Dewulf (Terre à ciel, avril 2021). Peut-être y a-t-il davantage que revivre, il y a sur-vivre.