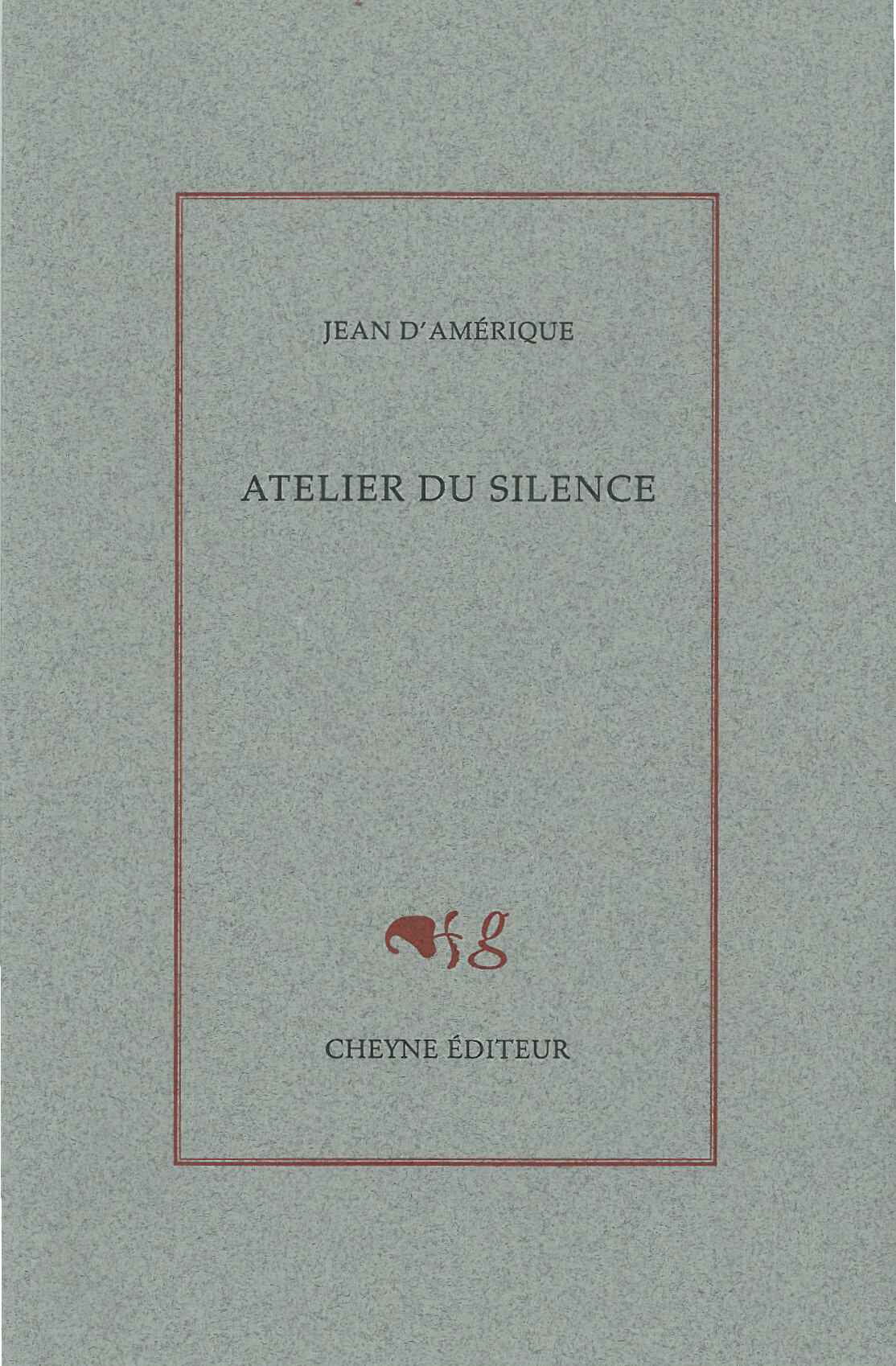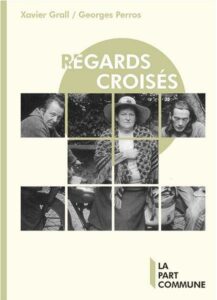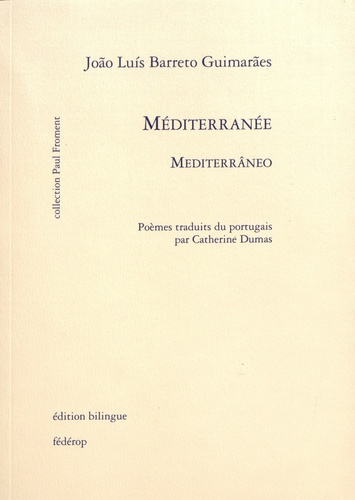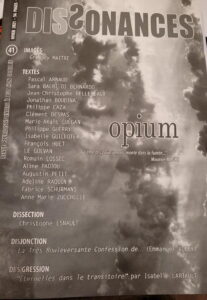IL séjourne dans un espace impossible parce que nous cohabitons avec le hasard. (P.11)
Une première réponse est donnée par l’auteure. En cela que l’espace impossible est aussi et par extension logique là-encore, rivé (sournoisement ?) à l’immensité même de l’espace qui nous englobe… Par hasard ?
Pas sûr cependant, car le hasard, autrement nommé, « imprévisibilité », imprédictibilité », est aussi un fait scientifique, (un fait est un fait) ; ou bien encore selon certaines définitions, « mystère de la Providence ». Je pencherais quant à moi, vers cette dernière formulation qui n’a rien d’anodin, encore moins de gratuit, parce que le hasard n’est lié à aucune cause commune, cependant que :
Notre situation entretien un quiproquo archaïque. Nous agissons avec des mots dont l’immobilité absorbe les contours. (P.11)
Ainsi le « mode d’action » est-il à son tour convoqué, comme un « quiproquo archaïque » qui finalement peu s’avérer dangereux car IL n’affirme rien de plus qu’un risque possible d’erreur et de détournement du sujet-objet, qui n’appelle pas une réponse clairement signifiée et signifiante.
IL est de l’ordre du tâtonnement et de la quête ajournée …
IL révèle précisément son impuissance dans les contours, dans lesquels paradoxalement il s’affirme, en « tous points ».
La courbe stérile des lettres détruit notre imaginaire. (Page 11)
Avec une possible destruction à la clé qui n’intervient pas forcément de manière sauvage, autant que brutale dans sa réalisation, alors que l’enjeu d’une re-naissance reste toujours probant :
IL remplace sa figure démiurgique par une imitation de sa transparence. Des nombres entretiennent l’illusion d’une fiction écrite entre les traces de sa disparition. (P.11)
Et c’est bien alors et pour tenter une vaine explication (fictive et illusoire), au moins pour tenter de sortir de l’aveuglement.
Une force cosmique enterre nos déplacements sous le trajet de notre liberté. (P.13)
A condition toutefois que cette dernière soit encore possible, puisqu’au final,
Nos fantasmagories perpétuent la traversée inaboutie d’une chronologie occulte. (P.14)
Comme sortie, extirpée, de la prescience divinatoire sans risquer de provoquer un drame encore plus grand dont le vide serait le seul miroir acceptable - là encore la prudence semble de mise.
Un chaos imperceptible recouvre l’étendue d’une durée incoercible. (P.15)
Si bien que l’espace-temps est littéralement congédié :
IL avale la durée de nos paroles parce qu’IL écrit avec des lettres réversibles. (P.15)
Et plus encore pour nous perdre encore plus intensément, en inversant les portes d’entrée.
Il raconte l’expérience légendaire de notre ignorance en falsifiant le corps de nos attentes. (P.17)
A tel point que l’on peut se demander si l’ignorance au fond ne serait pas le meilleur atout (rempart) pour conjurer le mauvais sort qui pèse sur nos consciences imparfaites, inachevées, afin de démembrer (dénombrer) :
L’architecturé d’un langage hermétique (qui) délimite le périmètre de nos enfermements. (P.26)
Et c’est à mon sens, comme à juste titre, que l’on peut parler, sans risque cette fois-ci de « probabilité du CHAOS », comme « d’une dynamique inversée », échappatoire possible entre, « l’Ere du vide », et la construction d’un système plus solide qui ne renverrait plus à la précarité « organique » et « cosmique », en clair :
Un écart entre l’interstice des intervalles de nos paroles et la distance d’une superficie discursive laisse apparaitre le frôlement de la durée. (P.28)
IL encore et toujours comme réceptacle de sa propre légende qui :
attend dissimulé sous une absence contradictoire. (P.29)
Sauf que :
Une énergie despotique transporte notre histoire vers un univers métaphorique. (P.29)
Nous le regardons avec des mots pour tenter d’énoncer sa disparition. (P.32)
Comme un point de bifurcation que rend le lendemain (tout lendemain) aléatoire et imprévisible si bien que :
IL enchaine nos trajectoires à l’épicentre d’un discours immuable. (P.28)
Une harmonie primitive relie nos rôles au tronc des arbres. (P.36)
Ainsi autant de probabilités, que de contradictions qui construisent un Univers abrupt qui ne repose dès lors sur aucune réponse connue en ce Monde, et qui nous place constamment en position de déséquilibre.
Illusion encore qui nous fait croire que le Monde repose sur un socle solidement ancré dans la Terre. Mais d’ailleurs où donc est-elle passée ? Je ne l’ai point trouvée. Ne l’aurais-je point vue, en vertu de ma propre cécité ?
La profondeur hallucinatoire de notre cécité s’articule à une impossibilité anecdotique de nous taire. (P.34) et :
(opère) un effacement de notre dédoublement quand nous achevons de parler. (P.34)
Tout semble dit en effet, et nous n’en voudrons pas à Carole Mesrobian, d’avoir si intelligemment brouiller les pistes en nous malmenant ainsi au sein d’une articulation quasi-mythologique qui « transcende son achèvement » et en amont notre destinée ; car il fallait bien qu’à un moment donné, IL « s’exprime dans la légende d’une transcendance inversée », sachant également que le pari était fort risqué d’intervertir les schèmes du langage, en opérant une « déconstruction positive » de ses conductions dans une forme volontairement circulaire (mais non routinière) avec au bout du compte un grand point d’interrogation….