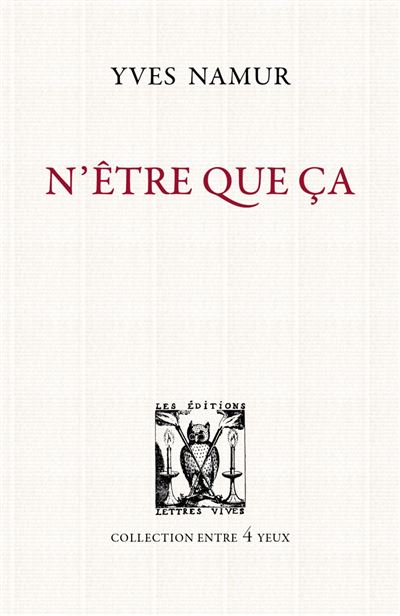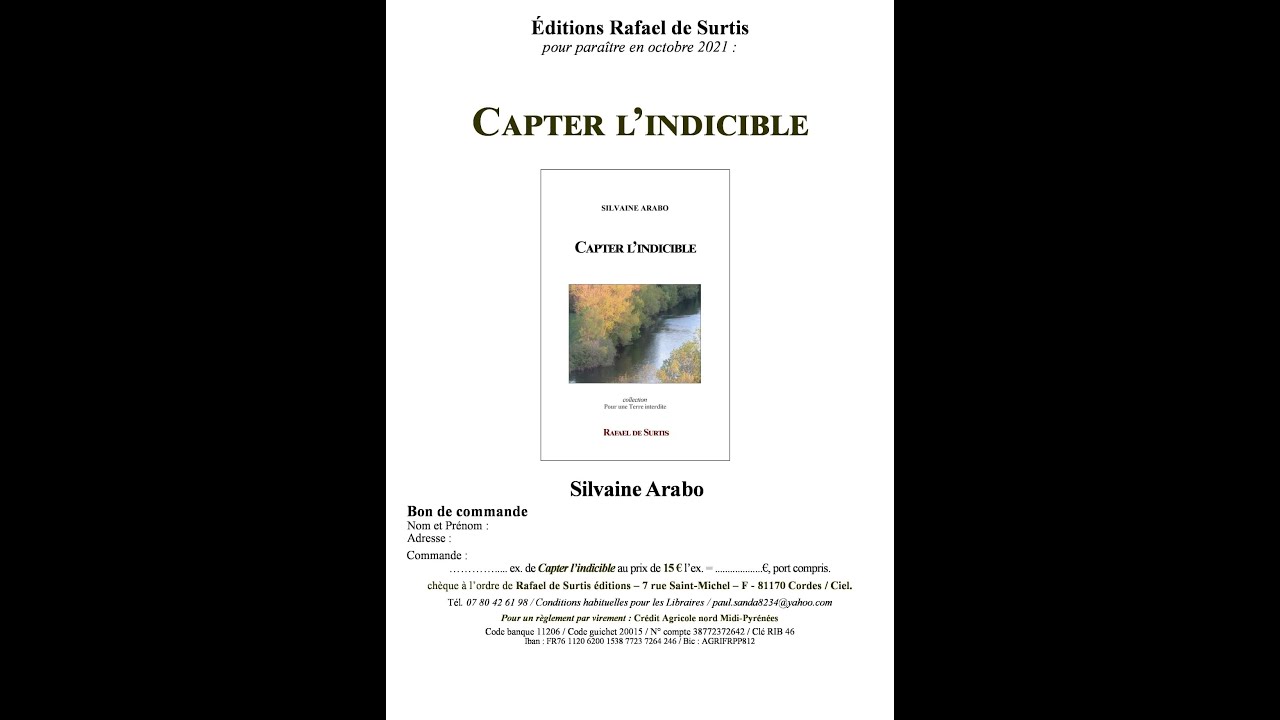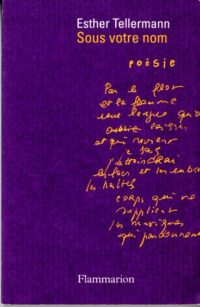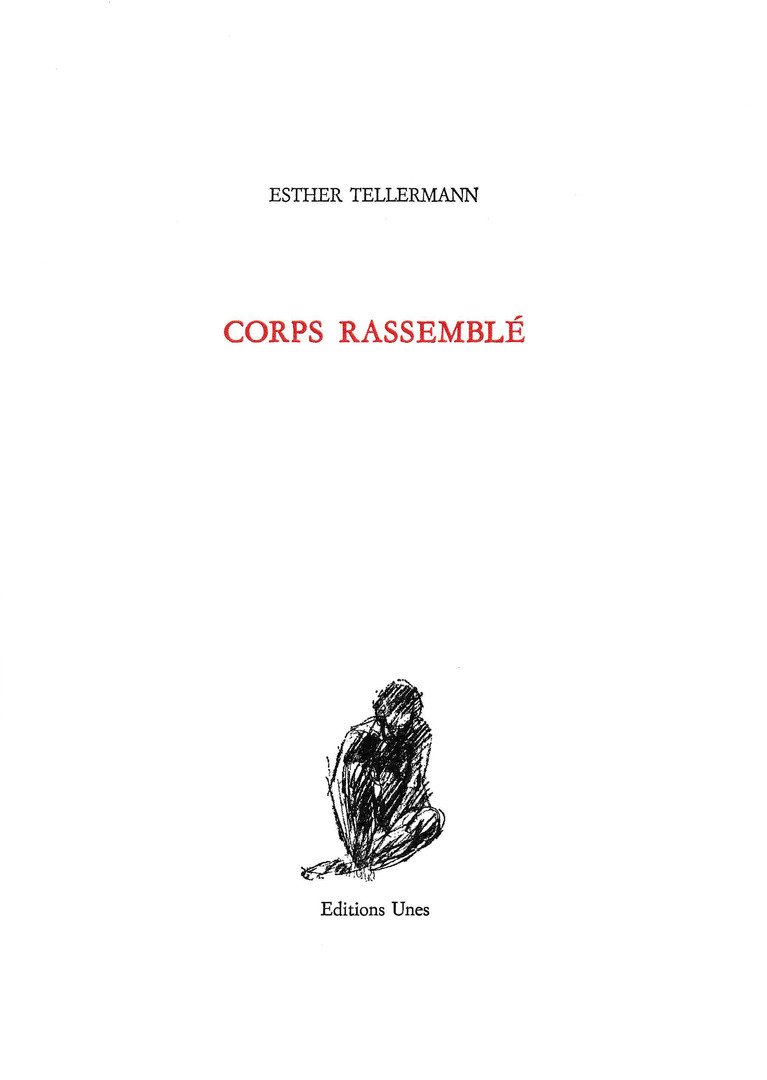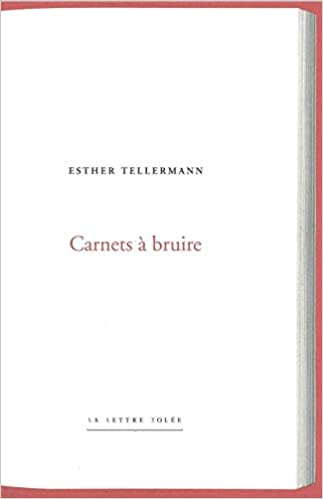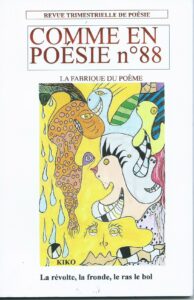Marilyse Leroux, On n’a rien dit de l’océan
Ce petit livre offre une couverture très sobre, mais sitôt qu’on l’ouvre, le bleu et ses diverses nuances jusqu’au vert vous happent. Le titre en forme d’affirmation provoque une réaction : Mais qu’y aurait-il donc à dire de l’océan ? Ou bien : Y a-t-il encore quelque chose à dire de l’océan ? Le thème ayant été traité tant et tant qu’il pourrait sembler épuisé. Une version plus leibnitzienne poserait une autre question : pourquoi y a-t-il l’océan plutôt que rien ? Et comment le dire ?
Humblement Marilyse Leroux nous donne sinon une réponse, du moins une version, une vision sage : Après tout ce qui s’est écrit, après sa propre et régulière contribution au développement de ce thème, qu’on ne s’y trompe pas, quoiqu’on en ait dit, quoiqu’on en dise « L’océan polira ses nacres / jusqu’à l’épuisement des couleurs […] Ce qui sera dit finira galets / - finira écume – vapeur d’écume / à l’aplomb des rocs. » Nous avons donc à faire à l’éphémère témoignage humain qui contemple sa finitude face au long temps cosmique, témoignage ravi, pris dans le sein du continuum de l’éternité.
« Tout a été dit / Mais peu a été fait. / Alors, agis, retrousse tes manches, / Donne vie à tes idées » écrit le poète et philosophe Serge Lapisse. Quant à Anton Tchékov, son opinion est que « Tout a été dit et fait, et aucune littérature ne peut dépasser le cynisme de la réalité. On ne saôule pas avec un verre celui qui a déjà bu une barrique. »
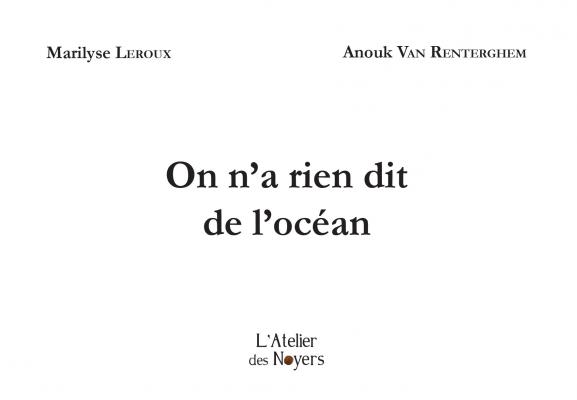
Marilyse Leroux (poèmes), On n’a rien dit de l’océan, Anouk Van Renterghem (peintures), L’atelier des Noyers (collection carnets de nature), 56 pages, 10 euros.
Marilyse Leroux, sans aucun doute, a eu l’élan de retrousser ses manches pour dire l’océan dans tous ses états et sous tous les angles de vue y compris du dedans. Car cet océan est bien aussi cette force qui remue en nous, qui soulève infiniment de questions. Si une conscience humaine peut faire l’expérience du cynisme de la réalité, elle fait à coup sûr l’expérience d’une force vitale, d’une régénération toujours possible. Et où sinon au contact de la mer, symbole et berceau originel de la vie sur terre, confronté aux éléments qui nous dépassent en puissance et de loin, peut-on sans cesse voir à l’œuvre cette force de destruction/construction dans l’espace qui se recrée.
Bien entendu il y a la lumière, il y a la mer et ses marées, il y a un cap, il y a la côte d’où l’on guette, d’où l’on agite mains et mouchoirs en guise d’adieu, il y a le sel et le sable, les pierres, les rochers, la houle, un phare, les algues … et celle qui observe, pieds nus ou bien droite dans ses sandales, voit ses pensées, des images, remonter des abîmes et glisser au ras de l’eau qui monte et descend. Les vagues roulent une histoire, un langage, au rythme de la respiration de la mer : « La houle emporte les souffles / jusqu’au lieux de rencontre / syllabes roulées vert bleu / à l’abord des criques. »
Liquide vital (« sang noir »), lieu d’agitation, de mouvement, « Tout prend force dans la mer » et elle donne force, elle tonne, elle ‘’crie’’ tandis que l’oreille humaine cherche à approcher quelque silence, celui qui se fait à l’intérieur de l’auteure qui s’en remet au bleu du ciel pour trouver comment dire sans « Ne rien craindre de la folie passagère ».
Livre des correspondances s’il en est, On n’a rien dit de l’océan conjugue poèmes et toiles (acryliques de Anouk Van Renterghem), relie ciel et plage (autant de nuages en haut que de galets en bas), relie ciel et terre via la pluie qui égrène ses points d’interrogation. Correspondance aussi entre paysage et faim tandis qu’en marchant les pieds prennent le pouls du monde. Et correspondance encore entre l’eau de l’océan et l’encre du poète, comme si sur la page les lettres formées étaient directement et concrètement des résidus d’écume, comme si l’intellect (ou le mental) avaient été court-circuité dans le processus de l’écriture.
On n’a rien dit et pourtant, tant de récits et de mythes, tant d’histoires particulières et personnelles attachées à la mer, aux côtes, aux rivages, aux profondeurs marines, celles précisément qu’on retrouve à l’intérieur de nous. Et nous penchant au-dessus d’elles, et « Dans l’afflux de l’air / le monde un instant / redeviendra visible. »