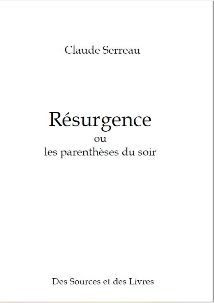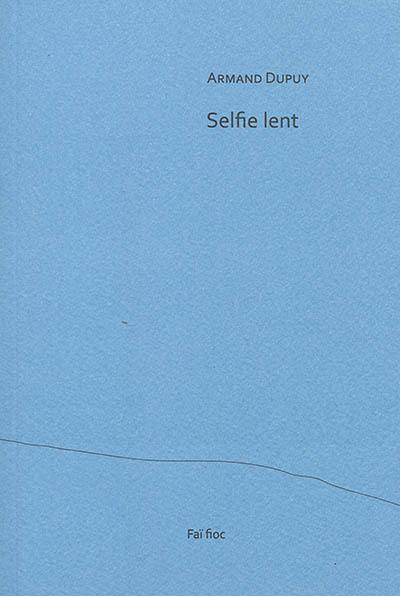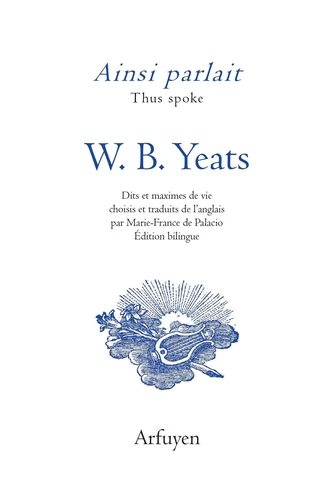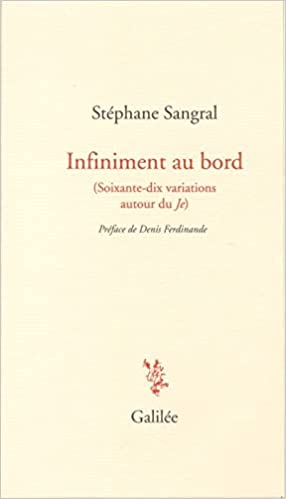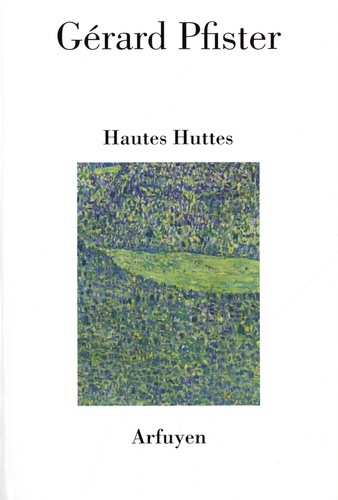Précisons d’emblée que l’érudition qui sous-tend cette œuvre est d’autant plus solide et nourrissante pour le poème qu’elle est gommée. Sous-jacente, elle distille ses images dans les mots mais ne se prétend pas la garante du sens de cette longue et lancinante méditation métaphysique, qui peut s’entendre sans elle. Néanmoins, un détour par les « Résonances » finales favorise, comme dans Ce qui n’a pas de nom, une compréhension plus grande du dessein qui présida à l’œuvre et, pour ainsi dire, des images à la source de l’invention. Ces clefs interprétatives sont précieuses, elles sont une manière de refuser l’hermétisme d’une lecture pour initiés et de proposer une entrée libre dans l’œuvre. Faites comme chez vous, voici les clefs de la maison. La démarche de Gérard Pfister est exemplaire : elle met à la disposition du lecteur une boîte à outils conceptuels, une réserve d’images, l’atelier du peintre ou le cabinet-bibliothèque de l‘écrivain, comme pour nous dire : ceci est né de cela et de bien d’autres encore, d’un couvercle de pyxis, d’une lecture de Li Po, transmutés par la pensée et la sensibilité. A notre tour, nous emportons Hautes Huttes dans nos propres Résonances, elles y trouveront leur place au sein d’annales personnelles qui sont aussi celles de l’Âme du monde.
Partout, Méduse
Le constat désespéré du chaos présent et la nostalgie de l’or(dre) du temps perdu trouvent ici un mode d’expression particulier, celui de l’interrogation horrifiée, question oratoire adressée à nous tous,
Qu’est-il arrivé
à nos vies
qu’est devenue
la terre de notre enfance (290)
Scandant les deux tiers du poème, la montée au calvaire est marquée par des stations, pendant lesquelles l’interrogation et la révolte contre soi ressassent le temps gâché à ne pas s’émerveiller : « pourquoi », « comme si », « qui »
Pourquoi
toujours la vie
est-elle si mal aimée
si mal servie (523)
Ce questionnement désespéré, forme de reproche à l’humanité aveugle, traverse tout le recueil, plaçant en son centre exact ce cri de détresse :
Qu’est-il arrivé
à notre vie
que nous sachions
si mal l’aimer (500)
Expressions du regret et de la déploration, ces interrogations accusent notre maladresse à vivre, nos mauvais choix, notre incapacité à porter sur le monde le regard admiratif et reconnaissant qu’il mérite. Ce mode interrogatoire constant convient particulièrement à l’expression du doute, filigrane puissant du recueil : tout flageole, rien n’a d’assurance, les promesses de ne pas oublier s’envolent au vent, et c’est bien normal, puisque rien n’est sûr, pas même ce que l’on pense être soi-même :
De qui voudrait-on
se souvenir
jamais je n’ai su
qui j’étais (641)
Si le poème est si sombre, c’est qu’il n’impute pas seulement à la folie meurtrière des hommes ou à leur déraison les causes du désespoir. L’existence en soi est égarement dans les brumes, incompréhension du pourquoi, absence de contours de nos identités, elles-mêmes soumises à caution. L’illusion domine, les assises de l’être, qui lutte pour sa verticalité, ont perdu toute tangibilité, elles ne sont que « souvenirs de souvenirs » (643).
L’attitude du sage, ou plutôt la leçon du recueil consiste à proposer un autre regard, qui est un revirement : il s’agira de passer d’un désespérant constat d’inanité à la joie du sans-nom, de transmuer la peur de l’abîme en célébration du vide.
L’enfer qu’il est si difficile d’affronter, c’est la violence du monde, des guerres et des épidémies qui y sévissent, c’est aussi l’enfer intime du corps rendu méconnaissable. C’est le souffle qui manque en altitude, mais aussi dans les hôpitaux (échos très contemporains) où des corps machines sont eux-mêmes reliés à des machines. Le bouclier de Persée nous fait défaut, réflexion de l’enfer, qui finirait presque par le nimber de grâce
debout face au miroir
de cet enfer (565)
Voir et ne pas voir : du bon usage du bouclier
La colère et la peur, suscitées par le désespoir de n’avoir pas su vivre, sont renforcées par le dépit de n’avoir pas su comprendre le privilège que constitue le seul fait de vivre. « Comment n’avoir rien vu » (240), « pourquoi n’avoir pas vu » (243)
A qui la faute ? Moins à la vie qu’à notre façon de la voir et de traverser les épreuves qu’elle nous impose. Pour avoir surestimé nos forces, nous nous sommes pris pour des Titans, des demi-dieux ou des surhommes. Penchés vers l’avant, tendus vers le haut, jamais présents à l’hic et nunc, nous avons commis l’erreur essentielle :
sans même commencer
à vivre
tellement
nous pensions être éternels (241)
L’exil de nous-même, de l’enfance, s’apparente à une folle course sur les crêtes, tendant vers un but que nous attribuons illusoirement à quelque transcendance (626). De peur de regarder dans l’abîme, nous nous prétendons guidés par et vers un but élevé, que nous nous sommes inventé pour échapper à notre humanité.
toujours nous voulons fuir
à quel exil contraints
par un oracle
de nous-mêmes inconnu (626)
La fuite en avant, cette course éperdue sur la pointe des pieds (634) et sur celle des montagnes, est une manière de ne pas voir l’horreur mais ce n’est pas la bonne. Pour affronter Méduse, Persée avait utilisé son bouclier réfléchissant, et c’est là un modèle qui nous est proposé pour réenchanter le monde.
Central et spéculaire, le bouclier-miroir de Persée rappelle combien il est dangereux de voir sans précaution, car regarder l’horreur méduséenne pétrifie. Le détour par l’or du miroir projette un peu de lumière, enjolive les choses et les êtres d’une auréole sacrée. Car il s’agit de ne pas se tromper d’aveuglement. Voir dans le miroir est voir la beauté du monde. Et c’est là un autre des enseignements du poème : la beauté est dans le reflet, et sans doute aussi la vérité.
Nous ne savons pas regarder la merveille du monde, sur laquelle nous posons des « yeux sans regards » (293, 574, 829, 874). Klingsor est pourtant passé par là, posant sur le monde un « manteau de magicien que nous ne savons voir (951), ou que nous regardons sans voir (« tu vois et ne vois rien ») (931)
Ce bouclier protecteur, par déviation, on en cherche l’équivalent dans le miroir et dans le portrait. Le peintre pourrait fixer, sur sa palette, autre bouclier, les couleurs vives de nos traits avant qu’elles ne pâlissent, autant dire figer la vie (561), éterniser l’instant.
si l’alchimie du peintre
au mercure
du miroir
quelque temps ne les sauve (562)
Petite unité sémantique du fragment, qui contient tout un monde ! Arrêtons-nous sur celui-là. Le « quelque temps » ne laisse guère d’illusion sur le rêve de pérennité, pas plus que la précision de « miroir au mercure », qui, comme le bouclier, réfèrent à un contexte historique précis et limité. Mais la verticalité même du fragment fait se surimposer « alchimie » et « mercure ». Il y a dans Hautes Huttes comme une recherche du principe en même temps qu’une réalisation du Grand Œuvre : le livre peut se lire comme un parcours vers la quintessence, parcours inauguré dans la douleur et l’incompréhension, la colère aussi de toutes les occasions manquées, puis l’acceptation et l’élévation. Le bouclier de Persée permet de « transmuer » le regard terrifiant de Méduse (536), d’inaugurer un élan ailé vers l’âme du monde, l’éther (qui n’est pas le ciel : la fascination du ciel, comme le rappelle un fragment, est aussi illusoire). L’alchimie est salvatrice, mas elle est plus que le mélange réussi des couleurs du peintre, elles aussi destinées à passer. Il s’agit de trouver la quintessence. Du sang de Méduse naissent des créatures ailées, comme Mercure.
Les boucliers photophores de Persée mais aussi d’Athéna nous protègent et nous éclairent dans l’obscurité du monde, mais ils ne le feraient s’ils ne portaient l’horreur de Méduse. C’est aussi de ce monstre que naissent les ailes et l’épée d’or du guide Chrysaor, ailé comme son frère. Nous le suivons dans l’or mais aussi dans la boue, car le jeune homme nu à l’épée d’or est aussi, à ses heures, sanglier, et se plaît à l’obscurité et à la boue des sous-bois. Il faut nous guider à l’or de ces reflets et réflexions, suivre ces alchimies tout au long d’un procédé initiatique conduisant à la révélation, au dévoilement, à l’apocalypse.
rien ne nous est
révélé
qu’à la surface opaque
du mercure (815)
Les deux dernières sections du recueil ne posent plus de questions inquiètes mais leur répondent. On peut penser que la révélation poursuivie par la quête philosophique – philosophale – ne peut faire l’économie de l’opacité, en l’occurrence du tain des vieux miroirs. Il faut bien que l’étain se mêle au mercure pour produire le tain, et c’est de ce mélange seulement que naît l’alchimie (du verbe). Il faut bien que Méduse soit tuée par un procédé tortueux, de biais, pour que de sa mort naisse Pégase, le cheval ailé, symbole de la poésie, mais aussi monture de Bellérophon pour tuer... la Chimère.
Hautes Huttes raconte la peur d’être au monde, condamnés à naître et condamnés à mourir, dépeint en couleurs sombres l’effroi de l’homme qui se cherche un Persée pour pouvoir enfin détourner son regard de la terreur qui fascine.
le cercle d’or reflétait
le hurlement
et nous n’avions plus peur (528)
A la fin des troisièmes et quatrièmes sections, quand la centurie s’achève, l’ange noir et or revient diffuser son évangile d’apaisement. A défaut de bouclier, nos paupières fermées détourneront nos regards de l’horreur de vivre. L’ange ouvre et referme la centurie,
De quoi avions-nous peur
avec tant d’amour
il ferme
sur nos yeux les paupières (300)
De quoi aurais-tu peur
les images
nous tirent du noir
nous rendent à l’or de la terre (398)
La seule façon de vivre est de considérer le reflet, l’image dorée d’une réalité sombre. A ce stade du texte, le poème, pourtant en train de se constituer, ne s’est pas encore proposé lui-même comme moyen de produire l’image. Pourtant là réside l’une des solutions : le poème-bouclier, reflétant la réalité, du moins celle que notre illusion commune donne comme telle, pour en extraire la beauté, avec la boue faire de l’or.
A mesure que nous cheminons, des visions de lumière apportent un peu de douceur et de clarté dans l’obscurité. L’apaisement passe l’acceptation de la part nocturne, cette nuit étoilée oxymorique contenant la joie mystique, l’exultation (316), la paradoxale joie de la plainte (314), la nuit plus éclatante que le jour (317).
La joie retrouvée ne fera pas l’économie de l’acceptation aimante de la fragilité. Fragilité de l’homme subissant le joug des souffrances d’exister, écrasé de tâches inhumaines, ou plutôt surhumaines, mourant de ne pas accepter sa faiblesse et de vouloir porter la misère du monde.
Vertige de l’impossible renaissance
Le vertige sur les hautes cimes naît aussi de l’impossibilité à revenir en arrière, sur le chemin de crête. Le recueil dépeint l’illusoire désir d’analepse comme resaisie, reprise. Le désespoir de devoir vivre dans le chaos et la destruction se conjugue au regret de n’avoir pas su prendre le temps pour porter le regard sur ce qui en valait la peine. L’homme cherche son salut hors du temps de deux façons possibles : en rêvant de l’arrêter ou en rêvant un impossible retour à l’origine. Ces deux modalités de sortie de l’impasse sont aussi déraisonnables l’une que l’autre, mais ce sont celles que nous empruntons.
Fixer le temps et l’espace, convoqués sous les espèces de l’intervalle et de la vitesse, est voué à l’échec, dans cette constante fuite en avant. Les fragments évoquant cette hypothétique issue sont d’ailleurs de nouveau des interrogations rhétoriques, tant l’espoir est vain.
Comment fixer
ce qui n’est que vitesse
course infinie
des ondes dans le vide (582)
Qui pourrait
arrêter
ce qui n’est que vitesse
cascade incessante dans le vide (745)
La fin du recueil dira précisément la nécessité de laisser partir, de ne plus tenter de fixer le flux qui s’écoule.
Face à la désespérance de cette poussée à grande vitesse vers l’avant, la tentation peut être grande de se tourner vers l’autre branche de l’alternative, de chercher le salut dans un retour aux sources qui défierait les lois du temps, ferait coïncider le baptême dans le Jourdain et le Golgotha, en somme.
il faudrait ne faire
que commencer
qu’à commencer déjà
tout soit accompli (376)
C’est un autre rêve impossible que celui d’une régénération, d’un retour à l’innocence baignée d’eau lustrale du « nouveau né »
Pour cela, il faudrait connaître l’alpha et l’oméga, maîtriser le terminus a quo et ad quem. Il faudrait d’une certaine façon tourner en boucle dans l’éternel retour, en espérant un jour toucher l’infini.
Quelque part
existe-t-il
l’océan extérieur
où serait la limite
Où tout serait atteint
et viendrait le retour
ce terme
où tout peut commencer (516-517)
Ce n’est pas dans la palingénésie que se tient le miracle possible car elle impliquerait une maîtrise… titanesque, une force surhumaine aux antipodes de ce que le poème propose en revanche comme aide : l’acceptation de la fragilité, de la plénitude du vide.
Or s’initier, entrer dans le processus de compréhension, c’est justement ne plus tenter de maîtriser, d’assurer, de dominer, c’est renoncer à être ancré dans la terre ferme, c’est accepter le vertige et le tremblement. La vie n’est pas brève, c’est notre façon de la vivre qui est insensée, c’est la vie qui a perdu sa vocation à chercher le sens, tant elle s’est perdue dans des considérations domestiques et matérielles données comme ersatz d’amour (210), tant nous avons continué à vivre en étant mort déjà.
À quel âge
avons-nous
cessé de vivre
par quel précoce ennui (216)
Tout est question de savoir-vivre… Il faut savoir recommencer à vivre, ce qui ne veut pas dire revenir à l’origine, mais inaugurer constamment un nouveau départ
si vivre
sans cesse
n’était que commencer
qui pourrait regretter (211)
il faudrait savoir
ne faire que commencer
pour s’initier enfin
à toutes choses (391)
Il ne s’agit donc pas de re-commencer, mais de commencer l’initiation, de réussir son entrée dans l’obscurité pour voir, enfin, l’essence des choses, accéder aux arcanes. Il s’agit non de ne faire que commencer, mais de ne faire que « commencer pour s’initier enfin », et c’est un acte d’amour (qui rappelle l’évolution spirituelle d’un Milosz).
mystérieuse
amoureuse initiation
dans l’arcane
la semence des choses (387)
Porter le poids du monde ?
L’homme (« on ») ne troque pas sa finitude contre l’immortalité en se rêvant dieu. A force de penser qu’il peut envisager l’insoutenable et supporter la douleur du monde, le fragile composé de si peu de matière sent au contraire s’appesantir encore plus lourdement sur ses frêles épaules les poids de l’existence. C’est que « si pesants déjà, un rien nous fait pencher » (547).
Plus que l’angoisse, gorge qui se serre, c’est l’accablement qui s’empare de l’être exposé au vertige. Pour dire ce sentiment de pesanteur ontologique, l’imagerie titanesque rappelle la folie de vouloir porter un fardeau trop lourd. Il faut être Hercule ou Atlas pour porter le monde sur ses épaules, d’autant plus que le poids des maux de la terre est plus pesant que l’argile légère (262) du potier antique. On ne se déleste pas du poids des épreuves, ces travaux herculéens (329), pas plus qu’on n’évite l’éternel retour sisyphéen de l’épreuve (Sisyphe n’est-il pas aussi proche des Titans, lui l’époux de la fille d’Atlas ? et n’a-t-il pas été châtié pour avoir, aussi, défié Thanatos ?),
à chaque arrivée
la charge retombe (414)
Ce globe
sans relâche
il nous faut le soulever
au risque de nous rompre (368)
Le poème dit et redit cet orgueil insensé
Debout
dans l’infini des mondes
dérisoire titan
portant à bout de bras la terre (51)
Dérisoires titans
rêvant de soutenir
à bout de bras
la terre (261)
Ce refrain du poème n’est pas ressassement, car le poème se construisant, et se suggérant peu à peu lui-même comme bouclier possible, propose précisément une forme d’allègement du poids du monde. Car la différence entre l’homme et les dieux, demi-dieux ou titans est que l’homme n’est pas assuré d’une immortalité plus ou moins grande. La brièveté du temps qui lui est imparti empêche qu’il ne cède à l’hybris : comment se charger si pesamment lorsqu’il nous faut en même temps avancer, et encore ! avancer en peinant sur les chemins ascensionnels, rêver de monter vers les Huttes en portant sur son dos le poids du monde ?
Jour après jour
gravir la montagne
sur les épaules
tout le poids du monde (413)
Où cherches-tu
encore à t’élever
tout est si haut
ne sens-tu pas le vertige (470)
Comment ne pas vaciller ? Mais précisément, le poème, qui s’affirme alors, et de plus en plus, comme épée d’or, nous indique la voie, dans la célébration de ce vacillement même, et non dans l’effort surhumain.
Nous avons en outre les enfants de la terreur, nés du sang de Méduse, pour nous éclairer sur le ténébreux chemin. La peur disparaît, la mélancolie aussi, « nous ne craignons plus l’ange noir. Il marche à nos côtés, le jeune homme ». (539-540). L’ange noir à l’épée dorée, c’est Chrysaor, le frère de Pégase, né aussi du sang de Méduse. La double apparence du frère de Pégase, tantôt sanglier tantôt précieux métal, autorise une méprise puis un soulagement, réconcilie l’homme avec sa nature double, le ramène aux mystères de la terre et des bois. Chrysaor va alors guider le lecteur – disons, la figure de l’être dans son cheminement initiatique – pour le détourner de sa peur originelle. Dans ce grand poème de formation, l’ange noir à l’épée d’or est une sorte de figure tutélaire, d’abord effrayante, ensuite protectrice, en lien direct avec son frère.
L’affirmation progressive du pouvoir du poème rappelle que Pégase, symbole de la poésie, finit par triompher de l‘adversité. Le règne de Pégase, qui succède ici au rêve du règne des Titans, montre où est la vraie force herculéenne, dans la puissance du véhicule spirituel, qui, dans une certaine acception hermétique, permet l’accès à la connaissance.
Éloge du vacillement et du vertige
C’est du rêve surhumain que naît la désillusion, mais le poète ne se contente pas de constater le triste spectacle de l’humanité tanguant au bord du gouffre, escaladant péniblement les cimes en portant une trop lourde charge. Il montre la beauté de ce déséquilibre, de cette fragilité, il nous ramène au spectacle de notre chétivité, nous rappelle le composé de matière que constituent nos corps, ni purs esprits ni force herculéenne
De si peu
de matière
par tel hasard
notre corps tient ensemble (318)
Comment porter le monde
heureux déjà
si nos pieds
peuvent nous porter (549)
Au poète de montrer l’unique beauté du tangage sur la ligne de crête. C’est ce vacillement que l’on entend à la fin dans le « timbre voilé » du « violoncelle comme vacillant », non au bord de l’abîme mais au « au bord des larmes » (801). La beauté n’est pas dans la tentation du surhumain, mais dans l’aveu de la vaine réalisation de ce rêve.
marchant sur la terre
si vacillants
pour quelle revanche
le rêve d’être titans (319)
Ce motif salvateur s’affirme dans la troisième partie, avec l’image de l’oiseau. Athéna, qui à l’occasion sait se faire oiseau de nuit, a su quelle intelligente récupération faire de la tête de Méduse. D’un bouclier l’autre, devenu simulacre, la tête effrayante n’est plus que masque sur l’égide de la sagesse, mais elle pétrifie encore. Entre réalité et apparence, vie et mort, ici-bas et au-delà, les territoires de l’entre-deux dévoilent la beauté de leur vacillement. L’égide au masque reflète à son tour la réalité du monde, qui est « souveraine apparence » (337) aperçue dans le tremblement du reflet.
Dans l’œil d’or
de la chouette
tout est pure apparence
où la lumière se joue (817)
À la cécité associée à Méduse, qui plonge une partie du recueil dans l’obscurité, s’oppose l’or des épées et des boucliers. Autre opposition fondatrice : à la lourdeur des souffrances infligées par la vie, à la cruauté du geste libérateur de Persée, s’oppose la légèreté ailée de l’autre fils de Méduse. Mais précisément, le poète n’oppose pas frontalement et schématiquement le poids et la légèreté. Il compose au contraire un éloge de l’entre-deux, de la fragilité, des êtres qui oscillent, vibrent, hésitent au bord du gouffre.
C’est la titubation de l’enfant, c’est aussi l’image du vacillement qui s’empare de l’être au moment de faire le grand saut final. Mais cette hésitation n’est pas uniquement mauvaise, au contraire. Et c’est là la grande leçon d’espoir de Hautes Huttes : il est possible de s’arrêter sur ce moment de bascule, d’en extirper la quintessence, comme un gage d’éternité dans l’instant. L’importance de ce constat se marque dans la répétition du même fragment au sein du recueil :
Comme si la vie
n’avait de prix
qu’au bord
de la quitter (66)
Comme si la vie
n’avait de prix
qu’au bord
de la quitter (530)
Fragment caractéristique, tant par l’emploi si récurrent de la locution conjonctive « comme si », formulant un regret en même temps qu’une hypothèse, que par la préciosité (de l’or !) de ce vacillement. Le fragment revient d’ailleurs avec des variantes, toutes mettant en relief la térébrante beauté de cet instant de basculement :
Comme si la vie
n’avait jamais
cette beauté poignante
qu’au bord de la quitter (754)
Plus qu’en l’assurance d’on ne sait quel lendemain, c’est sur ce point de jonction entre deux mondes (le bouclier d’Athéna, le bord du gouffre) que se trouve le secret du temps retrouvé. Tout le prix, toute la valeur de la vie se trouvent cristallisés en ce moment suprême de basculement.
comme si rien ne valait
qu’en ce vertige (67)
qu’en cette titubation au bord de l’abîme, des « corps en équilibre sur l’arête » (544 ; 633).
Là où la désespérance initiale fait fausse route (et la suite du poème sera justement une reconnaissance de cette erreur), c’est dans son refus de l’instabilité. Le « pourquoi » et le « comment » n’en étaient qu’à regretter la fragilité de notre condition, « comme si », précisément, les incertitudes et revirements de la vie rendaient cette dernière impossible, alors qu’ils en sont la condition.
Accepter la métamorphose
Voir la beauté de la vie est accepter que tout frissonne, tremble, vacille et se transforme. Partout la branloire pérenne nous rappelle sa loi, à nous d’y voir une bénédiction, non une malédiction. Il faut que la couleur vire et s’écoule (584, 586), que la clarté vibre et s’éteigne (587), que l’art s’accomplisse dans la fragilité de la matière (588), que les sons du chant tremblent (590), que la voix chancèle pour être vraie (591), que celui « qu’a revêtu la force de la loi » frissonne (592).
La recherche du temps perdu, que l’impossible fixité de l’instant et l’impossible retour aux sources rendent aporétique, trouve également une résolution possible dans la vacillation. Il ne s’agit pas de renaître le même, mais d’accepter sereinement et joyeusement le travail de transformation, de transmutation
et à nouveau
venir au monde
au jeu tremblant
des métamorphoses (147)
tout est métamorphose
tout s’enfuit
immobile
dans le flux du monde (458)
Cette capacité à se métamorphoser, à accepter de ne plus être fixe et immuable est aussi ce qui nous sauve.
tout ne vit
que de mourir
ce qui demeure
a-t-il jamais vécu (742)
La grande leçon est l’acceptation de la fragilité et de la disparition qui n’en est pas une, car elle est foi en une métamorphose, abandon progressif de ce que nous croyions être nous-mêmes, à commencer par le nom. Ce qui n’a pas de nom, le sans-nom, est aussi ce caractère protéiforme, multiforme et fuyant qui nous permet d’échapper au monstre, c’est l’épisode d’Ulysse devenu « Personne » pour l’homérique cyclope
Celui qui n’est personne
qui pourrait
l’atteindre
quel dieu saurait l’emprisonner (843)
Accepter la métamorphose est consentir à la transmutation. Quelques insectes rejouent la scène du cimetière de Hamlet, remplaçant esthétiquement les vers attendus.
Oribates
et collemboles
vois comme ils s’activent
à faire le vide (739)
Dans l’humus qui nous rappelle la pourriture finale, dans le sous-bois où l’on peut apercevoir la biche qu’est le poème, il y a ces auxiliaires du grand débarras, ces petits êtres qui aident le néant à se faire. La vision n’est pas horrifique : les insectes aux noms euphoniques, auxiliaires de la vie comme du poème, sont les agents de la vie et de la mort. « Faisant le vide », ils sont la preuve de l’impossibilité à assimiler le vide au néant, le vide est toujours plein, durant toutes les étapes de la transformation.
Se laisser tomber
L’être ne peut se fixer, il est lui-même métamorphose continuelle, passage, transition. En lui aussi tout coule mais le tout est de laisser agir ce que nous ne pouvons maîtriser, et, comme Li Po, de laisser le vent faire le travail de l’éventail. C’est quand la respiration manque que vient l’émerveillement devant ce corps qui semblait respirer seul, « le flux le reflux dans les veines » (481) réglé par une machinerie invisible.
L’impossible recommencement nous convie à accueillir au contraire l’unicité de chaque vie, chaque naissance étant chance, « chute » dans le monde, et la fin du recueil nous révèlera que notre venue au monde par l’effet d’un hasard bien informé est une manière de passer du néant à l’être, de l’éternité au temps, du silence au poème qui dit la beauté des naissances, ces chutes.
À travers les naissances
les chutes
écoute le silence
produire le temps (935)
Le passage des interrogations inquiètes aux injonctions bienveillantes (sans doute émanant de quelque ange noir et or) souligne cette nécessité de se laisser porter par cette force sous-jacente, de même que le baigneur n’est pas conscient de l’eau qui le porte (551).
Comme tout est suspendu
au bord du vide
écoute
chanter le temps
laisse agir
invisible dans l’abîme
l’impeccable machinerie
sans personne (479-480)
C’est se remettre à la chance, à l’horloger invisible, grand joueur de dés devant l’éternel… Dans la 8e section, l’adresse semble délivrer le conseil de toutes les antiques sagesses : cueillir ce qui tombe, la « chance », le jour, accueillir ce qui « tombe » comme si on l’avait désiré. A l’homme sur sa ligne de crête, fasciné par l’abîme comme par Méduse, il convient de rappeler que la chute est littéralement une chance.
tente
la chance
n’attends
que ce qui vient
Cela
tu n’attendais rien d’autre
ta chance
est ce qui vient (725-726)
L’acceptation et l’amour de la chance conduisent à un éloge de la Fortune (730-733), le coup de dé ici abolit le hasard, lui substitue l’image d’une bienveillante omniscience.
Vois les dés
comme ils tombent
à chaque instant
entre les mains du hasard (730
Comme le jeu
est juste
et toujours vient
ce qui devait venir (732)
Mais cette chance est aussi la survenue du poème.
Le poème pour bouclier
tu vois
le poème était là
ta chance est là
qu’attends-tu (728)
La fragilité, le vertige, sont donc reconsidérés, non plus comme déplorable faiblesse mais comme force, formant la matière même du poème. La boucle est bouclée quand la poésie naît justement en célébrant l’évanescence de l’être, quand le chant proclame la richesse de l’infiniment fragile, qui contient des univers en puissance.
Quels mots
pour dire enfin
la seule réalité
ces semences ces pollens (683)
Le chant est lui-même marqué par la vibration, l’oscillation, la mutabilité, des mots « versatiles », « d’air et de feu » (684). Or paradoxalement, c’est ce poème instable qui est destiné à perdurer, étonnant écho au « monument plus durable que l’airain » d’Horace,
les mots seuls demeurent
et les pierres
dans le ruisseau
tout s’enfuit (743)
Quand le chant s’élance, dit le chant lui-même à la fin, l’oxymore métaphysique se réalise, la plénitude est trouvée dans le vide :
il s’élance
et si vide cette plénitude
si libre
cette harmonie (924)
Pourquoi ? Parce que le poème sait remonter à la source tout autant que poursuivre l’écho en avant. Il abolit les intervalles de l’espace et du temps car dans le présent du carmen tout est déjà contenu. C’est pourquoi l’ « exegi monumentum » est exempt de forfanterie. Le carmen résonne dans le vide des abîmes, il l’emplit, lui donne de la matière.
le chant contemple
la semence des choses
entend dans le vide
les résonances (934)
Mais le poème n’est pas seulement écho sonore donnant consistance au vide, il est aussi le bouclier réfléchissant, celui qui sait introduire la médiation de l’image du réel. Or Hautes Huttes nous a appris à considérer le réel dans le reflet du miroir. Au prix d’un renversement de perspective, métamorphose supplémentaire due au reflet, l’apparence devient la vérité
le miroir
en sait plus que les choses
le reflet seul
peut dessiller les yeux (810)
Le poème va en effet jouer ce rôle de réflecteur, il tend au lecteur une image inversée. Du même coup, les valeurs s’inversent, « l’image seule est véridique » (811), l’effrayant devient protecteur (807-808), la révélation passe par l’occulte.
rien ne nous est
révélé
qu’à la surface opaque
du mercure (815)
C’est une double invitation : à ne considérer que l’image, car c’est finalement l’image (icône) qui sauve, et à faire confiance au poème, réservoir d’images, pour nous dire le vrai. Ce bouclier tant espéré, ce rempart contre la peur, c’est en fait le poème qui le forge
Ce qui aveugle les yeux
c’est au miroir
du poème
qu’on peut le voir (806)
C’est ainsi le poème qui chasse la peur originelle du poème. Le procédé poétique est doublement actif, puisque le poème évoquant le poème se reflète lui-même, et nous donne « in process » un exemple de réalité transfigurée ! Arrivant au terme de Hautes Huttes, le lecteur a sans s’en rendre compte contemplé par le poème un reflet de la réalité. Et de fait, il sort du livre en ayant une autre vision du monde, faite de tendresse, d’acceptation, de rejet de la peur et de courage d’affronter du regard le vide sous ses pas.
Laisse partir
Les questions oratoires jalonnant le poème renvoient le lecteur à un « nous », un « vous », un « tu » qui outrepasse le drame individuel et touche à la grande interrogation métaphysique. Car c’est un peu le drame de chacun, de faire longtemps semblant de croire que le temps ne passe pas, d’en gâter les précieux moments, puis de pousser des cris d’orfraie quand il est trop tard. Mais la pénultième et la fin font entendre un tutoiement familier, écho du « laisse agir […] l’impeccable machine » du milieu du recueil (480). Ici, il ne s’agit plus de « laisser agir » mais de « laisser partir » (991-993) :
– laisse
maintenant
partir –
dit la voix
La seule façon de réduire l’intervalle, de se poser fermement sur ses deux jambes, et non sur la pointe des pieds, au bord du précipice, c’est d’accueillir l’idée même du vide.
Mais ne nous y trompons pas : il y a ici bien plus qu’un « lâcher prise », qu’un carpe diem rehaussé de sagesse orientale ou de petite voix thérésienne, qu’une Gelassenheit mystique, car si la leçon de la pénultième est :
laisse le vide
envahir ta vie
laisse ta vie
n’être plus que maintenant (999)
l’hésitation sur le rythme à imprimer au dernier fragment décide du sens à donner ultimement au recueil : s’agit-il de « laisser partir maintenant », employé absolument, sans complément d’objet, suggérant donc un abandon total, une remise les yeux fermés à ce destin qui joue aussi bien aux dés que le hasard, ou convient-il d’entendre « laisse partir (le) maintenant », ce qui, si la vie n’est plus que maintenant, revient à accueillir sereinement la mort (si « la vie » est « maintenant », « laisser partir maintenant » est accepter le grand départ) ?
– laisse
partir
maintenant
laisse – (1000)
Mais surtout, ce tutoiement, s’il se réfère au chant qu’est le cantique, nimbe de sacré la fin du livre. Si nous suivons le conseil de regarder le réel dans le reflet, ce Nunc dimittis rappelle qu’il est temps de partir, maintenant que l’enfance originelle, celle qui tanguait dès l’incipit, a été reconnue dans sa divinité. Partir en paix, c’est avoir enfin vu comme il fallait voir, et ce qu’il fallait voir : l’auréole, cette transposition du cercle d’or du bouclier. Il est temps de partir, en paix, « Quia viderunt oculi ». C’est aussi une façon de passer de l’autre côté de la ligne de crête, d’aller jusqu’au bout du vacillement, jusqu’à sa résolution. Et c’est enfin l’explicit du livre lui-même, la dernière page tournée sur cet ultime conseil de sagesse, sur cette bénédiction.
Vent de bout
Notre humanité fragile se dresse pour se grandir, nous prévenait le liminaire, nos vies s’obstinent à atteindre ce « qui les dépasse », s’arcboutent pour tendre vers le haut, pour se dresser comme les rochers et les pins, ou les échelles que représentent les lettres capitales de Hautes Huttes. Pourtant dès l’enfance (2) l’humain penche, s’incline, se dresse contre ce « simple coup de vent » qui l’abattra, au lieu de se laisser bercer par ce même vent, comme le suggère l’épigraphe tutélaire. Ce manque de souplesse est refus des métamorphoses, fixation obstinée, vent debout, pour éviter la mort ; ce n’est qu’une façon de fuir la vie. Mieux vaut pourtant, métaphore maritime oblige, avoir le vent en poupe que le vent de bout.
L’enfant « penché en avant », « peinant pourtant à se tenir debout » (4) est néanmoins déjà « tendu vers un ailleurs » (6), préfigurant l’image de l’adulte qu’il sera au temps des catastrophes (début de la septième section) :
Penché en avant
un homme
touche son front
on dirait qu’il va tomber (606)
Platon et Ovide l’avaient dit, ce qui distingue l’homme de la bête est qu’il se tient debout à regarder vers le ciel. Cette attitude verticale est bien celle des hautes luttes, du cavalier portant les colonnes du monde, la tête « tournée vers le ciel » (405), des titans triomphant des épreuves, défiant le divin. Le poème nous apprend toutefois à voir la beauté non dans la force mais dans sa fragilité, à l’image du frêle pin « debout contre le blanc du ciel », mais beau parce que frêle (871, 878). Parce qu’on dirait qu’il va tomber, et qu’il est penché en avant, l’homme vacille, et c’est cette fragilité qui le sauve. Encore faut-il le reconnaître. C’est cette beauté du périssable que le recueil nous apprend à voir. Il trouve significativement sa résolution dans l’humilité du Nunc dimittis : il est temps de partir, l’enfance a été reconnue pour ce qu’elle est : sacrée dans son innocence et sa vulnérabilité mêmes.
Hautes Huttes, c’est le drame d’Atlas porté par Pégase et transcendé par Syméon. La Lumière révélée, le carmen/cantique/poème chanté, l’apaisement peut venir du vertige lui-même.