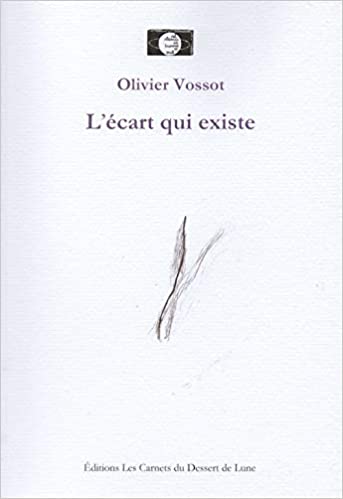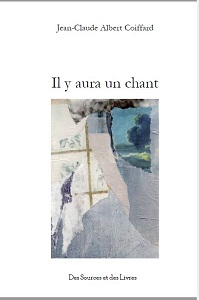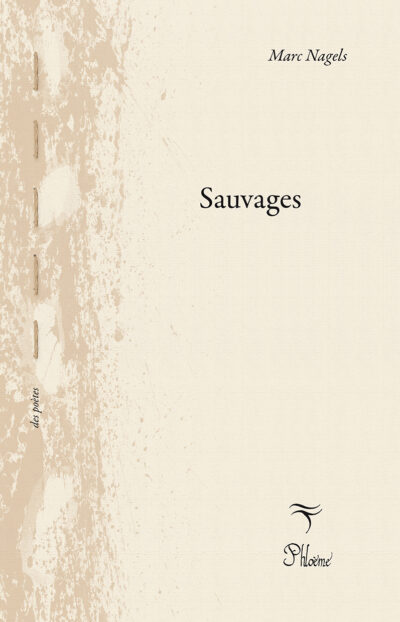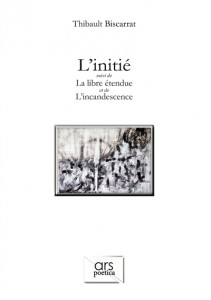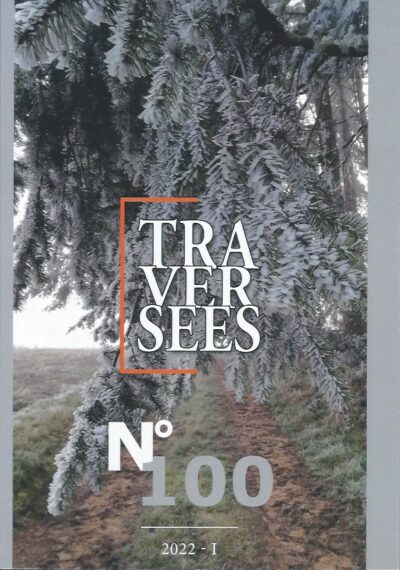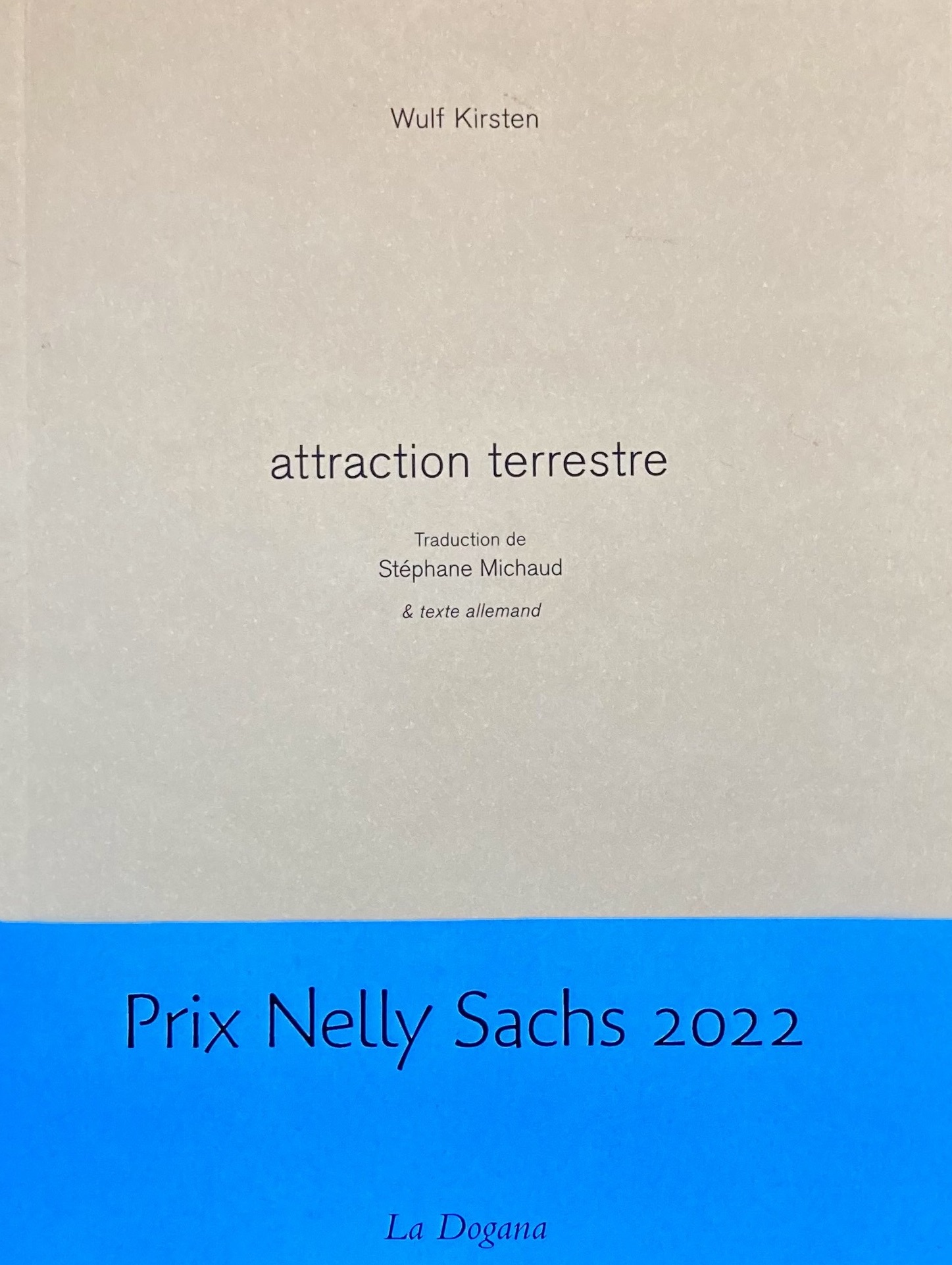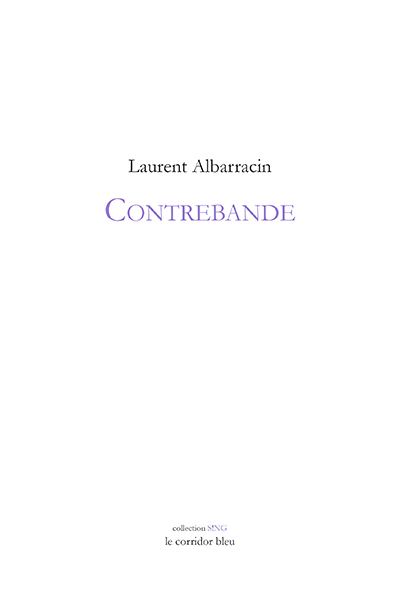Vous prendrez bien un poème ?, la feuille poétique de Françoise Vignet
La Lettre créée et gérée par Francoise Vignet « Vous prendrez bien un poème ? », circule gratuitement à un rythme hebdomadaire auprès d’un réseau d’abonnés qui ne cesse de s’élargir1.
Françoise Vignet nous a raconté l’histoire singulière de cette Lettre. Nous sommes en janvier 2011 : elle commence à partager les poèmes qu’elle aime et à les offrir à ceux qu’elle appelle "les miens", ses amis proches, amis familiaux, amis de voyages, amis voisins, et autres. Des personnes dont les modes de vie sont fort diversifiés.
Elle trouve alors dans ce projet une manière « d'étoffer son retour en poésie » et « d'inscrire le poème au fil des jours », mais aussi de briser l'isolement de la grande campagne où elle vient alors tout juste de s’installer.

Page du livre d'artiste du "Journal de mon talus" de Françoise Vignet avec une aquarelle © Claudine Goux.
Dans ce contexte, « le plus simple, le plus accessible, le moins onéreux était bien de procéder par courriel ». Mais lorsqu’une lectrice lui fait savoir qu’elle ne peut recevoir le format du fichier de la Lettre, elle opte pour un envoi en pleine page. Le poème est véritablement envoyé et pris en plein visage. Le « poème au visage », comme elle l’appelle, est « infiniment plus judicieux qu'un poème en dossier joint, que l'on ouvrirait "tranquillement", c'est-à-dire que l'on oublierait sans doute ». Et si le poème choisi ne dépasse pas une page, en principe, son auteur est diffusé pendant deux semaines, ce qui permet de découvrir sa poésie. « Mon désir, dit-elle, est bien d'adresser le poème à beaucoup, à qui veut bien l'écouter ou même le survoler ». La diversité du lectorat étant pour elle une donnée infiniment précieuse pour la vitalité de cette feuille poétique, « vitalité discrète, d'ailleurs » précise- t-elle.
Il fallait bien sûr donner un titre à cette Lettre : « Je ne voulais surtout pas d'esprit de sérieux, plutôt une invite familière, quasi-ordinaire, légère... voire plaisante ». Au départ, elle propose Vous prendrez bien un petit poème ? « pour ne pas trop effaroucher le lecteur », dit-elle, jusqu’à ce que l’un d’entre eux lui fasse remarquer que l’adjectif "petit", non seulement « minimise « le geste » du partage poétique mais plus encore ne s’adapte pas à la publication de "grands" poètes.
La Lettre est lancée. Elle diffuse des poèmes édités à compte d’éditeur ou en revue : « tous les poèmes arrivent assortis de leur référence précises, ce à quoi je tiens beaucup. Tous viennent d'ouvrages et de revues tangibles en leurs feuillets. Je refuse les inédits... cela deviendrait tout autre chose, un tout autre travail. Sauf lorsqu’un poète et lecteur reconnu me l'adresse ». Françoise Vignet est claire sur ce point, il s’agit pour elle « d’une exigence de qualité ».
Les poèmes choisis sont des « coups de cœur » : « cette feuille doit demeurer un espace de liberté, à l'abri des injonctions » précise-t-elle. « C’est le poème qui me choisit. Quitte à laisser en attente tel ou tel auteur pour lequel je serai disponible plus tard ».
Dès les premiers envois, des lecteurs réagissent, ce qui justifie alors la création d’un Courrier des lecteurs qui fonctionne depuis maintenant 11 ans. Ils encouragent le projet, le soutiennent. Ainsi, en août 2011, le poète et éditeur Gaston Puel manifeste son intérêt avec enthousiasme : « les poèmes assez courts conviennent à ces voyages que vous dirigez. Et de savoir que ces petits écrits rebondissent et repartent vers une autre destination, me paraît la meilleure amitié envers le texte. Peut-être est-ce (dans le triste terrain actuel) la plus vivante des « revues » que vous avez créée ! Le « Web » est, de plus, un excellent facteur »
Le point de vue des lecteurs est essentiel. Ils donnent leur point de vue, partagent des émotions, mais aussi transmettent des informations sur des recueils qu’ils ont particulièrement aimés, ou encore sur des actualités poétiques, ou artistiques. Une lectrice écrivait que le « poème de chaque semaine était devenu un moment très important dans son existence (son père s'acheminait vers la mort) ». Voilà qui parle » remarque Françoise Vignet « de la force que transmet le poème, de la qualité du silence intérieur qu'il crée, de l'espace respirable qu'il propose ».
Notons encore ce lecteur qui, en mars 2012, cite Philippe Jaccottet qui évoque « des espèces de voyageurs » (..) dont les « pas (sur les chemins du dehors ou du dedans) dessinent, indépendamment de toute appartenance à un groupe, et de tout programme, gratuitement, un réseau qu'on voudrait aussi invisible et aussi fertile que celui des racines dans la terre. (...) On n'en tire aucune vanité, on en parle à peine, on n'enrôle ni n'excommunie personne, on ne se croit pas autorisé à faire à personne la leçon : mais la conscience, ou le rêve de ce réseau est notre moins fragile appui. »
Très vite, les éditions Multiples, L'Arrière-Pays, la revue Friches ou encore Les Cahiers de la rue Ventura s’intéressent à l’initiative et proposent régulièrement un staff de poètes , de revuistes et d’éditeurs, qui seront eux-mêmes diffusés au fil du temps, « ce qui sensiblement va modifier le lectorat et la portée de cette Lettre ».
Suivra alors une anthologie en ligne, dont les accès sont privatifs et gratuits, de façon à ce que chacun puisse lire les poèmes antérieurement diffusées.
Et ainsi le cercle s’élargit, les poèmes circulent, la poésie « touche », appelle, traverse l’Hexagone, en dépasse les frontières (UK, USA)
Aujourd’hui la Lettre compte 142 abonnés-lecteurs, pour certains poètes.
Le carton d'anniversaire rassemble les noms des poètes diffusés ces onze dernières années. Un beau panorama qui privilégie la poésie contemporaine : Mais « les "voix" sont variées », dit-elle, « même si j’ai tendance à exclure la poésie expérimentale ».
L’essentiel n’est-il pas que le poème vibre pour le lecteur, comme une présence intense, attendue, ouverte à ce qui le déborde et l’excède. C’est peut-être même sa seule justification,
Nous n'appartenons à personne sinon au point d'or
de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous
qui tient éveillés le courage et le silence.René Char Feuillet d'Hypnos2
Notes
- Demande d’inscription à adresser à : vignetfrancoise@gmail.com
- inRené Char, Oeuvres complètes, Introduction de Jean Roudaut. Editions La Pléiade, 1983, p.176.
Image de une : page du livre d'artiste du "Journal de mon talus" de Françoise Vignet avec une aquarelle © Claudine Goux.