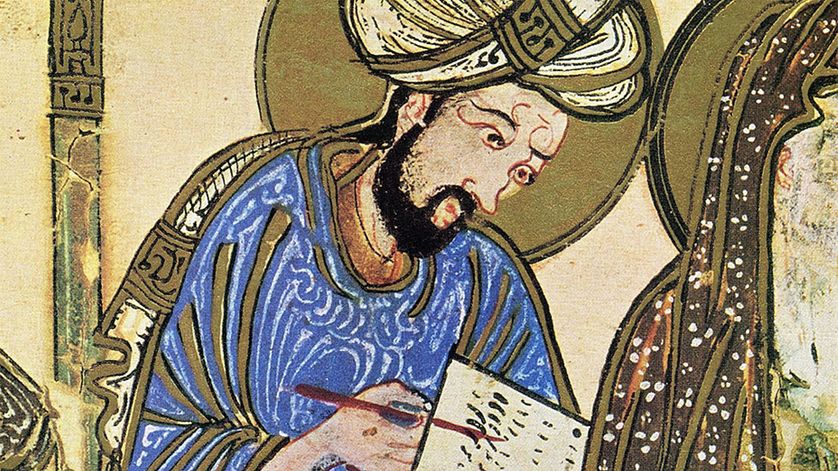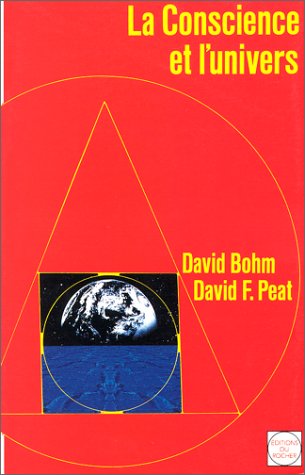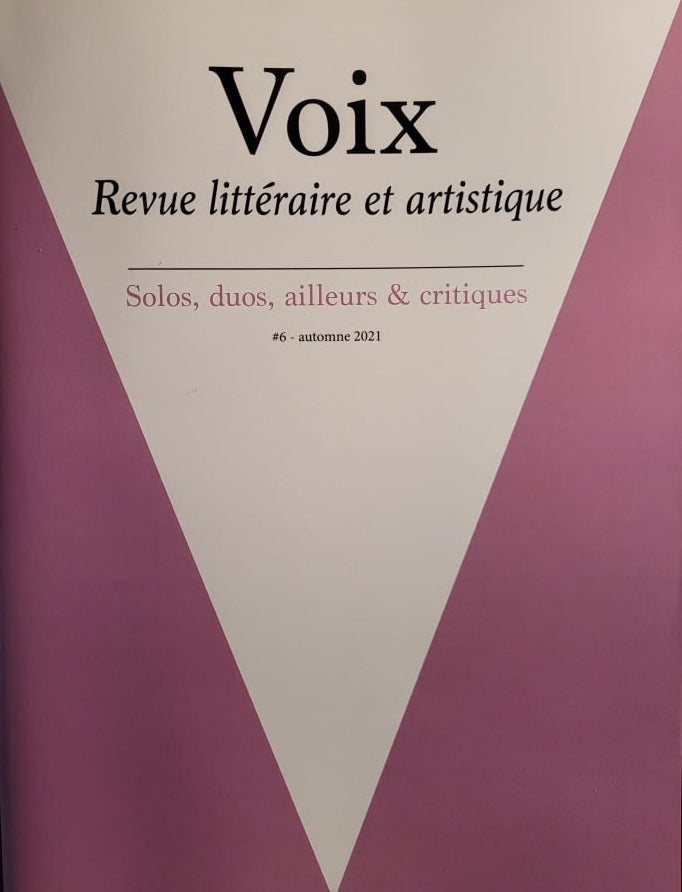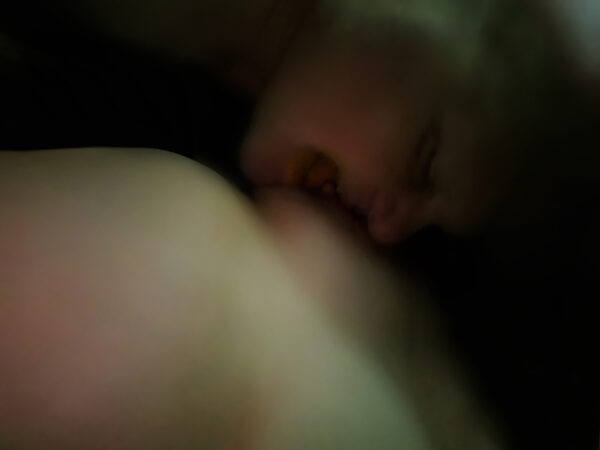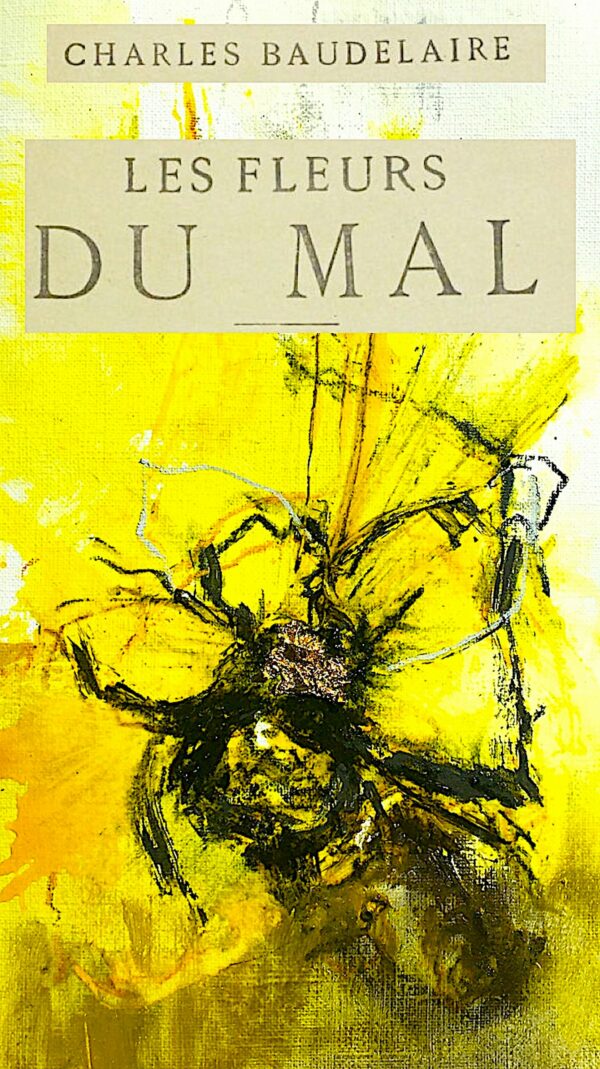À François de Boisseuil
La poésie d'Arseni Tarkovski reste peu connue dans le monde francophone. C'est pourquoi Matthieu Baumier a eu raison de signaler aux lecteurs de Recours au poème l'anthologie bilingue éditée par Christian Mouze chez fario.[i]
Ces traductions devraient permettre de rendre justice à un poète qui a su rester fidèle au "culte des mots" par quoi il a affronté les inquiétudes et les souffrances de sa vie, les sublimant par le feu de ses poèmes. Chez Arseni Tarkovski, en effet, la blancheur ne vaut que pour son "âpreté", biblique dans "Théophane le Grec", ou encore "inquiétude / Des pins noirs qui parlent" sur fond de "marasme neigeux" dans "Neige de mars". Jusqu'au bout - Christian Mouze nous en avertit dans sa Présentation - le poème est une tentative de cicatrisation : il faut toujours recommencer, reprendre un même texte parfois des années durant ; l'écriture est une lutte, un mouvement qui n'est jamais uniforme, jamais unidimensionnel. Arseni Tarkovski a découvert qu'au cœur des rigueurs et frimas de la matière émerge "l'âme", "le ciel" ; que le temps, par conséquent, est traversé par la possibilité de l'immortalité, une forme d'infini.
"J'ai assez d'immortalité
Pour que mon sang coule d'un siècle l'autre ;
Et un bon coin de bonne chaleur,
Je le paierais volontiers de ma vie,
Pourvu que mon aiguille ailée
Ne me conduise comme un fil
Par le monde."
Parole de loup des steppes, grand galop du guerrier.[ii] Mais il ne nous apporte pas la mort, le poète, de toute sa fougue il s'écrie : "Vie, Vie !"
On le pressent, ne lire Arseni Tarkovski qu'en le subordonnant à la cinématographie de son fils Andrei serait dommageable. Trop souvent, dès qu'il est question de ces deux-là, le célèbre adage Le fils est le secret du père nous hypnotise, nous empêchant de penser véritablement la portée et la profondeur du lien qui peut les unir. Tout regard croisé sur les films de l'un et les poèmes de l'autre doit pourtant s'en tenir à ce fait : ni le cinéaste ni le poète n'ont eu la faiblesse d'hybrider leur art avec celui de l'autre. Andrei Tarkovski est on ne peut plus clair : il a toujours considéré que le matériau du cinéaste était le temps concrétisé, factuel, des objets, autrement dit les objets comme véhicules d'une pression ou d'un flux temporels s'écoulant dans le plan[iii]. Pour sa part, le poète à l'œuvre se frotte aux mots. Célébrant la peinture de Van Gogh[iv], Arseni Tarkovski réaffirme son engagement à porter le "fardeau" du "verbe". Dans le superbe "Daghestan", il questionne certes son audace, ou son rêve, ou sa lubie, ou encore sa naïveté d'alchimiste du mot[v] ; jamais pourtant il ne reniera sa voie car sa folie offre un extraordinaire champ de batailles à explorer. De sorte qu'Arseni apparaît plutôt comme le père bavard dont la parole est radicalement remise en cause par Petit Garçon, son fils, dans l'ultime plan du Sacrifice.
Si Andrei Tarkovski accorde la part belle aux poèmes de son père dans ses films, ce n'est donc ni par admiration béate ni pour faire éclater une sorte de continuité entre les mots du poème et les objets du plan. Les deux artistes se mesurent, ils se confrontent : preuve encore que si un rapprochement doit être fait entre les deux œuvres, c'est dans le secret d'un antagonisme où chacune, résistant à la force de l'autre, veut affirmer sa souveraineté sur elle-même.
°
Quelle est la valeur, quelle est la vertu du mot chez Arseni Tarkovski ?
Le lecteur de "Papillon dans un jardin d'hôpital" retrouve cette intuition première que le verbe, pour abstrait qu'il soit en comparaison du fait enregistré par la caméra, n'est pas détaché de la perception corporelle. Il la prolonge, la modalise sans la modéliser. "Sorti de l'ombre et à travers la lumière", le nom conserve l'effet magique du papillon qui passe, poudre restée sur le bout non pas des doigts, mais de la langue. Alors que le poète soldat vient d'être amputé, alors qu'il broie du noir dans la blancheur de l'hôpital, le papillon surgit et repart, fugitif, pour la lointaine Cathay. Demeure "babochka"[vi] : les couleurs émanent des voyelles, comme du clignement des yeux, et avec elles un sentiment où se mêlent la "paix", mais aussi le désir et la crainte. Bien plus, le papillon aperçu est insaisissable en tant qu'objet :
"Il vole, fait la révérence."
Sans ce mouvement point de poème car c'est en lui que le papillon et "babochka" viennent confluer : la prosodie ciselée d'Arseni Tarkovski est devenue volètement. Réciproquement, sans la versification par quoi le mot se met à papilloter, pas de relation avec ce que le corps aperçoit. C'est bien tout d'abord par cette puissance d'animation que certains mots trouvent la faveur du poète, à commencer par certains noms propres : "Elabouga", "Marina", "Anna Akhmatova" (et ses "A glacés"), "Ivan" (et son saule au miroitement fascinant, "Ivanova iva")...
Mais lire Arseni Tarkovski, c'est approfondir le sens de cette animation : mise en mouvement, mais aussi découverte de l'âme immortelle des choses.
Une telle écriture doit en fait toute son énergie spirituelle à la violence d'un choc, d'un ébranlement. On trouvera difficilement un texte qui ne soit qu'une méditation calme sur fond de ciel monochrome. La relation fondatrice du poème au monde repose sur la perturbation. Lorsque le chant se laisse trop aller, explique "L'Avenir seul", lorsque la puissance lyrique s'abandonne aux "aises" d'un "travail peu compliqué", quelque chose menace de se figer[vii]. Il faut l'irruption intempestive d'un autre "locataire" pour que prolifère une foule intérieure, pour que s'ouvre un chantier colossal scarifiant "la peau tubéreuse de la terre". En sa catastrophe, le poème se fait louange de la pointe de lance :
"L'aigle de la steppe y nettoie ses vieilles plumes".
Paraphrasant un autre vers, nous dirions volontiers que c'est la voix du "vieil honneur guerrier qui parle".[viii]
Martiale, elle file fermement, sans mollesse, tendue par la menace effective de la mort. Le cavalier ne cesse d'être heurté par "la plume d'Azraël" :
"Les ronces fumaient, le grillon faisait des siennes,
Et grattant de ses moustaches les fers de mon cheval,
Il prophétisait
Et me menaçait de mort comme un moine."[ix]
Mais le poète n'a pas peur, en tout cas il s'offre à l'agôn, à la joute[x]. Face à la mort, il ne se soumet pas à quelque crainte religieuse, il rend coup pour coup. C'est pourquoi l'élan poétique de "Vie, Vie" débute avec cette audace aux accents iconoclastes :
"Je ne crois pas aux augures
Et je n'ai pas peur des signes."
Ce qu'Arseni Tarkovski livre ici à ses lecteurs (au premier rang desquels figure son fils Andrei), c'est l'intuition qu'au commencement n'était pas le verbe, mais la vivacité, la vitalité d'une action périlleuse, pour tout dire un culot, celui-là même qu'aura le jeune fondeur de cloches qui n'avait jamais fondu de cloches. Et s'il devait y avoir un mot, alors, oui, ce serait le célèbre "Davaïe", ce cri d'allant qui accompagne tout soulèvement, toute surrection de la matière.[xi] Il faudrait retraduire la formule de Jean, faire comprendre qu'à l'initiative, il n'y a rien que le tranchant de la décision ; que si silence il peut y avoir dans la parole poétique, c'est à l'initiale crue de toute décision. Et que l'intensité du combat perpétuel entre le guerrier et la mort oblige à appréhender le temps comme un infini sans commencement (ni fin).
A cet égard, le poème intitulé "Le Timbre" donne l'un des résumés les plus vigoureux de la vision du poète-combattant. C'est un coup de tonnerre illuminant l'extra-lucidité de sa propre conscience. Le soldat "téléphoniste" est à l'agonie : comment pourrait-il survivre à la pluie de balles ou d'obus qui s'abat sur lui ? Déjà la "terre" retournée et pulvérisée du cataclysme l'ensevelit. Mais toujours mû par son instinct de vie acharné, il a suffisamment de force pour lancer :
"Je suis immortel tant que je ne suis pas mort."
Ici, au bord de l'entaille, enfouie dans les entrailles du "corps mitraillé" mêlé aux éléments et juste sur le point de devenir charpie, l'âme se dresse. C'est sous le coup d'une déflagration qu'elle peut filer à travers les séparations du temps ; le téléphoniste détient le secret, protégé "contre son ceinturon" : les "câbles", les "racines" où "grandit" l'onde puissante qui souffle les murs érigés entre le passé (mort) et l'avenir ("Tous ceux qui ne sont pas encore nés"). En devenant agônistique, le présent "déchire" l'espace-temps, qui s'ouvre infiniment. Et pour faire vibrer le timbre de la terre, faire retentir bien haut la "lyre" de son cœur "électronique"[xii], les mots du poème doivent exprimer "l'âpreté" des batailles. C'est à ce prix que l'âme pourra circuler librement dans le temps, unissant les morts aux vivants, les existants aux non-existants. Ce n'est donc pas une sagesse confortablement tranquille qui conduit à cette Révélation selon laquelle, dans "Vie, Vie",
"Il n'y a que le réel et la lumière".
Elle naît au contraire d'un combat intérieur titanesque et dangereux, d'un parcours dans les chaos de l'Être :
"J'ai mesuré le temps avec la chaîne d'arpentage
Et je l'ai traversé comme on traverse l'Oural".
L'immortalité est arrachée, mais au péril de la vie. Tel est le grand paradoxe que soutient la poésie d'Arseni Tarkovski.
Le pouvoir de ses mots tient à la fois à l'unité qu'ils entretiennent avec la terre, dans le mouvement qu'ils ont en partage, et à la fois au combat vigoureux avec elle - cette nature brutale dont ils sont la graine et le fruit. Le poète ne s'abandonne pas à la terre, il s'offre à elle pour l'empoignade ardente, pour amorcer l'explosion, la fission d'où émerge une âme. Arseni Tarkovski joute avec l'arme des mots non pas pour nier la mort, mais pour lui faire face. Nulle complaisance au malheur ni à la souffrance : trop fier, trop farouche, le cavalier bande l'arc de son poème, y fait surgir la vie immortelle, le temps infini au cœur de la matière.
°
Cette façon de vivre l'écriture n'est pas compatible avec une transposition facile à la cinématographie. La puissance artistique qu'elle recèle impose d'éviter quelques erreurs. Et en premier lieu de se tenir à bonne distance du "complexe de la momie"[xiii]. Un film comme Le Testament d'Orphée permet de comprendre tout ce qui éloigne un Cocteau, par exemple, des deux Tarkovski. Le personnage de Cocteau ne lutte pas : de manière somme toute assez agressive (et légère ), il se fait volontairement donner la mort. Mais c'est parce qu'au fond, à ce qu'il pense, "les poètes ne meurent jamais". Au contraire, la poésie d'Arseni Tarkovski est pleine de poètes bel et bien morts et enterrés.
"Sans aucune immortalité, triviale
Et nue se tenait la mort, la seule mort"
constate-t-il au début du tombeau de N. A. Zabolotski.[xiv] Si l'adversaire n'existe pas, pas d'agôn. Pour Cocteau, qui est conséquent, s'ensuit une errance dans une "zone" indépendante des lois de notre espace-temps. Il n'est pas vraiment vivant, pas plus qu'il n'est vraiment mort : il porte les grands yeux de papier de la momie, enveloppé sans doute dans les bandelettes de celluloïd du film qui, à jamais, lui sert de véhicule. Ontologie mortifère en ce qu'elle valorise l'illusion, la fiction divertissante (éloignant des rives de la vie et de la mort) et mise, quoi qu'elle en dise, sur la culture du spectaculaire et de la spéculation, dont il est au moins légitime de se demander aujourd'hui si elle favorise les forces spirituelles de la terre[xv]...
Andrei Tarkovski ne s'y trompe pas. Lecteur admiratif de son père, certes, mais fidèle à son amour des "faits", des "objets", il a su en filmer la transparence primordiale, à travers laquelle nous pouvoir voir couler le temps. Mais ce n'est pas à nous d'imposer ici notre regard sur son cinéma. Vous aurez la liberté et le plaisir, lecteurs, de reconnaître comment le fils, à partir de sa révolte radicale contre le fardeau du Verbe[xvi], parvient à sculpter les images finies où se glisse l'infini qui hante tout homme, toute femme qui fait un effort authentique pour se plonger dans les profondeurs de l'existence. Disons simplement qu'à la question presque enfantine de savoir si les objets ont une âme, les films d'Andrei Tarkovski répondent oui. Et que les âmes qui débouchent la bouteille extra-lucide du temps en la traversant sont là, sensibles à l'œil de la caméra. Quoique invisibles le plus souvent, elles peuplent le vide des pièces que nous habitons[xvii], peut-être même sont-elles déjà en nous, devenues nous. Et, à n'en plus douter, le facteur Otto est véridique : écoutez ses histoires et voyez... Il a vraiment été bousculé par un fantôme...
"Quand je vis le bruit sourd incarné
Même les ailes crayeuses s'animaient,
Cela me fut révélé : j'enjambais ma vie
Mais mon exploit n'était encore qu'un passage".[xviii]
[ii] Arseni Tarkovski, L'Avenir seul, p. 115 (sans autre précision, toutes les paginations renvoient à l'édition Fario)
[iii] Andrei Tarkovski, " Fixer le temps" in Le Temps scellé (Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma)
[vi] Les quelques transcriptions du russe données ici ne sont pas savantes.
[ix] Cf "Vie, Vie", p. 115
[x] Nietzche fait allusion à l'agôn de la Grèce antique dans un opuscule de 1872, "La Joute chez Homère", repris dans La Philosophie à l'époque tragique des Grecs (Gallimard, folio essais, p.196 sq.). Le texte étant l'ébauche d'une "préface à un livre qui n'a jamais été écrit", la notion reste disponible et laïque, contrairement à celles de djihâd ou tapas.
[xi] La séquence à laquelle il est fait allusion se trouve dans Andrei Tarkovski, Andrei Roublev (1966)
[xiii] L'expression vient d'André Bazin, "Ontologie de l'image photographique" dans Qu'est-ce que le cinéma ? (Édition cerf/corlet)
[xiv] Cf "Le Tombeau du poète" (p. 76-77)
[xv] L'image d'eux-mêmes vendue par les écrivains médiatiques, son rôle et la prévalence du personnage sur la puissance lyrique doivent devenir un objet de la plus rigoureuse critique.
[xvi] Cf la séquence d'ouverture du Miroir (1974), où l'adolescent bègue se bat pour parler. Ce sera par le cinéma...
[xvii] Cf Le Sacrifice (1986). Andrei Tarkovski filme tous les souffles qui circulent dans la maison.
[xviii] Cf "Théophane le Grec" p. 142-143