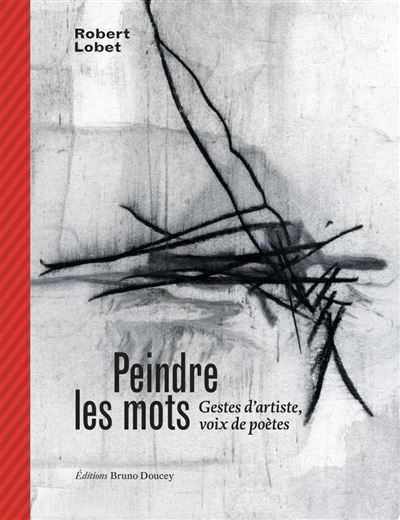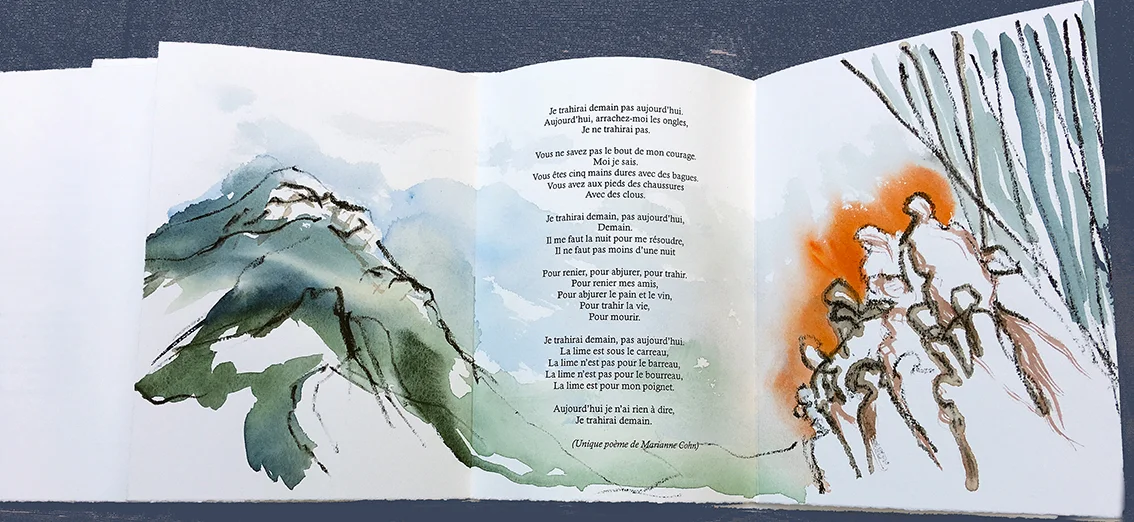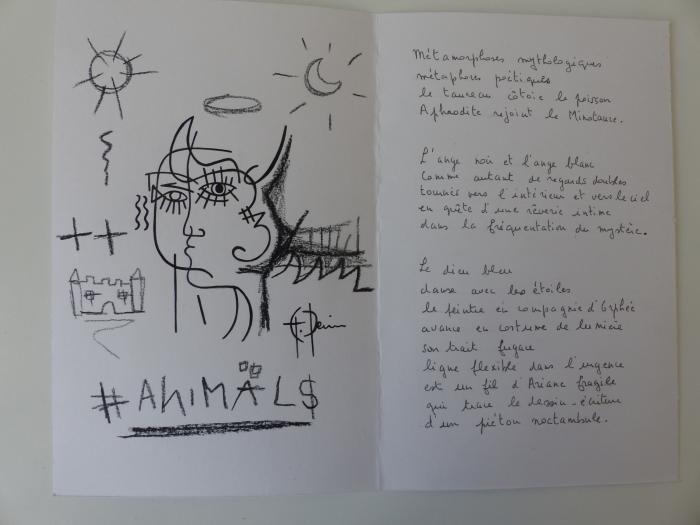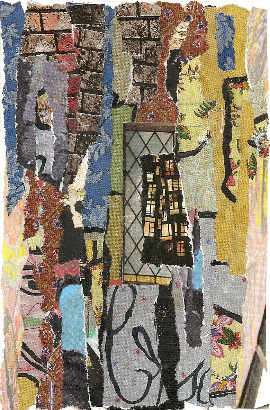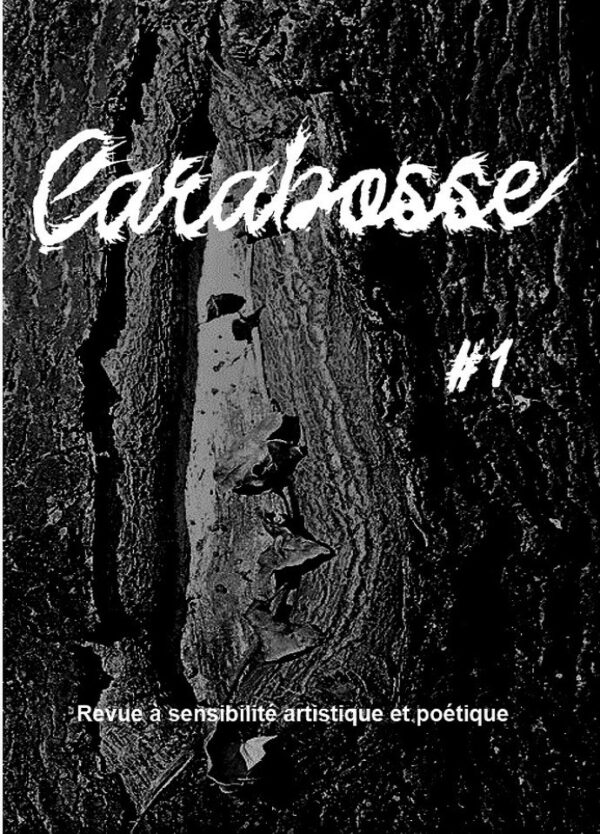Aytekin Karaçoban, Ce que Orphée contemporain disait lorsqu’il réparait sa lyre cassée
Ce que tu as été
Je ne voulais pas grand-chose.
Tu as été la gomme magique qui a effacé
de toutes mes photos
la peur sur le visage de mon enfance ;
tu as été, autant que possible,
au tournant de chaque voie qui s'ouvrait à nous,
la réponse à mon appel
qui était l’héritier de la recherche d'une autre langue.
Tu as été mon phare,
avec une autre analogie
gardien des navires ;
ma peur de heurter les rochers a disparu.
Tu as été mon aube
que j'ai retirée de ma nuit,
que j'ai placée dans mon horizon.
Tu as été la forme,
couverture de mon contenu.
Tu as été ma ligne de haute tension,
transmettant le courant de sa langue à la mienne
dans mon univers humain
avec ses steppes, ses sommets, ses vallées.
Tu as été mon cours d’eau qui songeait d'aller
aux grappes d'étoiles sur les branches
avec le talisman de l'abondance
quand il tombait en cascade avec des applaudissements.
Je n’avais rien demandé de tout cela
sauf que tu ne sois pas mon bourreau.
Pourquoi
Pourquoi mon désir s’accroit-il,
juste au moment de tailler la vigne,
d'apprendre au temps de t'écrire,
de déployer un chemin de rêves sous ses pieds
pour qu'il apprenne aussi
à ne pas se contenter seulement
de sa science de traverser le réel ?
Pourquoi pas,
par exemple,
juste au moment où je glisse ma voiture
entre deux lignes dans le parking
ou bien au moment où je saisis le sourire forcé
de la vendeuse chez le boulanger ?
Pourquoi fondent les notes,
se tendent les voix
les heures deviennent lierres
dont les fibres tressent des cordes
quand j'attends une mélodie valable
de l'opéra à trois sous de la vie ?
Pourquoi l’envie de me mesurer avec l’ouragan de la foule,
de courir en hurlant se mêle-t-elle dans l’affaire
juste au moment où mon pied glisse sur la marche
et pourquoi pas
quand je regarde en colère dans mon fauteuil moelleux
les canons à eau déployés en plein hiver
pour repousser des migrants
qui tentent de traverser la frontière ?
Je fais semblant comme si ces heures n'existaient pas
comme si tu n’étais pas
mon abri,
mon refuge,
mon sauveur
juste au moment où mon pied touche le sol.
Ma mémoire devient l’attrape-guêpe.
Partout le brouillard.
Parle
Tu dois parler de quelque chose ;
parle que
je puisse te faire naître.
Par exemple, parle du champ marin à Zanzibar
où des femmes cueillent des algues,
parle, si tu veux, d’une femme
qui prépare le repas à cinq doigts au Kirghizistan
que je devienne le capitaine sur terre
du navire qui y va.
Parle de ton désespoir
quand la corde d'une turbulence de sens
passe soudain autour du cou de tes mots,
parle du mistral qui piétine les herbes du verbe
là où ton œil touche,
parle d’un pianiste maladroit
qui étrangle le clair de lune
dans la nuit des sonates.
Parle si tu veux de ton sommeil,
de ce puits plein de cauchemars ;
parle que
j’invente des histoires,
contre le lever du jour.
Parle de ta colère
car l'homme vole l'avenir de l'homme,
il rend étroit le monde pour lui aussi.
Tu dois parler de quelque chose
par exemple,
de charrue qui décore le jardin
ou du lancement d’un ticket de métro au Chili
comme un poids de boulet de canon
contre la figure de l’Etat.
Tu dois parler de quelque chose ;
parle que
je te fasse germer dans le sillon de la langue.
Nous trouverons
Nous trouverons un nouveau langage,
comme le vent habille les branches
au-delà des limites du silence
couvrant nos rêves de son souffle.
Un nouveau langage
qui ajoute des valeurs inconnues
à l’équation de l'homme.
Un langage comme un faucon qui monte
dès que tu détaches la ficelle de ses griffes
pour inscrire sur ses plumes ce qu’il voit du haut.
Nous trouverons un nouveau langage
qui nous apprend à lire le monde
à dépoussiérer le temps,
à le polir,
à savoir comment un soupir résume
la grandeur d'un regret.
Nous trouverons, nous trouverons un nouveau langage
pareil à la corde qui relie à nos flancs
une note au-delà des notes,
une dimension au-delà des dimensions.
Un langage
qui à l'ombre de nos sens
exprime les uns après les autres
les mains ardentes des flammes,
les secousses des rivières,
sans brûler,
sans détruire.
Généreux de son sourire,
réveillant de son toucher,
un langage que nous donnerons une voix ;
n'aie pas peur, personne ne le supprimera.
Nous le trouverons.
Entre les murs
Par où commencer ce poème
alors que je consacre au feu tout ce que je sais
sur l'autel où j'écris l'avenir ?
Sont érigés des gratte-ciels du capital
comme des couteaux qui creusent ma blessure
De là vient le rhinocéros de la colère
pour aiguiser sa corne dans mon squelette.
Le monde qui m'est promis
est un jeu d'ombres dans la lanterne magique.
Seuls des murs autour de moi.
Par où commencer ce poème ?
Est-ce par mordre en pleines dents la chair d'une belle journée
en regardant le sang de la mer,
en écoutant son cœur bleu couler dans nos veines ?
Même si nous ne connaissons pas le sens de tous ses mots,
Entre temps, nos mains trouvent-elles quelque chose à se dire ?
Est-ce le seul moyen de casser les ciseaux des distances
pour qu'ils ne coupent pas mes élans vers toi ?
Le remplit-on enfin du sens d'une phrase ?
un vide que la journée laisserait ?
Pas de mer quand tous mes sens sont en éveil
pas de cœur bleu
pas de mots, pas de dictionnaire,
nous n'avons pas de mains
Seuls les murs autour de moi.
Si je commence par dire « tu », une rivière folle,
cette couvée des phosphorescences broyées
me remplit, cogne contre mes parois.
Là, tu es la lumière rouge,
l’impasse,
l’horizon qui s’éloigne,
la faim blessée,
la tour renversée,
l’animal civilisé,
le vrai mensonge,
le poignard incrusté de sang,
l’univers à trou noir,
la baguette à double tranchant,
le mal de tête,
la gâchette tendue,
la pensée à pou
et moi j’écris un poème pour toi
dans le temps que je dérobe aux murs.
Par où commencer ce poème ?
Tous mes sens sont en éveil.
Seuls les murs autour de moi.