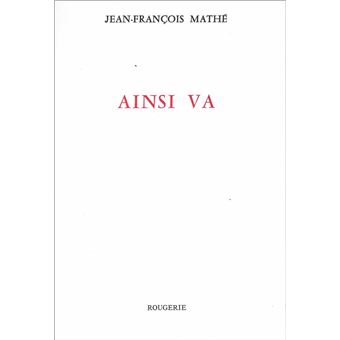Angèle Paoli, Le dernier rêve de Patinir
Cet ouvrage d’Angèle Paoli se consacre au peintre flamand Joachim Patinir (1483-1524) et à six de ses tableaux, conservés dans différents musées d’Europe. Paysage avec Saint Jérôme au Prado, Saint Jérôme dans le désert au Louvre, Le Passage du Styx au Prado, Paysage avec Saint Christophe à l’Escurial, au Paysage avec Saint Christophe portant l’Enfant Jésus peint avec son ami Quentin Metsys au musée de Flandres de Cassel, Paysage avec incendie de Sodome et Gomorrhe au musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, Le repos pendant la fuite en Égypte, au Prado. Il faut entrer lentement dans le livre à la fois simple et ardu. Le livre écrit tantôt en vers, tantôt dans une prose libre, étonne par l’originalité de son approche.
Il ne s’agit pas ici de mener des analyses savantes ou des commentaires spéculatifs mais bien de se situer au cœur de l’intériorité des personnages. L’ermite Jérôme, le saint porteur de l’Enfant, le peintre Patinir, Joseph parlent et rêvent – la dimension onirique, comme souvent chez Angèle Paoli, traverse tout le livre. Les personnages sont dotés d’une voix propre qui n’est pas sans entrer en profonde osmose avec celle de la poète elle-même. Et, plus que jamais le terme de recueil prend ici son double sens de recueillement sur fond de silence propice à la méditation, à la poésie.
La composition en dix chapitres est extrêmement travaillée. Nous partons dans le premier chapitre vers un lointain appelé « Chalchis », magie du « nom de désert ancien » où s’exile Jérôme pour « méditer ». Répété à plusieurs reprises, le mot pourrait concerner tous les personnages du recueil qui sont de vrais solitaires et qui, chacun à leur façon, pratiquent une forme d’exercice spirituel.
Chalchis ad belum
ainsi la nomme Pline
l’historienQuelque part
avant de filer plein Sud
vers Palmyre
la majestueuse
ses oasis
légendaires.
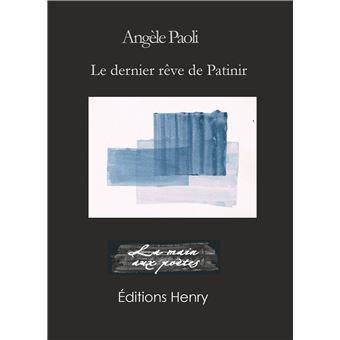
Angèle Paoli, Le dernier rêve de Patinir, éditions Henry, 120 pages, 10€.
Puis nous voici devant la hutte de Jérôme, au sein du paysage dans l’art duquel Patinir est passé maître. Rochers, falaises, ânes et chèvres sont là, imaginés par le peintre qui a peu voyagé et les peint d’après sa Flandre natale et la Meuse. « le désert rêvé / se fond en des paysages visionnaires/nimbés de bleu ».
Dans « Diptyque I », c’est la poète qui parle et évoque le paysage, le lion soigné par l’ermite Jérôme et sa vocation. Dépouillement, simplicité voulue et « dialogue avec le silence ». Ce silence est une dimension dans laquelle baigne tout le recueil. Jérôme, Christophe, Joseph, Patinir, la poète se parlent à eux-mêmes, non à autrui, et sur fond de silence. Dans une tessiture entre solitude et silence.
Puis, dans « Diptyque II », le peintre Patinir se livre à un monologue intérieur en prose autour de son œuvre Saint Jérôme dans le désert. Par-delà le paysage de montagne, c’est la tension entre la vie mondaine, dans le siècle, et la vie monastique qu’il livre ici : « Quel diable de dialogue se joue ici, sur les devants de la scène entre la dépouille cardinalice, évidée du corps auquel elle est destinée, et le modeste brun de bure qu’a revêtu l’ermite ? ». Patinir ne manque pas de mentionner la gamme chromatique de ses bleus qui est la marque originale de ses toiles.
Le chapitre « Styx » se consacre au thème de la traversée de l’âme, qui transite, emmenée par « Charon le nautonier de légende ». Est-ce la petite âme anonyme, la nôtre ou celle de la poète ? Ce chapitre en vers tient de l’examen de conscience sur la vie passée, ses illusions, ses amours, ses regrets. À l’heure de la mort la voix du poème se tourne vers la profondeur de l’être :
Longtemps tu t’es cru immortel
au-dessus de tout soupçon
indifférent au temps qui passe
à la maladie qui arrache des pleurs
Le Styx et l’Eden, la mythologie antique et l’Histoire sainte se fondent en des réseaux possibles d’images qui dessinent la quête spirituelle. Le chapitre « Christophe, Diptyque I » donne à entendre la voix du saint qui, en un flux de conscience en prose, fait retour sur lui-même. Sur sa laideur d’homme cynocéphale et sa stature de géant. Sur sa métamorphose qui le fait passer du Réprouvé au Christophore de la Légende dorée. L’évocation de son bâton et d’autres symboles projette la lueur sacrée du tableau conservé à l’Escurial. Dans le chapitre « Christophe, Diptyque II », consacré cette fois à une œuvre commune de Patinir avec Quentin Metsys, le saint poursuit son questionnement mystique à propos de ce Jésus enfant qu’il transporte :
« Suis-je son berger ou est-ce lui qui me conduit jusqu’où ? ».
Avec le chapitre « Incendie », Angèle Paoli noue en une superbe surimpression l’incendie de Sodome et Gomorrhe et celui de la ville de Patinir, Dinant incendiée par Charles Le Téméraire. Vers et prose se mêlent dans ce poignant monologue de Patinir qui revient en pensée à sa ville, son enfance, à son père :
En huit jours le Téméraire
avait eu raison de la ville […] la ville fut rasée
mon père disparut
pour ne réapparaître
que bien des années
plus tard
plus muet qu’une tombe
Vient ensuite le chapitre « Intermède », Jérôme médite, rêve, explore, déchiffre, son lion paisible à ses côtés. Son rêve l’emporte vers la guerre et la folie meurtrière des hommes. Il est clair que l’on reconnaît ici, comme dans tout le recueil, l’aspiration au questionnement intérieur d’Angèle Paoli. Chez elle, également, les résonances s’orientent vers la spiritualité. Et son regard ne cesse de se mêler à celui du peintre dans le sentiment d’une proximité hors du temps.
Le chapitre « Le rêve de Joseph », autour du tableau Le repos pendant la fuite en Égypte, ainsi que le dernier chapitre « Le dernier rêve de Patinir » laissent place au peintre qui rêve. Défilent ainsi l’exil en Égypte, le meurtre des enfants innocents sur ordre d’Hérode, la Vierge qui allaite « perdue dans ses songes », elle aussi. Un magnifique mouvement emporte ensemble le paysage de Bethléem et celui de « la Meuse originelle » cher à Patinir. Le recueil se clôt sur le songe de Patinir à l’agonie : « Où suis-je ? en Judée à Dinant à Anvers ? ». En ce puissant moment d’onirisme, Patinir convoque son portrait réalisé par Metsys, la Vierge, le désert de Syrie, la Meuse, les soldats romains, les bois des Flandres, « saint Jérôme quelque part sous les branchages », le géant Christophe. C’est la dimension de ce « paysage-monde à portée de pinceau » que requièrent les ultimes moments de la mort du peintre. Patinir entouré de ses créations, de ses créatures s’éteint dans un dernier souffle, se rappelant ce vers d’un poème latin, tiré de l’Histoire Auguste, écrit par l’empereur Hadrien au moment de mourir. « anima vagula blandula ». Le destin de cette « pauvre petite âme perdue », évoqué par Marguerite Yourcenar dans Mémoires d’Hadrien et qui nous renvoie à notre lot à tous, à « la forme entière de l’humaine condition ».
Au bout du compte de ce récit-poème, Angèle Paoli, contemplatrice passionnée, épouse au plus près les paysages et le « je » des personnages du maître flamand. Elle pénètre leurs pensées, leurs questionnements. Elle glisse de l’une à l’autre de ces incarnations avec qui elle est en grande connivence. Au point qu’à certains moments ne sachant plus qui parle, d’elle ou de l’un d’eux, nous retrouvons le merveilleux repère qu’est l’inoubliable bleu du peintre qui ponctue tout le recueil. Avec Le dernier rêve de Patinir, Angèle Paoli, gagnée par le chant intérieur que ses toiles font monter en elle, se laisse remarquablement habiter par le peintre.