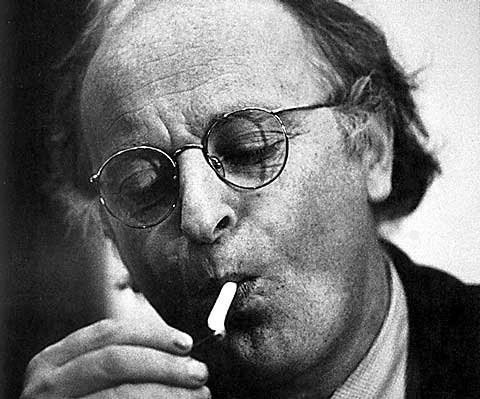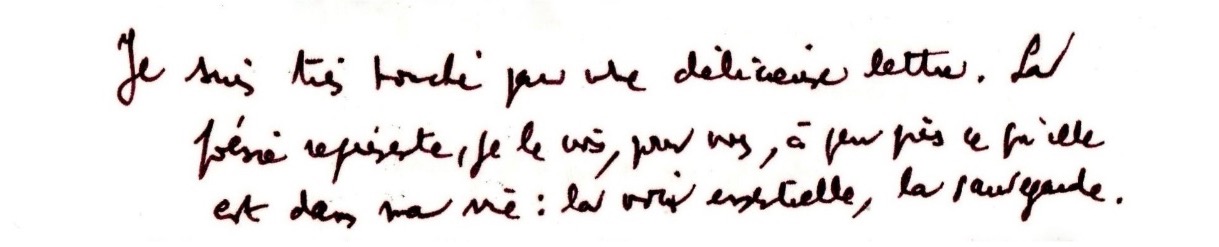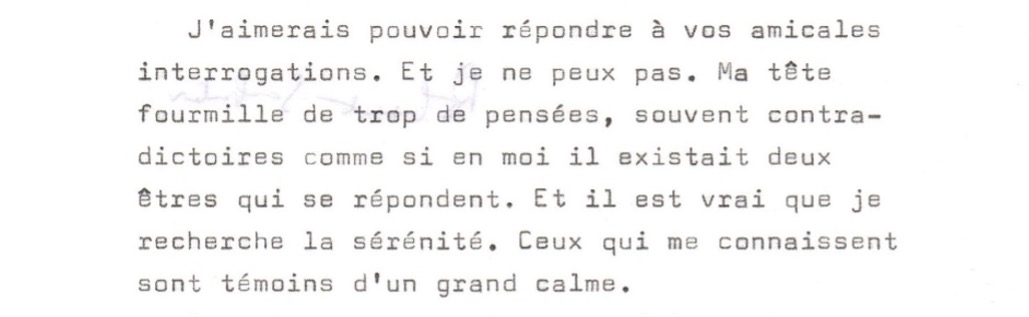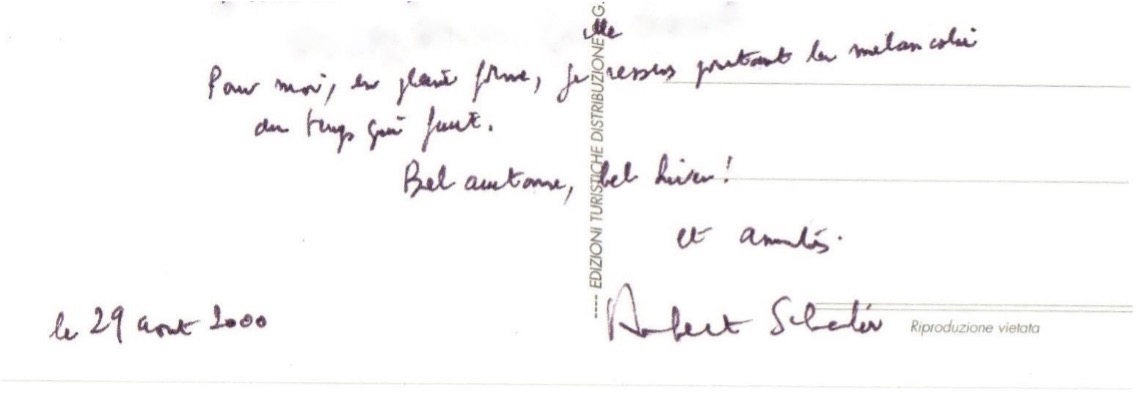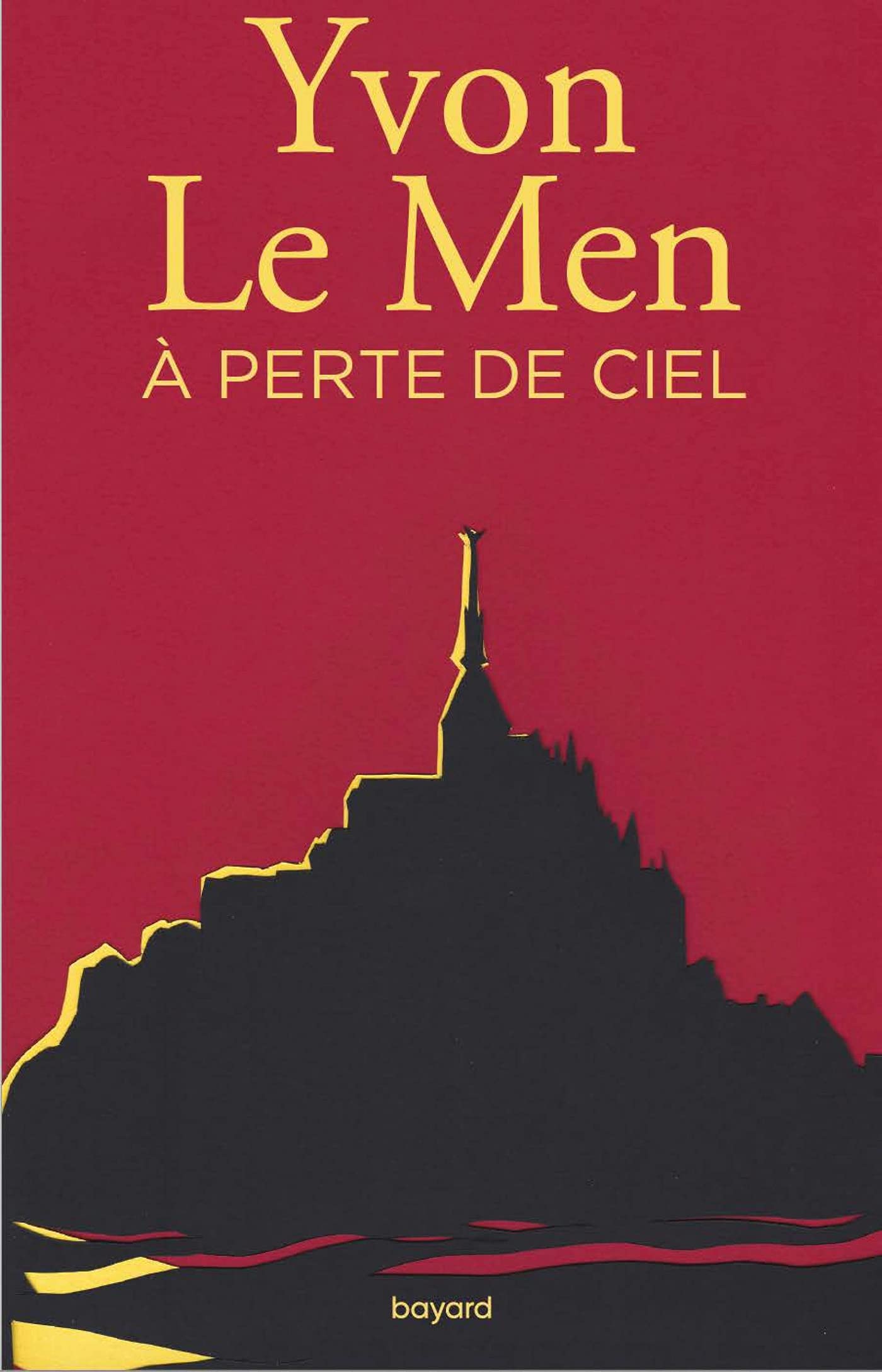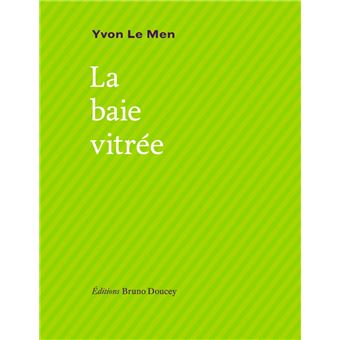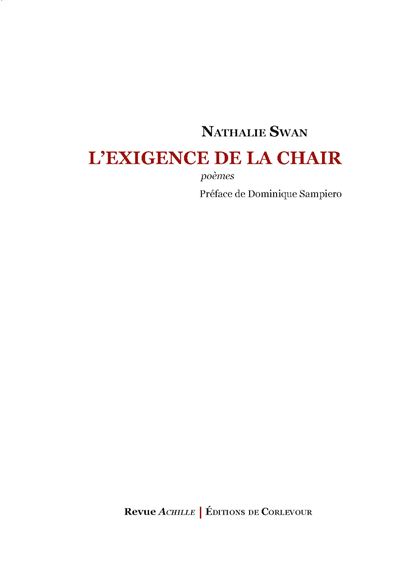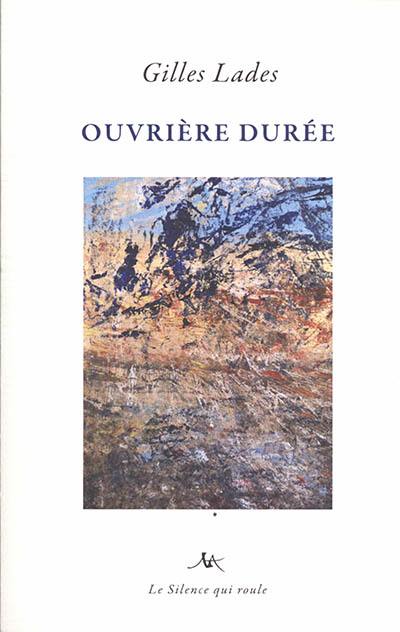Mircea Dan Duta — Corporalités (extraits)
Polyglotte et polygraphe, Mircea Dan Duta est un poète, poète roumain d’expression tchèque, né le 27 mai 1967 à Bucarest. Il est aussi critique de film, et traducteur - en tchèque et slovaque, et de français et d’anglais : parmi les auteurs qu’il a traduits, on peut citer Václav Havel, Arnošt Lustig ou Jáchym Topol. Son œuvre personnelle a été traduite en plus de 20 langues, il est publié dans des anthologies aux USA, au Royaume Uni, en France, Espagne, Mexique, Mongolie, Inde, Bangladesh, Roumanie,, Moldavie, Hongrie, Bulgarie, Serbie, Indonésie, Pérou etc. et bien-sûr en Slovaquie et en Tchéquie. Enfin organisateur et producteur de programmes culturels, j’ai pu le rencontrer de façon virtuelle durant la pandémie, où les échanges via zoom ont permis de maintenir le contact avec la création et le monde extérieur.
C’est de ce monde extérieur que nous parlent les poèmes de Corporalité dont nous publions un extrait – un monde extérieur observé avec la fantaisie d’un regard décalé, qui en fait une indéchiffrable énigme. Autant que la pomme qui ouvre et clôt la sélection – pomme du jardin perdu d’Eden devenue chère dans l’Enfer du monde, ou pomme trompeuse, fruit d’un rêve érotique – de l’une à l’autre le locuteur de ces poèmes arpente un monde désenchanté et fantastique, comme le sont les rêves : transformation, déplacements, condensation, le lecteur est confronté à toutes les fantaisies de cet univers, dont on attend que le poète nous permette d’en visiter davantage. Avec une ironie subtile et l’autodérision qu’il applique à ses vers, il livre une l critique sociale ou religieuse sous laquelle pointe la légèreté mélancolique qui produit aussi le poème des « non-baisers », tentatives à jamais ratées, dont seul un poète oublié pourra se faire l’écho. (mb)
.
traduction Jana Boxberger
.
Citát z Adama Puslojiće
Motto: Víš přece, jak mi chutnají jablka
Adam Puslojić *
Prý nás znovu vyhnali z nebes,
lásko moje.
Můj jmenovec Adam
to už dávno věděl.
Tehdy jsem mu to sice nevěřil,
ale dnes je to fakt.
Ovšem hada nech klidně spát
a žádná jablka už nekraď,
protože na této Zemi,
kam nás teď pošlou,
je jich dost,
a to jak hadů, tak jablek.
Jen abychom tam tentokrát
vydrželi trochu déle,
v pekle je totiž rozhřešení sice zdarma,
ale jablka stojí hrozně moc.
*Významný srbský básník (*1943)
Une citation d’Adam Puslojić
Motto: Tu sais bien combien j’aime les pommes
Adam Puslojić *
On dit, mon amour,
qu’on nous a encore chassés du ciel.
Adam, mon homonyme,
le savait depuis longtemps.
J’avoue qu’autrefois, je ne croyais pas ce qu’il
disait,
mais aujourd’hui, c’est incontestable.
Cependant, laisse le serpent dormir en paix
et ne vole plus les pommes,
car sur cette Terre,
où l’on va désormais nous envoyer,
on n’en manque pas,
ni de serpents, ni de pommes.
Espérons que cette fois-ci,
on nous y gardera un peu plus longtemps,
car, bien qu’en Enfer l’absolution soit gratuite,
les pommes y sont terriblement chères.
*Poète serbe de renom (*1943)
*
Dnes v Tesku
dnes v Tesku se všichni
lidé chovali zvláštně
dívali se na mě jako
kdybych obsazoval příliš moc
prostoru kolem sebe jako
kdybych dýchal příliš z jejich
kyslíku jako
kdybych odmítl zaplatit jejich
nákupy jako
kdybych mlčel jinak než
mluví oni
dnes v Tesku všichni
lidé nosí růžové džiny
baví se polsky a
kopou do koček
nakonec jsem si jednu
i koupil
stejně však to bylo
už zbytečné
Aujourd’hui au supermarché Tesco
aujourd'hui au Tesco tous les gens
se comportaient étrangement
ils me regardaient comme
si je prenais trop
d'espace autour de moi comme
si je respirais trop de leur
oxygène comme
si je refusais de leur payer
leurs courses comme
si je me taisais autrement
qu’ils ne parlaient
aujourd'hui au supermarché Tesco
tous les gens portaient des jeans roses
bavardaient en polonais et
donnaient des coup de pieds aux chats
j´ai fini par m´en
acheter un
pourtant c’était déjà
inutile
*
Citát k dopsání
Měním se,
ani nevím v co.
Rád bych tě vzal s sebou,
ani nevím kam.
Se srdcem na dlani
se mi třesou ruce.
Anebo že by to srdce ani nebylo moje?
Už dlouho (dávno) neočekávám,
aby se rozsvítilo, (že se rozsvítí, že se rozbřeskne)
slunce jsem zradil,
světlo prodal
za třicet střibrných a půl.
Drobné si nechám.
Une citation inachevée
Je me transforme,
sans savoir en quoi.
Je voudrais t’amener avec moi,
sans savoir où.
Avec le cœur offert sur la main tendue
qui tremble.
Mais si ce cœur n’était pas vraiment à moi ?
Il y a longtemps que je n’attends plus
que le jour se lève,
j’ai trahi le soleil,
vendu la lumière
pour trente deniers et demie.
Je garde la petite monnaie
*
Diktát č.43: Čínské výrobky – H
Byli nespokojení,
tak si stěžovali velkému bohu Yü-di
na příliš měkkou hlínu,
z níž je vytvořil.
Ten je poslechl,
pochopil, že jsou to zmetky,
a rozhodl se,
že z nich bude znovu hlína
dřív než z ostatních.
Dictée N° 43 : Produits chinois – H
Ils n’étaient pas contents,
alors ils se plaignirent au grand dieu Yü-di
de la glaise trop tendre
dont il les avait pétris.
Il les a écouta,
comprit que c’était des rebuts
et décida
d’en refaire de la glaise
avant les autres.
*
The Day Before You Came
(soap poetry - jedné dívce se zlatými vlasy)
Bylas tak krásná
bosá,
v dlouhých černých šatech
bez rukávů,
s dlouhými černými rovnými vlasy,
s bílou něžnou
až nebesky bledou tváří,
s dlouhýma štíhlýma nohama,
s tmavočervenými úzkými rty,
s jemnýma rukama
a tenkými pažemi,
s očima hořícíma
vášní tvojí a bolestí mojí
a těžkým skřípajícím mlčením
světa
ani mého, ani tvého.
Bylas tak krásná,
že jsem se bál
na tebe i dívat,
jako kdyby mě tolik krásy
mohlo oslepit
jako v starých norských pohádkách.
Tys však přesně věděla,
kvůli čemu jsi přišla,
a tak nakonec jsme se vzali
a jeli vlakem na sever
jako v té staré písničce.
To nejdivnější je však,
že se mi černovlásky
nikdy nelíbily.
Tys mi však tehdy
v tu naši novomanželskou
polární noc
rozluštila
i ten poslední
zbytečný hlavolam:
'Já přece nejsem Agnetha.'
The Day Before You Came
(soap poetry – pour une jeune fille aux cheveux d’or)
Tu étais si belle,
pieds nus,
dans une longue robe noire sans manches,
avec de longs cheveux noirs et lisses
et un visage blanc,
tendre et pâle comme sur une image sainte,
avec de longues jambes sveltes
et des fines lèvres rouge foncé,
avec des mains délicates
et des bras filiformes,
avec des yeux qui brûlaient
de ta passion et de ma douleur,
et du lourd silence grinçant
du monde
qui n’était ni le mien, ni le tien.
Tu étais si belle
que j’avais peur de te regarder,
comme si tant de beauté
pouvait me rendre aveugle,
comme dans de vieux contes de fées
norvégiens.
Mais tu savais très exactement
pourquoi tu étais venue,
alors nous finîmes par nous marier
et nous partîmes en train au Nord,
comme dans cette vieille chanson.
Ce qui est le plus étrange,
c’est que je n’ai jamais été attiré par les
brunes.
Mais au cours de notre première nuit de
noces polaires
tu trouvas la solution
même à la dernière énigme superflue,
en déclarant : « Mais je ne suis pas Agnethe,
voyons ! »
*
The Day After
Zdálo se mi,
že se miluju s fíkovníkem.
Líbal jsem jeho voňavé květy,
hladil jeho svěží poupata,
okouzlil mě svými
krásně tvarovanými nadzemními kořeny,
souložil jsem s jeho štíhlým kmenem.
Ale ráno, když jsems e probudil,
vedle mně jsi ležela ty,
kolem tebe had
a mezi námi jablko.
A teprvé tehdy jsem pochopil,
proč mi fíkovník v mém snu
nechtěl půjčit list.
The Day After
Je rêvais
que je faisais l’amour avec un figuier.
J’embrassais ses fleurs odorantes,
je caressais ses boutons frais,
j’étais subjugué par ses
élégantes racines aériennes,
je copulais avec son tronc svelte.
Mais le matin, à mon réveil,
c’est toi qui étais couchée à mes côtés
entourée d’un serpent,
et entre nous deux, une pomme.
Et ce n’est qu’à ce moment que j’ai compris
pourquoi le figuier dans mon rêve
ne voulait pas me prêter une feuille.
*
Les non-baisers
Nous nous embrassons sans envie,
nous nous embrassons sans amour,
nous nous embrassons sans désir,
nous nous embrassons sans excitation,
nous nous embrassons sans nos langues,
nous nous embrassons sans nos lèvres,
nous nous embrassons sans nos bouches,
nous nous embrassons sans nos yeux,
nous nous embrassons sans nos joues,
nous nous embrassons sans les formes,
nous nous embrassons sans les visages,
nous nous embrassons sans imagination,
nous nous embrassons sans fantaisie,
nous nous embrassons sans images,
nous nous embrassons sans la réalité,
nous nous embrassons sans Dichtung,
nous nous embrassons sans Warheit,
nous nous embrassons sans les baisers,
nous nous embrassons sans nous embrasser,
nous nous embrassons sans embrasser,
alors jamais personne ne s’aperçoit que l’on s’embrasse,
nulle part personne ne voit que l’on s’embrasse,
personne ne l’entend
et ne le sent,
même pas nous,
et c’est pour ça
que jamais personne nulle part
ne décrira nos baisers,
sauf un poète oublié qui,
lui-même, n’a jamais nulle part embrassé
personne, donc, au moins,
il nous inventera, nous, un couple
qui essaie de s’embrasser
comme lui essaie d’écrire un poème
.
.
.
Mircea Dan Duta lit "Les Non-baisers" dans la version originale tchèque et en anglais au cours de International Poetry Festival, 6th edition, 2020, Rahovec, Kosovo