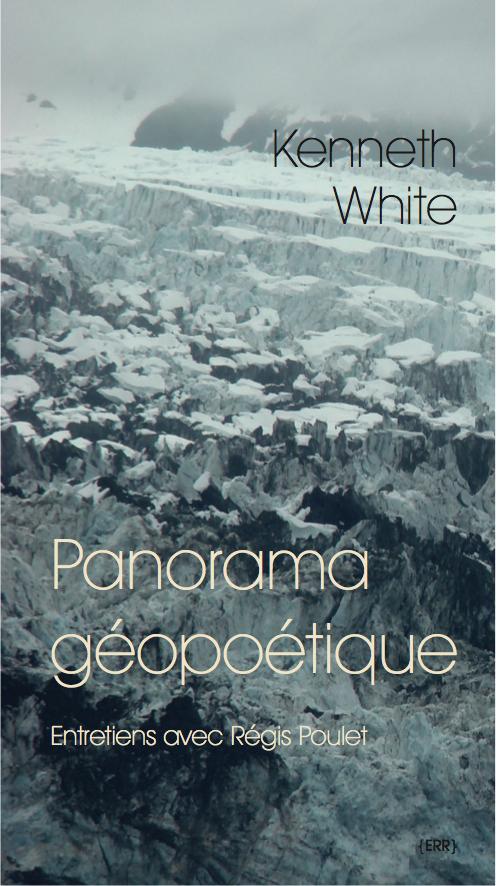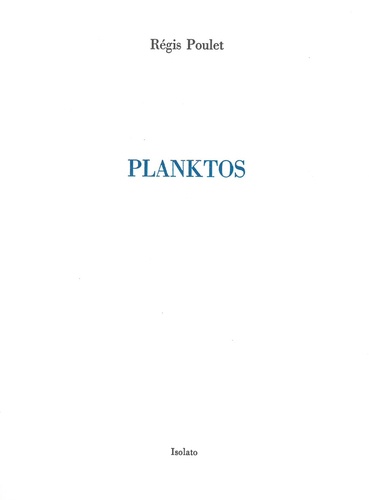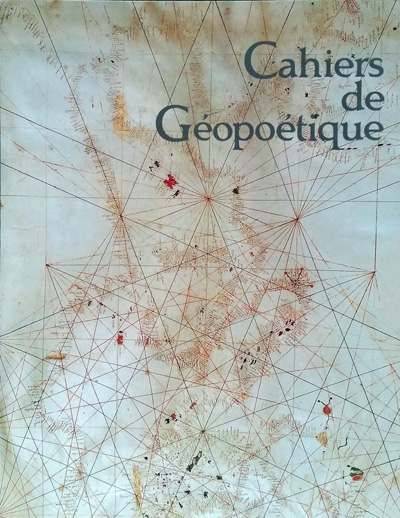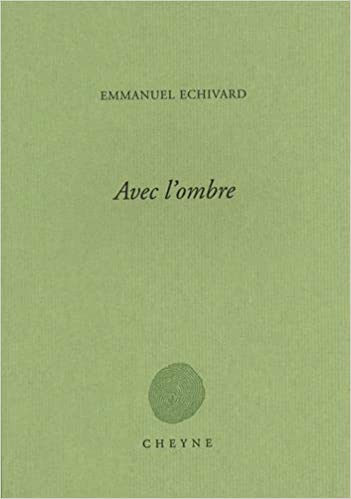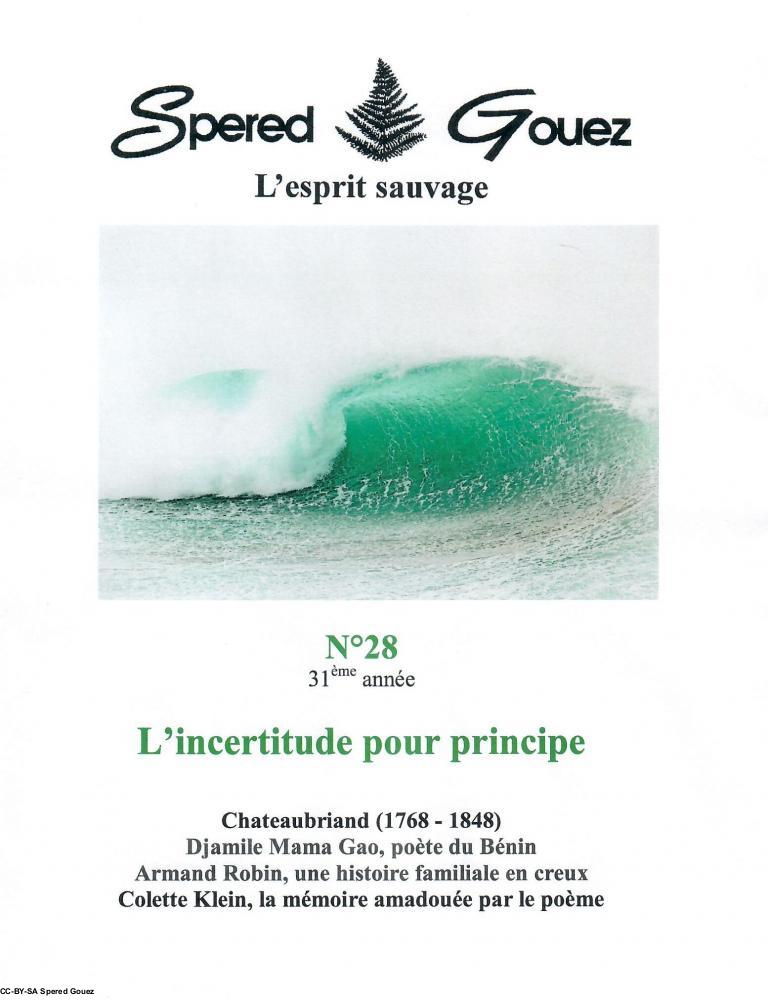Ángelos Sikelianós, Le Visionnaire
Lorsqu'on referme le livre de Sikelianós, le premier mot qui vient à l'esprit est ferveur, celle dont il fait preuve à mettre en vers son pays comme l'entière Humanité ; un désir de communion qui embrasse aussi bien l'humain que le divin, une célébration à hauteur de ces enjeux : incommensurable. Il ne faut pas s'étonner, dès lors, que les poèmes soient longs, parfois très longs (une trentaine de poèmes seulement sur plus de cent pages pour ce choix qu'a opéré le traducteur Michel Volkovitch). Il n'est pas rare non plus qu'une phrase ait besoin de plus d'une dizaine de vers pour se déployer ; elle est ample comme la mer, habitée comme elle de remous, déferle.
Tel un homme laissant l'étreinte de sa femme,
car était juste sa soif de mourir,
car il était un champ dont les épis frémissent
profondément, courbés par la rafale
cette invisible faux qui passe au-dessus d'eux,
un homme désirant le faucheur qui viendrait
couper les épis mûrs et les coquelicots
- il désirait aussi l'étreinte de sa femme,
léger son sang, fraîche sa veine, une torpeur
silencieuse, on eût dit éternelle, l'a pris,
imprégné jusqu'au fond par l'esprit de la terre ;
de la lune la lueur traversait sa paupière
tels des nuages printaniers, et les étoiles
allégeaient son esprit, pareilles à des larmes,
il avait les paisibles monts au loin pour gardes ;
l'esprit de l'homme et son corps se touchaient
il n'avait plus sur lui l'ombre du moissonneur,
étendu sur le dos il ne voyait nul signe,
mais dans un lent coup d’œil, des fonds sans fin ;
et moi aussi, dans ma veille éternelle,
debout, mes yeux ouverts se tournant vers le ciel,
j'éclaire au fond de moi et reflète les monts...
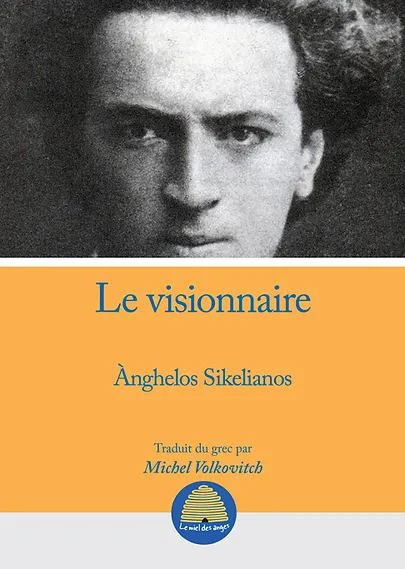
Ángelos Sikelianós, Le visionnaire, éditions Le miel des anges, 2022, 109 pages, 12 €.
Ce long extrait du poème Tumulus (une seule phrase de vingt-deux vers) témoigne de cette communion multiple (chair et esprit, homme et nature, vie et mort), allie de manière lumineuse choses concrètes et évocation spirituelle, symbolisme et esthétisme.
Jeune homme, Ángelos Sikelianós(1884-1951), bien qu'inscrit à la Faculté de Droit d'Athènes, dont il ne suit pas les cours, est inexorablement attiré par les arts, d'abord le théâtre puis la poésie. Il voyage à travers la Grèce, mais aussi à Rome, à Paris... À partir de 1923, germe en lui l'idée de fraternité universelle, bien plus large que celle qui serait réservée aux seuls êtres humains. Ainsi, dans le poème Voie sacrée, contant la rencontre d'un bohémien qui fait danser assez cruellement une ourse et son petit, il a cette réflexion :
Et en marchant, mon cœur gémissait :
« Viendra-t-elle un jour, ou jamais, l'heure
où les âmes de l'ourse et du Tsigane
et la mienne, que je crois Initiée,
se feront fête ? »
En 1906, chez la danseuse Isadora Duncan, il rencontra une communautés d'expatriés américains qui avaient décidé de vivre comme les Grecs de l'Antiquité, dans une ambiance mystique qui séduira le jeune Ángelos. Cette empreinte se retrouvera fréquemment dans ses poèmes et jusque dans sa vie, avec son « projet delphique » : persuadé que Delphes, où il réside, peut redevenir, comme dans l'Antiquité, un centre spirituel qui dépasserait les différences entre les peuples, il conçoit tout un programme (comprenant la création d'une Université) auquel sont conviées nombres de personnalités. Des Fêtes delphiques, largement subventionnées par son épouse, sont organisées. Il y accueille le compositeur Richard Strauss en mai 1927. Le poète Georges Séféris y viendra en 1929. Des représentations de théâtre antique sont données. Mais ce projet, pour intéressant qu'il fût, ruina le couple. Ces données biographiques sont importantes pour comprendre l'engagement, jusque dans son écriture poétique, de Sikelianós. Quelques titres de poèmes parlent d'eux-mêmes quant à la référence au monde antique et à ses mythologies : Les chevaux d'Achille, Anadyomène (une note nous apprend que ce terme signifie « Qui a jailli des eaux » et fait allusion à la naissance de Vénus, Je voyage avec Dionysos, Dédale, etc.
[…] Ta voix,
la voix d'un dieu émergeant du sommeil,
voix de la « grande ivresse », appellera soudain
les morts vers le soleil et sa chaleur,
tandis que se penchera sur Ton berceau
l'ombre de Ta vigne unique toute-puissante,
mon doux enfant, mon Dionysos, mon Christ !
Sikelianós n'hésite pas, dans sa vocation enthousiaste à tout rassembler, à relier Jésus et le fils de Zeus. Cette sorte de syncrétisme correspond à l'universalisme de l'auteur qui embrasse tous les domaines.
Oui, c'est là,
sur un cap de Leucade,
où les galets sont nets,
polis comme des œufs de pigeon par la vague,
que je T'ai connue, Athéna,
au corps d'adolescente, à la pensée légère !Comme deux galets qu'on lance
sur la mer immobile,
le cercle de l'un
entrant dans l'autre
sans qu'ils se brisent,
Tu es entrée dans mon âme
comme l'âme d'une sœur dans son frère !
Rappelons que Sikelianós est né à Leucade. Il associe son histoire personnelle ici avec celle de la déesse, en une osmose comme celle des ronds dans l'eau, générés par des cailloux qu'on y jette.
Le traducteur a parfois tenté, avec succès, le pari de la rime dans le texte français,
Ce qui reste léger en ce monde, il suffit
du four des sensations pour le changer en nid,quand le soleil ne peut allumer mon désir
à lui seul, ni le feu les ossements rôtir...C'est la petite fleur face au portail fermé,
c'est l'eau du puits par quoi l'hiver est tempéré.
Si la poésie messianique d'Ángelos Sikelianós est entièrement colorée d'emphase, il faut, pour avoir une chance de l'apprécier, se laisser porter par ce flot généreux.
Le terme grec Ο αλαφροΐσκιωτος (titre de son premier grand poème lyrique, écrit lors d'un voyage en Égypte, traduit par Le visionnaire, titre repris dans ce choix de textes opéré par Michel Volkovitch), concentre en lui plusieurs notions, celles de pur, naïf, marqué par le destin, mélange d'élection surnaturelle et d'inadaptation à la vie. Nous verrons, quant à nous, chez ce visionnaire, un poète à l'écriture certes en décalage avec la modernité d'un Séféris par exemple, un homme dont le souffle a voulu s'accorder à celui du divin.