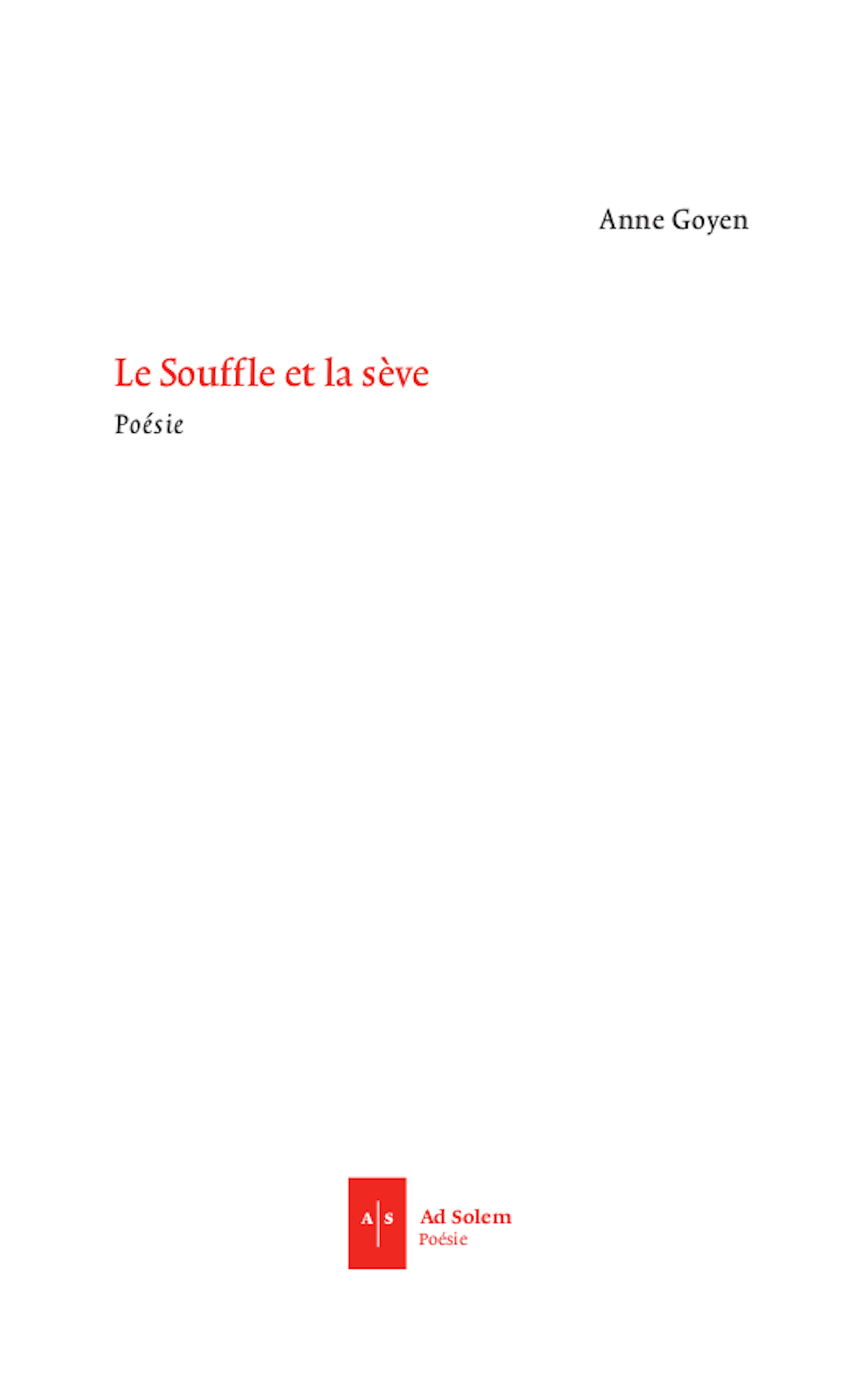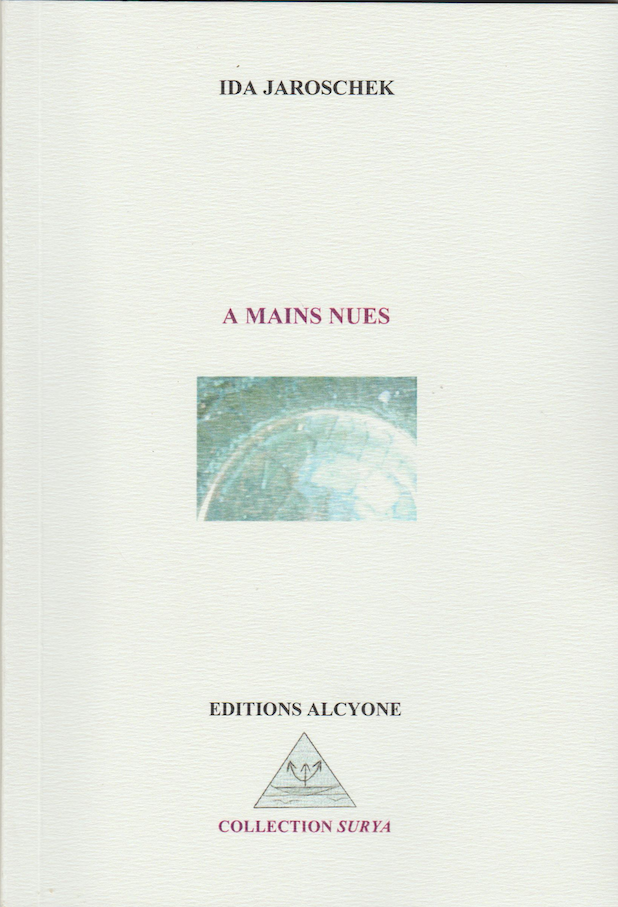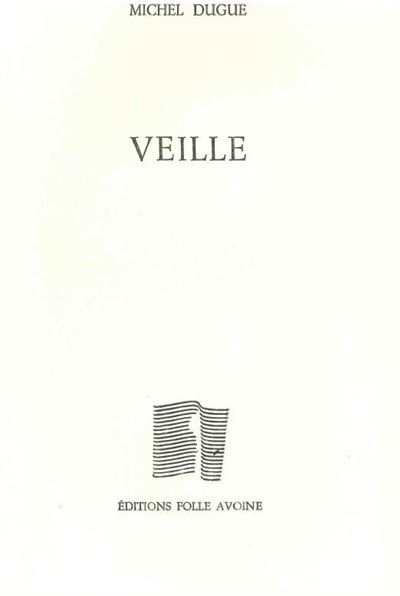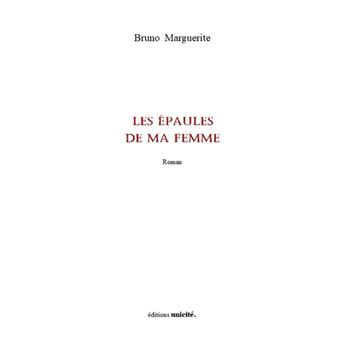De la problématique de la mémoire dans la création poétique surréaliste d’André Breton : Mythe ou réalité ?
INTRODUCTION
Le Surréalisme, terme employé pour la première fois par Guillaume Apollinaire dans Les Mamelles de Tirésias1, a été institué en mouvement artistique par André Breton, à partir de 1924. Il s’est construit autour d’un certain nombre de dogmes esthétiques parmi lesquels le déni total de la mémoire. Cette instance psychique, on le sait, convoque les souvenirs, transpose les réminiscences, véhicule des académismes et une éducation apprise et éprouvée.
Cette instance psychique, on le sait, convoque les souvenirs, transpose les réminiscences, véhicule des académismes et une éducation apprise et éprouvée. Autant de choses que le Surréalisme réprouve, les imputant au compte d’un monde qui a échoué dans sa vocation à édifier l’être. L’écrivain surréaliste prétend donc renoncer à la faculté mémorielle, s’il ne la nie pas. Dans ce sens, il ne s’agirait, dans l’acte d’écriture, que de donner sens et valeur au présent et à l’avenir par des formes artistiques hardies d’outrage contre les formes du passé et promptes à « réinventer la vie ». Concrètement, le surréalisme, sous la houlette de Breton, invente des techniques de création ayant pour vocation d’évincer les phénomènes mémoriels de l’art. Ce sont : l’écriture automatique, le sommeil hypnotique, le hasard objectif, etc. On peut, à juste titre, se préoccuper de savoir si la mémoire a été véritablement et définitivement boutée hors des stratégies scripturaires des surréalistes ou si elle s’est insidieusement faufilée entre les lignes de leur art poétique, pourfendant ainsi une disposition doctrinale ; des marques de la survivance mémorielle semblant se trouver incrustées à travers des procédés figuraux et énonciatifs, en plus de quelque présomption afférente à la métrique classique. Pour intégrer l’épineuse problématique de l’hypothétique intervention de la mémoire dans l’écriture surréaliste, nous avons recouru à André Breton, sa figure centrale, du reste.

Portrait d'André Breton © Victor Brauner.
D’où le sujet suivant : « De la problématique de la mémoire dans la création poétique surréaliste d’André Breton : Mythe ou réalité ? » L’objectif poursuivi est de savoir si André Breton, chef de file du mouvement et fervent négateur de la mémoire, réussit son pari nihiliste à l’égard de cette instance psychique ou si, malgré tout, celle-ci s’impose inconsciemment ou irréversiblement dans l’effusion de son art.
Pour dérouler la réflexion, trois herméneutiques seront convoquées. Ce sont : la psychocritique, l’intertextualité et la poétique. La première est la conception méthodologique de Charles Mauron et consiste à quêter les traces de l’inconscient psychique d’un auteur dans son texte, eu égard aux images obsédantes qu’il y sème. Ici, cette critique permettra d’apprécier si le flux continu des images dont use Breton n’a aucun rapport avec la mémoire ou si, au contraire, il en porte la trace. L’intertextualité, elle, se conçoit comme « une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, éidétiquement et, le plus souvent, par la présence effective d’un texte dans un autre » (Gérard Genette, 1982, p.8). Elle servira à étudier la pratique intertextuelle, c’est-à-dire la référence à d’autres textes ou auteurs comme relevant, plus ou moins, d’une implication du mémoriel. La poétique, pour sa part, s’entendrait comme « la recherche des lois (générales) permettant de rendre compte de la totalité des œuvres (particulières). » (Maurice Delcroix et Ferdinand Hallyn, 1987, p.11). En un mot, la poétique, en tant que théorie littéraire usuelle, se résumerait à l’examen des pistes thématiques et formelles des textes de Breton, sous le rapport de leurs complexités techniques, figuralement inventives, et métriques, imputables ou non à l’hypothèse d’un phénomène mémoriel.
Le travail s’articule en trois parties dialectiquement interconnectées. La première intitulée « de la mémoire comme d’un mythe dans la poésie de Breton » consistera à indiquer les signes textuels qui fondent en théorie la proscription de la mémoire dans la création poétique de Breton. La deuxième, « De l’impossible aliénation de la mémoire chez Breton » se consacrera, en revanche, aux indices de la présence obstinée de la mémoire dans l’art du poète-idéologue français. La troisième, quant à elle, intitulée « Dédire et dire la mémoire : les enjeux d’une (im)posture », situera les enjeux du presqu’inédit ‘’Absence/présence’’ du mémoriel dans l’écriture du maître du surréalisme.
André Breton, Clair de Terre, L'Union libre, lecture de poème en ligne. Auguste Vertu.
- DE LA MEMOIRE COMME D’UN MYTHE DANS LA POESIE DE BRETON
La mémoire a été l’objet d’un traitement variable dans les différentes instances de la science et de la connaissance, et ce, depuis les travaux inauguraux d’Hermann Ebbinghaus2.Nous ne ferons pas l’inventaire des conceptions assez divergentes sur la question mais, délibérément, nous nous limitons à des approches qui restituent l’entité abordée sous un angle opérant. Si les Behavioristes3 nient toute idée de mémoire, limitant la vie de l’homme à son comportement et non à une intériorité qui collecte et structure des souvenirs, les tenants de l’approche structurale4 de la mémoire admettent, eux, son existence et la scindent en deux sous-catégories. Ce sont : la mémoire volontaire et la mémoire involontaire. Chacune jouit de spécificités identifiables grâce à un travail définitoire. Selon Gilles Deleuze (1998, p.47) :
La mémoire volontaire va d’un actuel présent à un présent qui « a été », c’est-à-dire à quelque chose qui fut présent et qui ne l’est plus. Le passé de la mémoire volontaire est donc doublement relatif : relatif au présent qu’il a été, mais aussi relatif au présent par rapport auquel il est maintenant passé. Autant dire que cette mémoire ne saisit pas directement le passé : elle le recompose avec des présents.
Cette définition appelle au moins trois conséquences. Primo, la mémoire volontaire dépend concomitamment de la volonté et de la conscience de celui qui se rappelle une information. Secundo, elle est utilitaire car elle aide celui qui se souvient à faire revenir des souvenirs pour un besoin immédiat. Tertio, cette mémoire ne « saisit pas directement le passé » mais « le recompose ». Autrement dit, les souvenirs ne sont pas restituables dans leur entièreté ; ils comportent des vides qui, chez l’artiste, seront comblés, recomposés par le geste de création : fiction, images et ton.
La mémoire involontaire, pour sa part, comme son nom l’indique se passe de l’intelligence et de la volonté du sujet qui se rappelle le passé. Elle est toujours déclenchée par une ou plusieurs sensations provenant des organes de sens. Jacques Zéphir (1990, pp.152-153) dira, à cet effet, que « le point de départ du souvenir involontaire est […] une sensation oubliée qui se réveille, fraiche et active, ce qui soulève de proche en proche, jusqu’au fond de notre inconscient, les souvenirs de notre vie passée ».
La mémoire, telle qu’on vient de la voir, peut être au départ de la mystique de la création. Marcel Proust en est l’apologue avéré. Dans ses livres, en effet, le temps qu’il croit perdu est retrouvé grâce au travail mémoriel. A travers l’expérience de la madeleine, notamment, il montre comment la mémoire involontaire est générateur d’écriture. Pour lui, le plus important dans la vie d’un homme demeure, « le passé dont les choses gardent l’essence et l’avenir où elles nous incitent à le goûter de nouveau. » (Marcel Proust, 1954, p.885).
Breton, au contraire de Proust, s’évertue à effacer la mémoire. Pour y parvenir, il procède de plusieurs manières. Parmi celles-ci, on peut citer l’abstraction de la vie antérieure par l’écriture automatique, le désordre scripturaire, reflet d’une impression de folie, et les actants amnésiques.
André Breton, Sur le route de San Romano, lecture par l'auteur, Poème.
I.1. La vie antérieure récusée par l’écriture automatique
La vie antérieure, c’est celle qui se souvient du passé, de l’enfance et de l’adolescence comme d’autant de phases contributives à l’édification de l’être. Généralement, les poètes sont réputés pour la densité de leur vie antérieure dont ils communiquent rétrospectivement les contours au lecteur par la magie du langage imagé.
Chez Breton, au contraire, la vie antérieure est dévoyée par la pratique de l’écriture automatique. En tant que performance scripturaire pulsionnelle immédiate et en situation, non régentée par le diktat de la Raison, l’écriture automatique est un prétexte pour déconnecter l’art du passé. Il s’agit d’un automatisme qui confie et confine la destinée de l’écriture au mouvement du stylo et de la main, sur le support graphique choisi par l’artiste, sans retour ou recours au décor antérieur de l’être et aux expériences qui s’y sont cristallisées. André Breton, (1966, pp.104-105), écrit :
Je répète qu’écrivant ces lignes, je fais momentanément abstraction de tout autre point de vue que poétique […] Je me borne à indiquer une source de mouvements curieux, en grande partie imprévisibles, source qui, si l’on consentait une première fois à suivre la pente – et je gage qu’on l’acceptera- serait, à ébranler des monts et des monts d’ennui, la promesse d’un magnifique torrent. […]
Le poète est clairement en phase de performance ou d’effusion créatrice, dans un strict rapport au présent comme l’attesterait le participe présent (« écrivant ces lignes »). Les métaphores aquatiques (« source », « torrents ») plaident pour une écriture fluide, au flux continu, gage d’identification de l’écriture automatique. Faire « abstraction de tout », en tant qu’enjeu de cette écriture in situ, est l’indicateur d’un nihilisme global qui, sur un plan psychologique, figure une posture de l’oubli ou de la négation de toute antériorité. Ainsi, les souvenirs d’enfance sont-ils volontairement ostracisés (André Breton, 1966, p.115) :
Un musicien se prend dans les cordes de son instrument
Le pavillon Noir du temps d’aucune histoire d’enfance
Aborde un vaisseau qui n’est encore que le fantôme du
sien.
Le déterminant « aucune » ainsi que le lexique du deuil (« noir », « fantôme ») participe d’une volonté d’effacer toutes les traces de l’enfance, indice vectoriel du passé qui vit en l’adulte. C’est aussi sous la forme d’une attaque en règle contre le conte qu’André Breton ruine la chaine du temps et se montre sans concession pour le passé.
Par définition, le conte est un récit imaginaire dont les évènements sont sensés s’être déroulés à une époque plus ou moins lointaine. Selon toute vraisemblance, l’évocation du conte est une sublimation du passé lointain, avec son corollaire baudelairien de royaume de l’enfance, ancrage du souvenir que le poète du surréalisme s’impose d’oblitérer : « Si, l’esprit désembrumé de ces contes qui, enfants, faisaient nos délices tout en commençant dans nos cœurs à creuser la déception ». La métaphore adjectivale (« l’esprit désembrumé de ces contes ») est un propos à charge qui place le conte, genre apologue du passé, sous l’axe d’un inhibiteur toxique de l’esprit. Ici, « délices » et « déceptions » jouent le même rôle syntaxique de complément d’objet direct. Ceci pour mieux mettre en parallèle la dualité nocive d’un genre qui séduit mais déçoit autant que le passé dont il est le laudateur ou le thuriféraire consacré.
I.2. Actants et impression d’amnésie
L’amnésie est une perte de la mémoire consécutive à un traumatisme ou à une maladie quelconque. L’amnésique, celui qui souffre de cette maladie, est ignorant de lui-même et de son histoire. Breton génère des actants - personnage, narrateur - qui subissent à volonté cet état pathologique. Dans l’extrait suivant, le personnage mis en scène fini par perdre la mémoire :
L’histoire dira
Que M. de Nozières était un homme prévoyant
Non seulement parce qu’il avait économisé cent
Soixante-cinq mille francs
Mais surtout parce qu’il avait choisi pour sa fille un
Prénom dans la première partie duquel on peut
démêler psychanalytiquement son programme
La bibliothèque de chevet je veux dire la table de nuit
N’a plus après cela qu’une valeur d’illustrationMon père oublie quelque fois que je suis sa fille
L’éperdu (André Breton, 1966, p.152).
La trajectoire existentielle globale du personnage nommé M.Nozières appelle une certaine dualité sur la question de la mémoire. D’une part, on identifie des évènements reflétant une forte concentration de l’activité mémorielle et, d’autre part, on assiste à la faillite de celle-ci au profit de l’amnésie. La phase de concentration du mémorielle s’exprime par des expressions connotant la logique mathématique (« économisez cent soixante-cinq mille francs »), le libre-arbitre («il avait choisi pour sa fille un prénom »), le sens de l’anticipation (« un homme prévoyant », « son programme »), l’archivage/conservation du savoir « bibliothèque »). L’amnésie, elle, intervient, par la suite, et tient, pour sa part, dans un énoncé qui balaie ou annihile tout évènement antérieur :
Mon père oublie quelquefois que je suis sa fille
L’éperdu
Ici, le raturage de la mémoire procède de ce que le personnage oublie même ce qui ne devrait pas l’être : l’existence de son propre enfant. Ce black-out semble total car il ruine un relationnel normalement immuable, en l’occurrence, le lien parental.
La faillite de la mémoire peut être considérée, en outre, à la lumière de la lexie « l’éperdu » qui, insolitement, se substitue au nom du personnage. Cette lexie contient, en effet, des sèmes tels que /déboussolé/ désemparé/ sans repères /sans passé/. Ces sèmes vident le personnage de toute assise mentale appuyé sur une capacité à se souvenir. La substitution de l’étiquette de politesse et de noblesse -Monsieur- par un simple substantif péjoratif - l’éperdu- dévoile également une intention satirique. Cet aristocrate amnésique incarne un vieux monde résolument déboussolé et sans repères.
On pourrait également prendre cause de l’effet hyperbolique généré par la nature notoirement excessive de l’oubli pour dire qu’il existe une forme d’inclination médicale du propos et de l’intention de Breton. En effet, c’est bien, et contre toute attente, le prénom de sa propre fille que le personnage a vu s’effacer de sa mémoire. Cette lacune mémorielle induit la maladie de Parkinson. Décrite en 1817 par James Parkinson, cette pathologie neurologique dégénérative chronique,affecte le système nerveux central et provoque des troubles progressifs dont le plus indisposant est la perte des capacités cognitives de type mémoriel. C’est dans le prolongement de l’impression d’amnésie parkinsonnienne qu’on peut situer cet autre extrait :
On ne sait rien ; le trèfle à quatre feuilles s’entrouvre aux rayons de la
lune, il n’y a plus qu’à entrer pour les constatations dans la maison
vide (André Breton, 1966, p.53).
La maison vide, ici, est une métaphore adjectivale renvoyant à la dégénérescence mentale, au trou de mémoire qui fait que « l’on ne sait rien ».
André Breton, Je reviens, Auguste Vertu.
I.3. Une impression d’asile psychiatrique par le désordre scripturaire
En considérant la mémoire comme une structure, Richard Atkinson et Richard Shiffrin5 devinaient son fondement résolument ordonné, sa marche logique et procédurale dans le traitement des informations. Autrement dit, logique, ordre et cohérence, sont des indices de la mémoire. Ces indicateurs structuralisants qui s’illustrent comme estampe du mémoriel sont bafoués chez Breton. Pour y parvenir, il fait parler des fous, c’est-à-dire des malades qui, par définition, ont perdu tout contact avec la logique ou la conscience des évidences matérialistes. Habitué à arpenter les allées des asiles de fous – il est médecin psychiatre -, Breton calque son écriture sur la décrépitude mentale de ceux-là qu’il côtoie quotidiennement dans le cadre professionnel. L’écriture bretonienne appelle ainsi une sorte de désordre qui sonne le glas de la logique, surtout, lorsque le discours poétique est assuré par un narrateur dont le propos ressemble à celui d’un aliéné mental. Dans le poème « Vigilance » (1966, pp.137-138), on croirait entendre parler un fou :
A ce moment sur la pointe des pieds dans mon sommeil
Je me dirige vers la chambre où je suis étendu
Et j’y mets le feu
Pour que rien ne subsiste de ce consentement qu’on m’a arraché
Les meubles font alors place à des animaux de même
Taille qui me regardent fraternellement ...j’entre invisible dans l’arche.
Le somnambulisme, en tant qu’acte de mobilité inconsciente durant le sommeil, insinue, à partir de la première phrase, un désordre psychologique. Tout autant que les incohérences du discours du locuteur (« je ») illustrent une forme de trouble mental à l’image de l’instant où il se « dirige vers la chambre où il est étendu ». Logiquement, aucune personne ne peut être, à la fois, en mouvement (« je me dirige ») et en position statique (« je suis étendu »). On est en face vraisemblablement d’un propos de délirant. Le locuteur est même sujet d’hallucinations comme en dénotent les métamorphoses subites des objets en êtres vivants (« Les meubles font alors place à des animaux de même/ Taille qui me regardent fraternellement… »). La métamorphose s’effectue, ici, à l’aide de l’expression « font place à » qui est, tout à la fois, un élément tropique. Autrement dit, les êtres changent d’aspects, passent d’un règne à un autre grâce au changement de sens des mots. Dans l’esprit du poète, les sèmes / animé /, /vivant/, /mobile/, /féroce / de « animaux » contaminent les sèmes /inanimé /, /inerte /, /immobile /non féroce/ de « les meubles ». On est pris dans le tourbillon d’un renversement de la logique, preuve que les bases rationnelles de l’esprit du poète sont sabordées. Le bouleversement de l’ordre va plus loin puisque les animaux vont, à leur tour, se métamorphoser en êtres humains par le truchement de la personnification formée à l’aide de l’adverbe « fraternellement ».
La ruine de la mémoire et, par ricochet, sa relégation au simple rang de vue de l’esprit dans l’écriture de Breton, se fonde sur des apparats formels, discursifs, figuraux et psychologiques, indéniables. En ce sens, on peut dire que ce poète s’accorde à la ligne de conduite officielle du mouvement qu’il a créé. Mais, est-ce toujours le cas ? La réponse à cette question exige l’évaluation d’autres paramètres de l’art de Breton. Ceux-ci, nous allons le voir, vont édulcorer l’idée de départ. Autrement dit, le mémoriel pourrait être une pratique dans l’approche scripturaire et psychologique des textes de Breton.
II. DE L’IMPOSSIBLE ALIENATION DE LA MEMOIRE CHEZ BRETON
En marge des attitudes niant la mémoire, il existe sur le terrain de l’investigation langagière bretonnienne, un tracé mémoriel qui s’enclenche fortement par une matérialité que supportent, sans coup férir, les pratiques intertextuelles, les toponymes et l’intrusion de la métrique classique.
II.1. Les pratiques intertextuelles chez Breton : des indices du mémoriel
Toute pratique intertextuelle résulte du souvenir volontaire ou involontaire d’un texte ou d’un auteur antérieurement lu par le scripteur du texte à apprécier. Il s’agit, donc, de la reprise, de la réadaptation ou de l’extrapolation d’un matériau énonciatif et esthétique déjà utilisé. Les phénomènes intertextuels observés chez Breton sont les marques probantes de collusion entre son art et le mémoriel. Sa poésie porte, en effet, les traces des noms et des œuvres dont il se souvient. Les dédicaces, les références onomastiques et des bribes de textes d’autres auteurs insérés dans ses textes à lui, en seraient les repères.
Gérard Genette (1987, p.120) définit la dédicace comme « l’hommage d’une œuvre à une personne, à un groupe réel ou idéal, ou à quelque entité d’un autre ordre ». L’hommage dédicatoire procède d’un type de rapport humain direct ou indirect, sensible ou intellectuel institué entre celui qui écrit – le dédicateur- et celui à qui il rend hommage –le dédicataire. Breton est coutumier des dédicaces, et ses dédicataires sont de plusieurs ordres. On y retrouve ses collaborateurs au sein du mouvement surréaliste: « SAINT-POL-ROUX » (p .35),« Georges de Chirico » (p.37), « Benjamin Péret » (p.47), « Francis Picabia » (p.58) « Paul Eluard » (p. 63), « Robert Desnos » (p.66), « Man Ray » (p.69), Louis Aragon (p. 67).A travers eux, le poète enseigne subrepticement l’histoire de son mouvement. Ces noms auxquels il se souvient et à qui il rend hommage rappellent, en effet, que le surréalisme fut pan artistique : Chirico et Picabia sont peintres, Man Ray est photographe tandis qu’Aragon, Eluard, Péret, Desnos et Saint-Pol-Roux sont des poètes.
Breton joue aussi du souvenir, et donc de la mémoire, par la convocation de l’onomastique d’auteurs célèbres des XVII, XIX et XXe siècles dans ses dédicaces. S’y retrouvent : « RIMBAUD » (p.26), « Paul Valéry » (p.28), « Baudelaire » (p.38), « Germain Nouveau » (p .38), « Barbey d’Aurevilly » (p .38), « Pierre Reverdy » (p .38), « Lautréamont » (p .147), « Le marquis de Sade » (p.165). En les sortant de l’ornière du passé ou de la contemporanéité pour les régurgiter dans la trame de son texte, Breton pose un acte de mémoire qui n’est pas anodin. Il permet, selon toute vraisemblance, à son lecteur, de visiter l’iconographie des figures majeures qui ont influencé le surréalisme. C’est un aveu à peine voilé de ce que le Surréalisme n’est pas né ex nihilo. Cette école ingère, digère et régénère des axiomes théoriques, des pratiques, des postures marginales déjà promus par des francs-tireurs de l’art et des idées. Il y a, donc, dans tout le processus inventif surréaliste, un recours et une reconstruction d’un existant formel et thématique plus ou moins antérieur. Breton ne peut donc pas nier être une personne à l’abri de l’impact de la mémoire, et dans les actes posés au quotidien, et dans l’instance de création.
Une autre variante du style dédicatoire chez Breton est le dédicataire-personnage d’œuvres. Ici, l’hommage est rendu à des "êtres de papiers". Ainsi a-t-on le texte « POUR LAFCADIO » (p.27). Personnage de Les Caves du Vatican6 d’André Gide, Lafcadio assassine gratuitement un passager du train en le projetant hors d’un wagon. Le meurtre de cet inconnu relève philosophiquement de l’acte gratuit et du libre-arbitre. Partisan, lui-même, de cette approche gratuite des choses, Breton salue, en Lafcadio, un modèle. La majuscule dans la graphie de son nom serait une preuve typographique de cet hommage voulu grandiloquent. Par ailleurs, en se rappelant l’action de ce personnage de roman, Breton synthétise intelligemment poésie, fiction romanesque et philosophie.
Le greffage même de ce personnage de roman dans un texte poétique, par son incongruité et son caractère inattendu, parait être une métaphorisation de la technique du collage. Breton le confesse à la fin du poème « Pour LAFCADIO », il écrit (1966, p.27) :
Mieux vaut laisser dire
Qu’André Bretonreceveur de contribution
de Contributions Indirectes
s’adonne au collage
en attendant la retraite
L’expression « André Breton…s’adonne au collage » indique très clairement le parti pris du poète pour le collage. L’anadiplose, (« receveur de Contributions/de contributions Indirectes », renforce l’impression de collage car, dans cette figure de construction, c’est le dernier mot d’un vers qui est repris et, donc, en quelque sorte, collé au début du vers suivant. On va voir, à présent que le rappel, dans son écriture, des noms d’endroits notoires, est la preuve d’une inclination mnésique.
II.2. Toponyme et phénomènes mnésiques
La cartographie des lieux de la ville de Paris imprègne les écrits du poète étudié. Ses textes contiennent ainsi des indices référentiels chargés des réminiscences de ses expériences déambulatoires dans la capitale française. Si les lieux et les situations sont réalistes à la base, il n’en demeure pas moins qu’ils sont transmutés par la pulsion figurale et poétique. Soit l’extrait suivant :
J’étais assis dans le métropolitain en face d’une femme que je n’avais pas autrement remarquée, lorsqu’à l’arrêt du train elle se leva et dit en me regardant : « vie végétative », j’hésitai un instant, on était à la station trocadero, puis je me levai, décidé à la suivre. (André Breton, 1966, p. 39).
« Le métropolitain » est une abréviation de "chemin de fer métropolitain" et désigne le métro de Paris. Une allitération en /a/ est visible dans le passage ci-après : « J’étais assis dans le métropolitain en face d’une femme que je n’avais pas autrement remarquée, lorsqu’à l’arrêt du train elle se leva et dit en me regardant. Cette figure microstructurale produit un effet rythmique suivi. Ce long enchainement sonore peut faire penser à la forme de l’engin mécanique dans lequel se déroule la scène. Le geste uniforme de se lever (« elle se leva » /, « je me levai ») crée un effet harmonieux qui rompt le face-à-face tendu entre les deux passagers du métropolitain. Le Trocadéro, quant à lui, désigne un endroit du XVIe arrondissement parisien où se dressait un château imposant du même nom.
On peut citer aussi cet extrait :
Au bas de l’escalier, nous étions avenue des Champs-Elysées, montant vers l’Etoile où d’après Aragon, nous devions à tout prix arriver avant huit heures. Nous portions chacun un cadre vide. Sous l’Arc de Triomphe, je ne songeais qu’à me débarrasser du mien.
Le passage ci-dessus foisonne de références toponymiques qui prouvent que Breton puise son inspiration dans sa culture urbaine. Ici, il se balade sur les « Champs-Elysées » comme en attestent les expressions de mouvement telles que « montant », « vers », « arriver ». Les « Champs-Elysées », réputée être la plus belle avenue du monde, est localisée à Paris. De même, « L’Arc de triomphe » est un monument parisien renommé. Nous avons-là des référents incontournables de la culture française, en général, et de son architecture, en particulier. Au total, le poète désigne des endroits notoires de Paris. Il les connait et les reconnait, s’en souvient comme spontanément et les faire vivre et revivre machinalement par le biais d’un dessein textuel presqu’intuitif. C’est également par l’usage de la prosodie qu’on prend acte de ce qu’il est porteur de stigmates de sa culture, de l’enseigne d’un ressouvenir systématique.
II.3. Réminiscence de l’esthétique classique : métrique et rythme
Chez Breton, le passé et le souvenir demeurent vivaces grâce à la reconduction et à la reproduction de procédés essentiels de la poésie classique. Les techniques versificatrices dont il use prouvent que l’argument esthétique de la table rase et de l’oubli des antécédents culturels, n’opèrent pas toujours. Son esthétique est arrimée, bien des fois, à l’art ancien et officiel. Attardons-nous, à présent, sur la métrique et la rythmique.
La métrique est l’art de la construction des mètres ou vers. Elle résulte essentiellement de techniques dont l’apogée théorique et pratique se situe à l’âge classique. Qu’ils soient longs (alexandrin, hendécasyllabe, décasyllabe) ou courts (octosyllabe, heptasyllabe, hexasyllabe, pentasyllabe, tétrasyllabe, dissyllabe, trisyllabe...), les mètres ont une charge rythmique. Breton convoque et use de ces techniques comme d’un capital ancien dont il faut tirer profit pour structurer la forme poétique. Le texte « PIECE FAUSSE » (André Breton, 1966 ; p.47) est tributaire de l’actualisation d’un héritage métrique. Y abondent plusieurs mètres courts :
André Breton, L'air de l'eau, Auguste Vertu.
Du/ va/s(e) en/ cris/tal/ de /Bo/hêm(e) = octosyllabe
Du/ va/s(e) en/ cris=tétrasyllabe
Du/ va/s(e) en/ cris=tétrasyllabe
Du/ va/s(e) en = trisyllabe
En/ cris/tal=trisyllabe
Du/ va/s(e) en/ cris/tal/ de/ Bo/hêm(e)=octosyllabe
Bo/hêm(e)=dissyllabe
Bo/hêm(e)=dissyllabe
En/ cris/tal/ de/ Bo/hêm(e)=hexasyllabe
Bo/hêm(e )=dissyllabe
Bo/hêm(e )=dissyllabe
Bo/hêm(e )=dissyllabe
(…)
Le poète varie son souffle par l’usage d’une métrique hétérogène. Le rythme est rapide et léger ; l’impression qui se dégage est ludique et joyeuse. Ces impressions sont renforcées par l’apocope de « cristal » aux vers 2 et 3. Il y a apocope car le mot « cristal » devient « cris » par troncation de sa seconde syllabe « tal ». L’effet de bondissement léger et joyeux se renforce davantage avec la répétition de « Bohème » aux vers 10, 11 et 12. En conditionnant les vers courts à suggérer une atmosphère guillerette, le poète se met au diapason de ce qui est admis de tradition sur ces vers à savoir qu’ils conviennent « parfaitement à certaines poésies légères. » (Maurice Grammont, 1965, p. 46). La même idée est reprise par l’aphorisme qui dit : « A mètre court (…) sujet léger » (Brigitte Bercoff, 1999, p.62).
III. DEDIRE ET DIRE LA MEMOIRE : ENJEUX D’UNE IM(POSTURE )
A ce stade de notre analyse, il apparait clair que la complexité du mémoriel est de mise chez Breton. D’une part, il cède à l’appel des sirènes surréalistes de l’inflation nihiliste du mémoriel et se l’impose comme démarche esthétique. D’autre part, les actes et agissements de sa mémoire affleurent et édulcorent sa posture première. On pourrait supputer sur ce que recèle la négation/existence de la mémoire chez cet écrivain.
III.1. Valeurs du rejet du mémoriel : catharsis, visions médicales et renouvellement de l’art
Au XXe siècle7, la conscience humaine, envisagée à l’échelle collective ou individuelle, est entachée par la vision terrible de l’horreur de la guerre, de la shoah et des pogroms. Tout rapport avec le souvenir, tout report du souvenir parait traumatisant. C’est pour oublier ces meurtrissures, ou pour ne plus les couver dans les strates de son être, que Breton rejette la mémoire. L’oubli ou le nihilisme, par rapport à toute construction mentale antérieure, sert à aseptiser son esprit des débris, des peurs et des blessures qui enfreignent le renouvellement courageux et la régénérescence humaine. La mémoire, pour le contexte et pour Breton, est juste un boulet qui tire vers le bas les élans optimistes de l’être. Elle distille une sorte de puanteur et de déconfiture morale. Sa dénégation ressemblerait, donc, à une catharsis conjuratoire.
Par rapport à la création artistique même, le déni du mémoriel ressemble à une astuce pour éviter de signer un pacte avec la tradition. Il s’agit, en mimant l’amnésie et la folie, de se donner les moyens de se désaffilier des héritages prosodiques et métriques. Breton ne veut pas que son art soit une récitation presqu’irraisonnée des théories, genres et formes classiques. Il veut concevoir l’inspiration comme un bouillonnement intérieur immaculé où les arguments du passé, de la vie antérieure cessent d’exercer leur tyrannie sur les sens. L’esprit du poète se veut une page blanche où s’inscrira la disponibilité de nouvelles techniques (re)créatives. L’oubli, c’est-à-dire la faille et la faillite de la mémoire, est, au regard de ce qui précède, l’acte psychologique révolutionnaire de mise à mort du classicisme.
L’amnésie et la folie esthétisées chez Breton8 procèdent, sous un autre angle, de l’intrusion des sciences médicales dans l’esthétique littéraire. Monsieur de Nozière qui oublie, contre toute attente, le nom de sa propre fille,répond d’une symptomatologie parkinsonienne. De même, le narrateur du poème « Vigilance » (pp.136-137) rentre dans les schémas d’un délire somnambulique à se promener en dormant, et de la pyromanie à mettre le feu à son logis.
III.2. Valeurs des survivances du mémoriel: les inusables déterminismes et le choc des valeurs de l’être en Breton
Breton est habité, malgré lui, par le souvenir, le passé et l’histoire (littéraire). Il y a, dans les instances de sa psychologie créatrice, une disposition de retour en arrière, à l’invocation et à l’actualisation d’un arrière-pays peuplé par une culture, des idées et des impressions. La mémoire n’est donc pas totalement occultée. Elle fait plus que résister et impacte le jaillissement et la saveur de sa poésie. Quoiqu’haï, le mémoriel s’invite et se dévoile. Les techniques censées l’annihiler n’y parviennent pas totalement. En s’incrustant de la sorte, la mémoire s’illustre dans toute sa complexité et pose une équation de désaveu sur l’axiome surréaliste de "réinventer la vie". Breton est soumis à l’énergie de la pratique mémorielle et du déterminisme mental. Son art semble, en effet, incapable de se forger à partir d’un nihilisme absolu. Il tend à s’inspirer toujours d’un existant formel ou thématique. Même lorsque le nihilisme est voulu, entretenu, planifié et théorisé, il subsiste toujours les traces d’un passé vu ou entrevu, des réminiscences de choses vues, de pratiques formelles avérées. En clair, « aucun homme ne peut donc se séparer de son passé. Ce passé fait partie de lui ; exactement comme nul ne peut dire que son sang soit, chaque jour, un sang nouveau. » (Pierre Daco, 1965, p.165).
En outre, on peut considérer que le mémoriel résume toute la force d’un conflit des valeurs entre le poète-Breton, l’homme-Breton et le psychiatre-Breton. La ferveur et la flamme de la révolution poétique pousse le poète à nier la mémoire et à inventer toute une gamme de techniques scripturaires pour l’anéantir. Mais, l’homme est bien obligé d’admettre que ladite instance est incontournable dans le fonctionnement de l’être, encore plus, dans l’activité de création. Cette complexité constatable, en bien des points de son art, érige la mémoire en un objet d’étrange curiosité que le psychiatre se délecte à étudier avec toute la rigueur scientifique. La complexité découlant du traitement de la mémoire chez Breton, est salutaire car elle est un point d’ancrage à une réflexion sur le renouvellement des instances du psychisme humain et de la création poétique au XXe siècle.
CONCLUSION
La mémoire est une instance psychique complexe dont André Breton fait un usage artistique, pour le moins, original, aux fins d’optimiser la charge esthétique de son art. Dans la doctrine poétique surréaliste bretonnienne, en effet, il est officiellement question de museler la mémoire par des automatismes scripturaires, l’accumulation de procédés calqués sur l’amnésie, la folie et des actants sans passé. Toutefois, l’extinction souhaitée du mémoriel ne s’en trouve pas véritablement de mise, à l’aune de sa création littéraire. Le recours à des intertextes, le rappel des noms de lieux réels ainsi que l’usage d’une métrique classique induisent l’implication de la mémoire dans son art. L’une et l’autre des postures sont porteuses de sens. Si, d’un certain point, l’ostracisation de la mémoire, procédant d’une volonté d’oublier les traumatismes d’une époque violente, de façon telle à initier des canons singuliers pour une inspiration ou une pratique poétique nouvelle, paraît salutaire, de l’autre, la survivance observable du mémoriel révèle que, dans l’être intérieur de Breton, l’homme, le poète et le psychiatre, cohabitent aisément, sans heurt, donc. Pris dans la déferlante audacieuse de son mouvement, il s’est efforcé d’anéantir la mémoire. S’il n’est pas parvenu à ses fins, c’est bien parce que la mémoire reste un allié de tout poète même lorsque celui-ci le voue aux gémonies. Non efficience et efficience du mémoriel chez Breton analysée, ici, à l’aide des herméneutiques convoquées restitue, très clairement, la complexité du travail de création poétique.
Bibliographie
BERCOFF(Brigitte), La Poésie, Paris, Hachette, Collection Hachette Supérieure, 1999.
BRETON (André), Mont de piété, Clair de Terre, Le Revolver à cheveux blanc, L’air de l’eau, Paris, Gallimard, 1966.
DACO(Pierre), Les Triomphes de la psychanalyse, Verviers (Belgique), Gérard et Co, 1965.
DELCROIX (Maurice) et HALLYN (Fernand), Introduction aux études littéraires, Paris, Duculot, 1987.
DELEUZE (Gilles), Proust et les signes, Paris, Quadrige/PUF, 1998.
GENETTE (Gérard), Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982.
GENETTE (Gérard), Seuils, Paris, Seuil, 1987.
GRAMMONT (Maurice), Petit Traité de versification française, Paris, Armand Colin, 1965.
PROUST (Marcel), A la Recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1954.
ZEPHIR (Jacques), « Nature et fonction de la mémoire dans à la Recherche du temps perdu » in Philosophie, Volume 2, Paris, 1990.
Notes
[1] Guillaume Apollinaire qualifie ce texte de « drame surréaliste » et l’achève en 1917.
[2]Hermann Ebbinghaus (1850-1909). Philosophe allemand souvent considéré comme le père de la psychologie expérimentale de l’apprentissage.
[3] Le behaviorisme désigne une école d’études de la psychologie créé aux Etats-Unis par John Broadus Watson. Considérant que la mémoire est soumise à une absence totale de modélisation, le behaviorisme conteste toute étude introspective et expérimentale de la mémoire.
[4] Ce sont Richard C. Atkinson, Richard Schiffrin, Neal Cohen, Larry Squire … Leurs travaux divergent sur plusieurs points mais ont en commun de postuler, d’une part, à une existence de la mémoire en tant qu’objet d’étude et, d’autre part, de sa probable structuration.
[5] Richard C. Atkinson et Richard Shiffrin sont deux éminents professeurs américains de psychologie. Ils ont proposé un modèle de mémoire en 1968.
[6]André Gide, Les Caves du Vatican (1914).
[7] C’est aussi le siècle de Breton et de son mouvement, le Surréalisme.
[8] N’oublions que Breton est médecin psychiatre de formation.