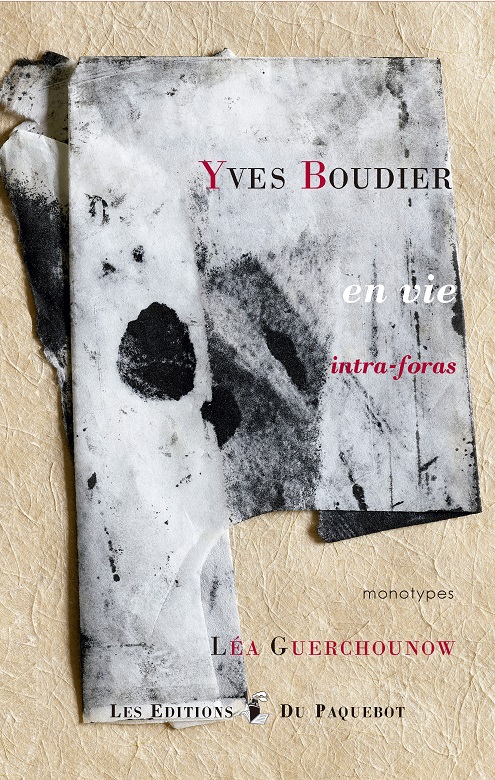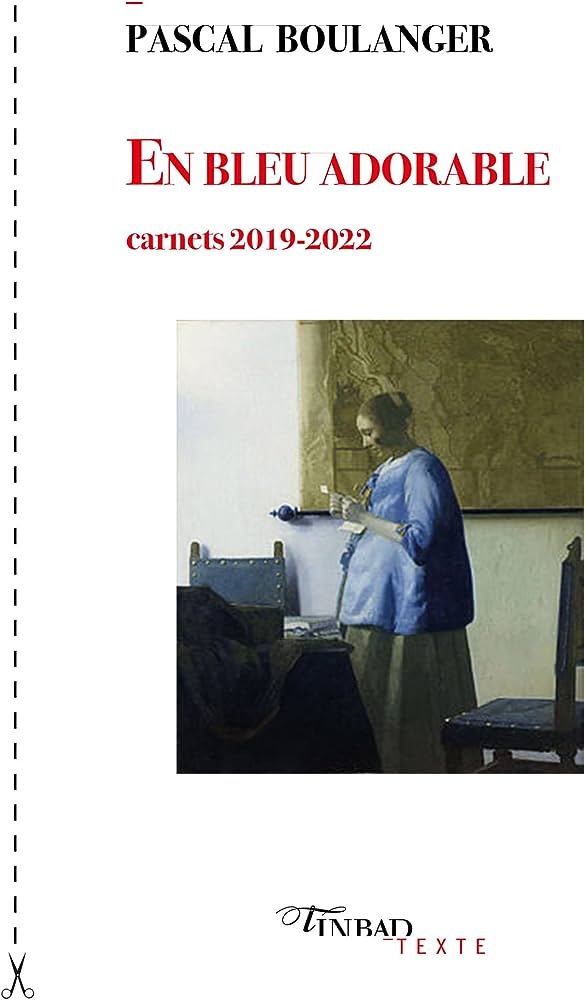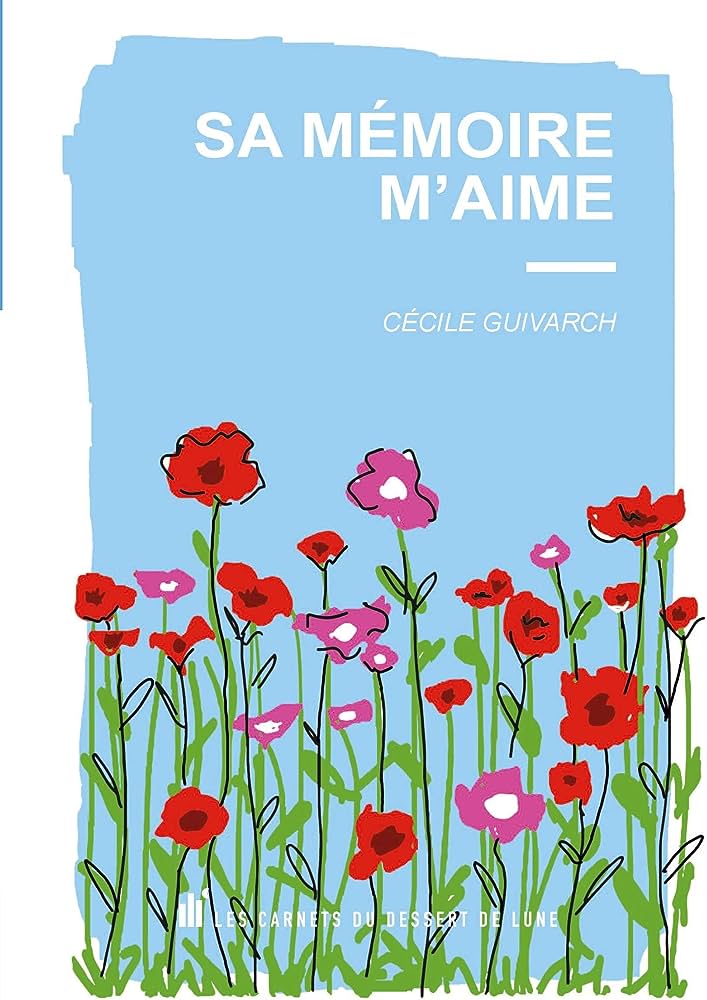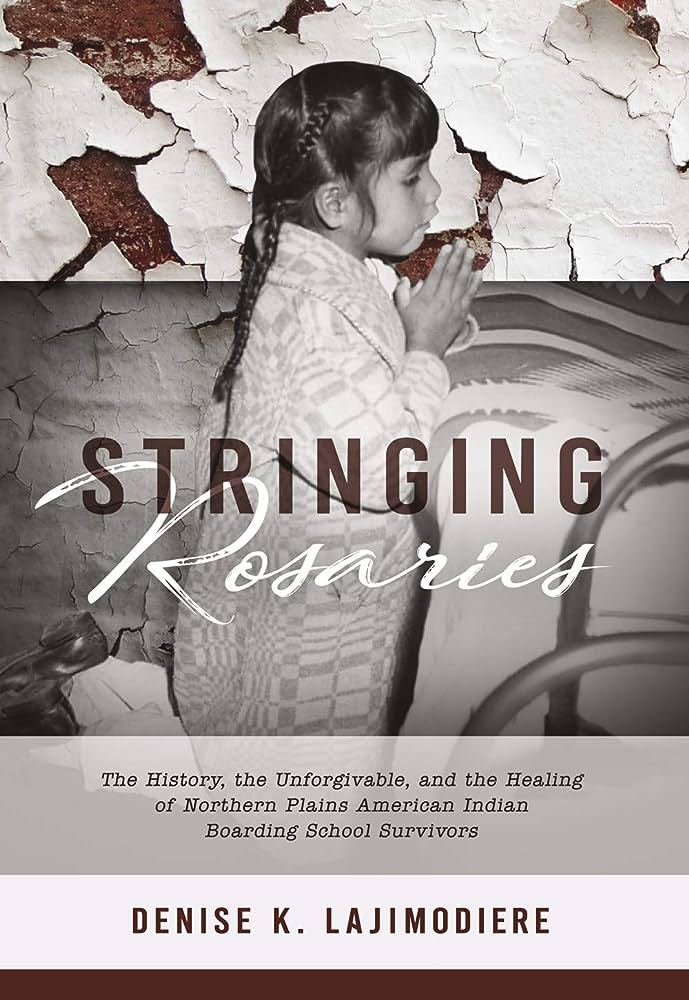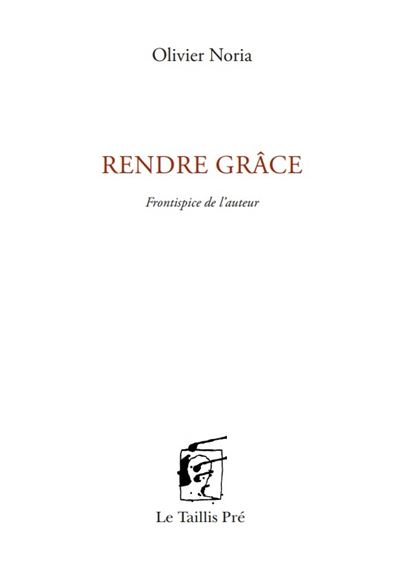Ilhan, qui dit "Budapest, Rome, mais surtout Paris avec persistance" dans l'un de ses poèmes, développa des relations étroites avec les parisiens et les citoyens du monde qui peinent à se tracer une nouvelle voie dans cette ville culturelle, tout en apprenant le français à l'Alliance française. Il est aisé de dire que la ville de Paris occupe une place importante dans la structure poétique que le poète établit à cette époque, tant par les espaces urbains que par l'effet poétique qu'elle crée sur les gens.
moi, l'homme
qui a fait voler ses espoirs comme des pigeons,
a perdu son espoir mille fois,
là où les navires ont été perdus,
et les a retrouvés mille fois.
Le vent sur les boulevards
le vent souffle les dernières feuilles comme des enfants
dans le jardin du luxembourg
Le poète, qui traduisit divers exemples de la poésie française de l'époque en turc grâce à son français qui s’était alors amélioré, commença également à écrire la série de poèmes appelée "capitaine", encore considérée aujourd’hui comme un classique de la poésie turque, combinaison de journaux et poésies, écrits à des dates différentes. Le poète, qui nourrit son art à travers un large éventail d’œuvres artistiques et écrira les scénarios de 15 films par la suite, suivait également de près le cinéma français durant sa vie à Paris. Dans les lettres qu'il écrivit à son frère depuis Paris, il mentionne également le film de 1951 d'Yves Allegret "les miracles n'ont lieu qu'une fois". Non content du cinéma, Ilhan s’intéressa également de près à la Comédie française. Il n'est pas nécessaire de déployer beaucoup d'efforts pour voir l'âme parisienne dans les poèmes d'Attila Ilhan qu'il écrivit à cette époque. Sa déclaration selon laquelle "Paris n'est belle et passionnante que pour les personnes qui peuvent vivre Paris comme si elle faisait partie d'eux-mêmes" est une allégation remarquable pour comprendre comment la ville a pénétré sa poésie. Tout comme Paris, la poésie d'Ilhan mit en scène tantôt l'amour, tantôt la réaction sociale, la danse contradictoire mais réaliste et harmonieuse de la lumière et des ténèbres, des espoirs et des déceptions. Bien qu'il ait toujours eu des amitiés proches, le poète, qui se définissait comme solitaire, de telle manière qu’on pourrait y voir la solitude comme la maladie du poète, disait "j'aimerais aussi me débarrasser de la solitude et être seul" dans son poème. L’artiste vécut l'apogée de ce sentiment à Paris, qu’il transféra ensuite dans sa poésie. Dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si ses poèmes reflètent/sont le miroir des boulevards de cette ville lumière, qui embrasse tant d'obscurité en portant tant de lumière :
j'ai arraché une étoile aux cieux de Paris
l'ai attachée dans tes cheveux
comme un œillet rouge
moi les mains ouvertes à la pluie
moi seul tel un Dieu en enfer
chez les bouquinistes des bords de seine
j'ai trouvé les poèmes de Villon
la rivière était enflée comme un cœur
une semaine durant chaque nuit
j'ai lu quelque chose de Villon
moi qui vis ce que je vis comme une grande religion
tu n'es plus une religion
tu le sais
Traduction Engin Bezci
En tant que poète, je crois que ces artistes ne sont pas des gens qui écrivent ce qu'ils vivent, mais des gens qui vivent ce qu'ils écrivent. Attila Ilhan semble avoir réalisé cette prophétie dans sa vie à Paris, où il portait les livres de Villon et d'Aragon comme s'il s'agissait de livres saints. Cela se vérifie dans le concept de lutte, qui occupe une place importante dans sa vie et qui l'amena à rencontrer constamment de nouvelles luttes sociales dans sa vie individuelle, et cela, souvent dans des moments et des domaines inattendus.
Attila Ilhan décrit Paris, la ville de la lutte et de la révolution, en disant dans ses vers "tous les jets d'eau de la Concorde se dresseront soudain / comme un bout de fer tordu tu sentiras l'arc-en-ciel sur ta nuque". C'est dans la ville lumière qu'il rencontra et tomba amoureux de la fille arménienne, Maria Missakian. Lors de leurs fréquentes rencontres notamment à Saint-Michel, ils essayèrent d'établir une famille ensemble. Ils parlaient de l’avenir qu’ils envisageaient ensemble, et le poète le porta avec toute son intensité dans ses poèmes, qu'il rédigea à Paris. Cependant, en raison des relations turco-arméniennes de l’époque ses plans échouèrent et le jeune couple dut mettre fin cette relation parfaite.
c'est encore le soir Attila Ilhan,
d'ailleurs tu es seul et étranger à l'automne
peut-être à Paris, Maria Missakian,
avec sa douleur d'une croix à la main,
tous les soirs, elle rêve de venir te voir secrètement par une nuit misérable,
en étranglant Paris
comme si elle étouffait son propre enfant
L'esprit maternel et fertile de Paris, qui donne vie à ses enfants poètes, montra son effet sur la vie d’Attila Ilhan quand il revint en Turquie. Dans les cafés d'art d'Istanbul, qui ressemblaient alors aux cafés parisiens de l'époque, Attila Ilhan racontait la poésie française et le socialisme à la jeune génération turque intellectuelle qui le qui le suivait. C’était une période où les débats intellectuels étaient fréquents en Turquie ainsi que dans le reste du monde. A l’époque, le poète Attila Ilhan, qui portait toujours la Méditerranée dans sa poche, lança le mouvement de poésie qu’il baptisa "bleu", sans trop de surprise. Cette compréhension, qui tint essentiellement à dissoudre l'image dans le sens, s'inspira de la poésie française de l'époque, mais différa de celle-ci, en construisant une structure poétique originale au sein de sa propre culture. Bien qu'elle soit adoptée par certains milieux littéraires, elle fut exposée à de vives critiques de la part d'autres cercles. De retour à Paris en 1960, Ilhan fut contraint de retourner en Turquie après la mort de son père alors qu'il continuait à écrire ses poèmes, pour ne plus jamais revenir à Paris.
Il est toujours possible de converser avec son esprit littéraire dans des cafés comme Au Vieux Châtelet, Le Départ Saint-Michel et Le Lutèce, encore aujourd'hui, lieux où Attila Ilhan écrivit des dizaines de poèmes. "Je saupoudre mes journées comme du blé", déclara-t-il dans une lettre qu’il écrivit à sa famille tout en buvant son café au Lutèce, comme pour souligner l'abondance que Paris apportait à son cadre littéraire. Le poète, qui était conscient de la menace de l'égoïsme qui souhaite se nourrir d'une ville sans la nourrir en retour, était parvenu à s'en affranchir. Il erre encore avec son âme immortelle dans les rues de Paris, où il compose ses vers, au bout d'une plume invisible.