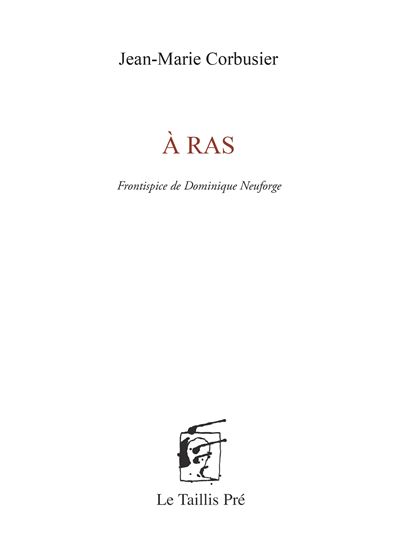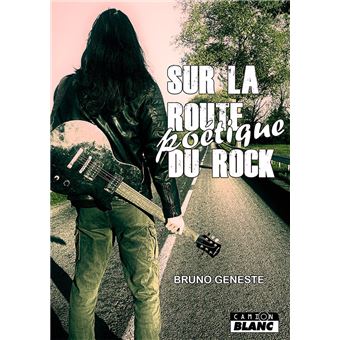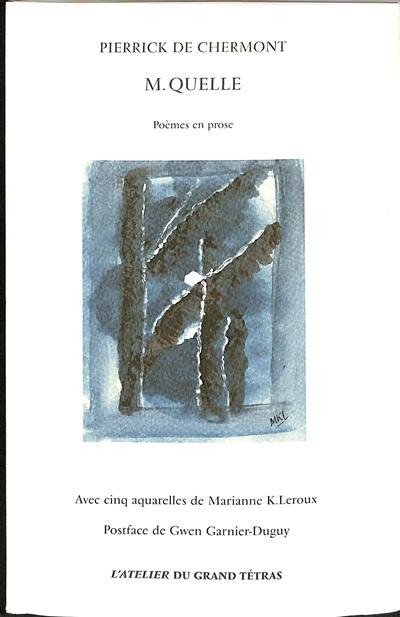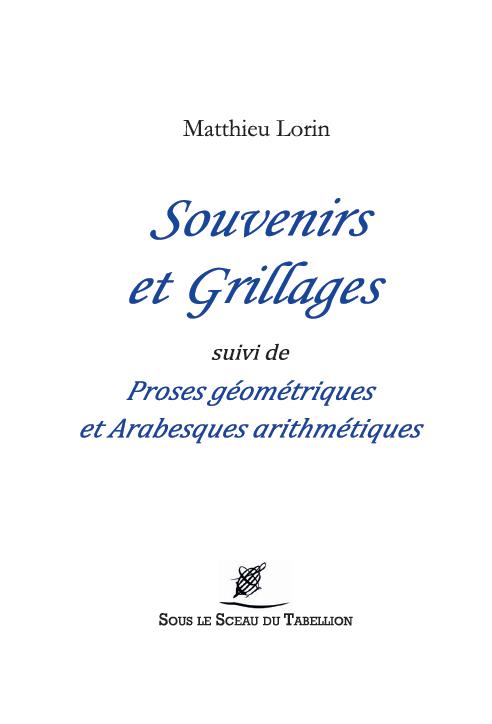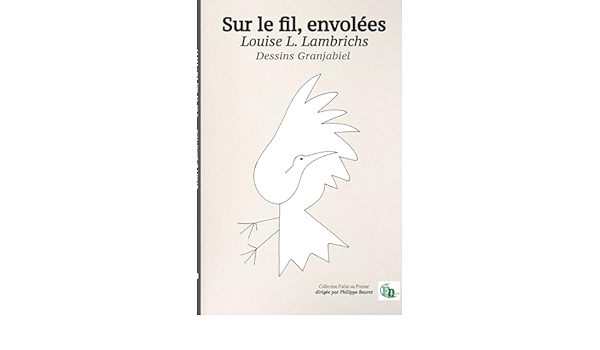Rémi Froger, Ciel et terre
Marche
Ou bien marcher le long de l’eau, un peu ruisseau ou lac, d’un pas indifférent, indiquant d’un geste
la branche tombée, la feuille levée, le bambou d’un jour.
Ou bien il s’est assis sur un bloc de pierre taillé, il s’est assis, il a plongé les yeux dans un livre et
tout se passe dans ce pli d’un homme et d’une pierre, et rien n’y fera.
Ou bien un dessin donné par la main derrière la nuque, une lente lumière au long de la pente aux
oliviers, la main et cette courbe.
Ou bien celle qui serait la même régnant sur le milieu des végétaux, tout cet ailleurs tenant la terre
droite, la statue parfaitement reine, les passés et bien d’autres faits.
Ou bien un peu de jeu, franchir un désert, franchir la lumière brûlante, la barrière brûlante et
continuer jusqu’à la prochaine ligne où roule un ballon.
Ou bien sait-on ce que nous sommes, une course brève sur un sol battu et rebattu, les arbres, les
façades, parallèles, courir droit ou de travers en descendant vers la porte verte.
Le sens se glisse
Le sens se glisse le long des flancs, des torses, des hanches. Le sens se plie, se niche – c’est une
phrase qui ne vient pas d’autre chose, une esquisse – une phrase que nous ne comprenons pas
autrement que l’enfant qui fait des ronds sur le sable avec ses pieds, que la femme qui passe la main
dans son cou pour réunir ses cheveux, que l’éphémère rayon de lumière entre les buts – une phrase
que nous effacerons plus tard quand d’autres signes arriveront.
Un autre sens
Un sens ou bien l’autre ne serait qu’un brouillon. Les signes fument, les images apparaissent à la
renverse, des branches séchant à terre, des cheminées d’usine encore improbables, facettes de
paysages d’hier, d’hiver, tout en brouillards, en givres, en fossés – images retenues par quelque
barrage entraînant le mouvement des turbines, la production d’une énergie invisible, inaudible,
impalpable mais mortelle. Le sens n’en est pas plus éclairci s’il n’est que conséquence de toutes les
péripéties, passages d’un format vers un autre, conséquences fixant et encadrant le déroulé, le défilé,
le brouillon.
Sollicité, c’est à dire arrêté dans la marche, nous nous efforçons, mais d’automatismes et non
d’efforts, nous cachons le signe dans la circonstance quelconque. Ou bien dans sa
circonstance, sa venue et son allée. Le signe, ou le sens qui serait cette chute.
Boue
La boue, personne ne la connaît, elle n’a pas de lieu particulier. Nous nous efforçons de nous y
adapter.
De la boue sont sortis les noms et les lettres, et le nombre des morts, et les tâches accomplies.
De nos mains sont sorties les positions des étoiles dans les cieux, et celles qu’elles tiennent quand
elles tombent sur les champs.
Nous n’avons pas parlé. Nous avons simplement réagi aux terminaisons des doigts, aux vibrations
du manche en bois.
Nous comptons les choses, nous les disposons devant nous, et les rayons d’un trait fin.
Nous avons grandi avec les noms. Nous n’avons pas fini de les chercher.
Celui qui avait scié la pierre connaissait bien cette falaise. Son visage était humide. Les chèvres
broutaient les chardons.
Faire autre chose
Voir et faire autre chose. Une longue coulée verte entoure le canapé, atténuée sur la gauche par la
lumière tombant de la fenêtre. Faire autre chose où le vert est plus pâle, la coulée bien plus floue. Le
rectangle est ainsi fait qu’il est le canapé cerné d’une bande verte. Sur la droite est posée une
commode basse. Le tableau posé dessus est éclairé par la fenêtre, nous le voyons mal. Au-dessus du
rideau la lumière est la même mais teintée d’orange, elle va plus bas vers le pied du fauteuil posé près
de la commode.
Tunnels de lumière. Faire autre chose n’est pas aisé. Si l’on fendait légèrement les bordures, les
murs et les portes, planchers et plafonds, le travail serait facilité. Ou si l’on glissait vers un autre angle,
montait sur le fauteuil, ouvrait les portes et les fenêtres, pour voir autrement ou voir d’autres tunnels.
Mais traiter une autre chose, comment traiter une autre chose, cette autre chose, depuis quand est-
elle rouge ?