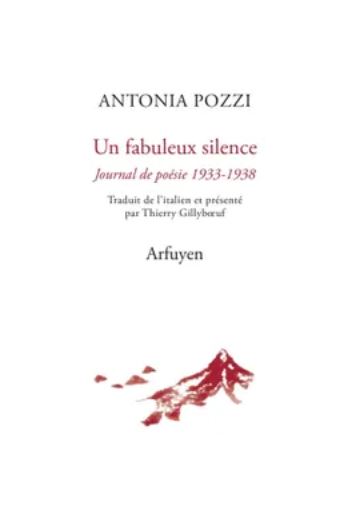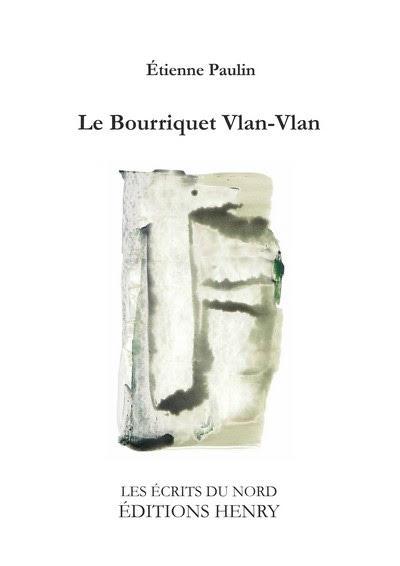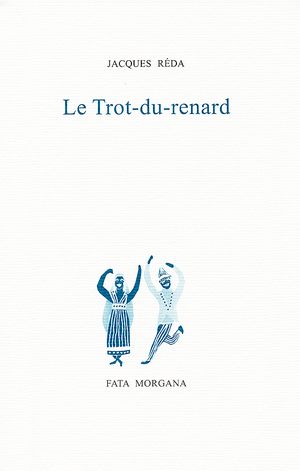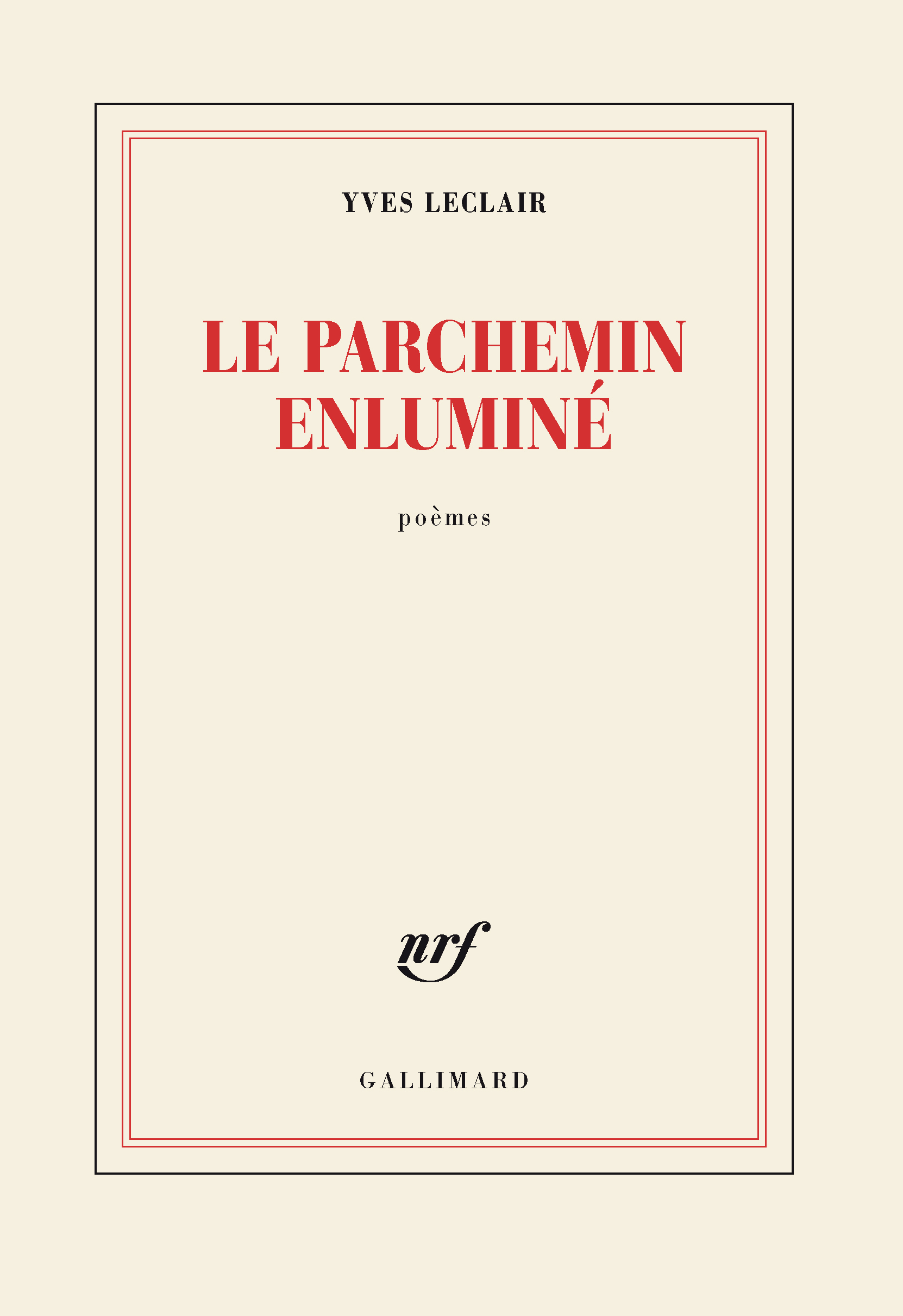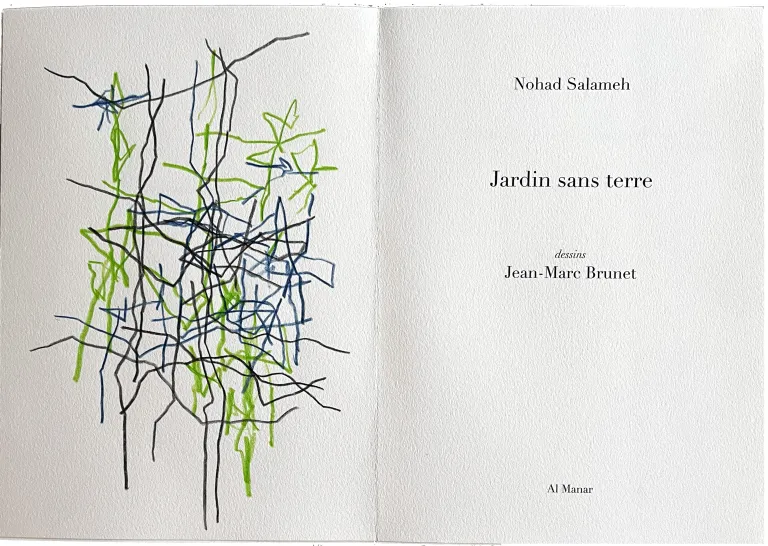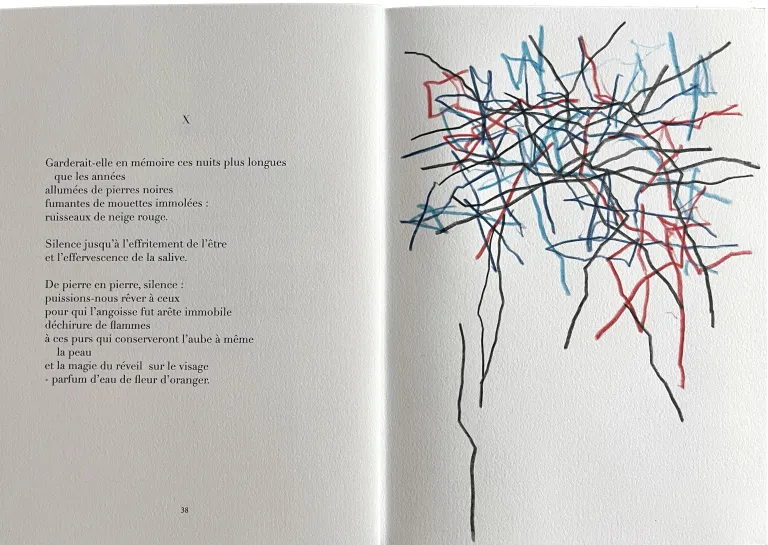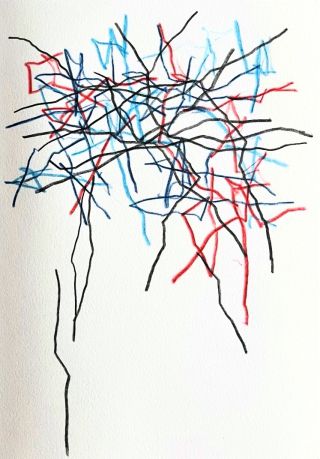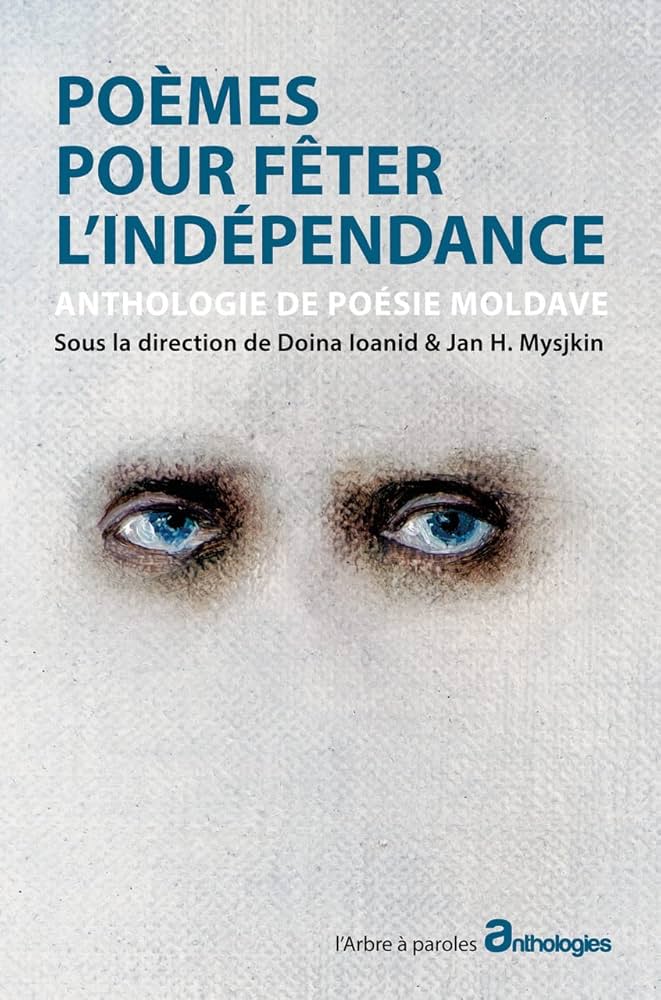L’impasse comme puissance contrariée
Ou l’égarement vers une mortalité maîtrisée :
immaturité de l’esprit qui ne peut concevoir
le naissant et le redevenir-poussière
Ou la course effrénée vers une soif de l’impossible
(ce qui est possible ne sera jamais possible)
Ce qui est possible ne sera jamais possible dans l’impasse
Dès qu’on se rapprochera d’une possible possibilité
Dans ma soif pour l’impossible je me permets
De croire à l’idée d’un oasis mais quand celle-ci
Devient une réalité je n’y crois plus et je me
Mets en situation d’échec
***
L’impasse comme processus
À l’humble endurance des « guerriers sans combat » (I.M.)
Qui placent leur prouesse dans une gloire noble
Mon être est supérieur à la reconnaissance qu’on lui attribue
Car il se reconnaît d’abord lui-même par son désir de créer
(l’œuvre dépasse souvent la mort de son auteur)
***
Lenteur dans l’impasse
Marathon organique et spirituel où
Je questionne ce contre quoi je butte
Dans un temps autre que celui du réel brut
Parfois je ne vois pas ce contre quoi
Je butte car je ne veux pas voir
***
Souffrance & impasse
Ce que je peux voir est synonyme de bravoure
L’épreuve d’un œil ouvert sur son monde interne
Où je contemple le miroir de ma haine soutenue par l’amour
Faire l’impasse sur la haine
Et croire qu’elle est antagoniste
À l’amour est une erreur car
Pour haïr faut-il encore avoir aimé
Pour pouvoir en douter par la suite
Faire l’impasse sur sa propre haine
Revient à tromper l’authenticité
De sa vérité et c’est prétendre
Une certaine imperfectibilité
***
L’émotion d’une impasse
Dans ce qu’elle fait vivre
Au moment où je tombe
(Qui appelle à se relever)
Parce qu’il est nécessaire
De vivre pour mieux
Se connaître Se connaître
Étant une entreprise secrète où
J’apprends l’oublie de ce que
Je ne disais jamais où
J’oublie ce que j’ai appris
À ne pas dire
***
Souplesse dans l’impasse
Où ce qui aliène — le fantasme —
Demande qu’on s’y attache pour
S’en détacher : la peur de ne pas
Pouvoir sauver par exemple —
Le fantasme de sauver — exige
Une gymnastique mentale
Avant de renoncer faut-il reconnaître
La source de cette souffrance
Source de l’impasse
Où la perte me fait
Aveugle d’une infaisabilité
Apparente
Où ce que je sais faire
À l’état de penseur embryonnaire
***
Enfant de l’impasse
Ce vers quoi je me
Risque si je tends
Vers la tendresse
Aventureuse d’aller
Rencontrer cet autre
Qui m’arrache à moi-même
***
L’arrachement de cette impasse
Nous rappelle un départ
Comment quitter « soi » et tout
Ce que ce mot recouvre :
Son attachement à la douleur
Son goût pour la convoitise
Sa hantise, ses obsessions,
Ses limites etc.
L’égo — dans cette impasse
Ne se fie pas à ce qu’il a
Traversé mais traversera
Identifie son être non à ce qu’
Il est devenu mais deviendra
Ne défie pas son existence
Au détriment d’un autre
Ne se méfie pas de l’impasse
Car il passe par elle
Pour la dépasser
PARADOXES — EXTRAITS
ÉCRASE
« écrase », je t’ai dit d’écraser mais je ne me suis pas dit d’écraser,
je t’ai dit « écrase », mais le problème c’est que tu m’écrases même
pendant que je marche et j’ai pensé « m’aime pas en trêve celui-là »
sauf que j’ai penché pour le problème car tu penses comme lui, je veux
dire tu dépenses le problème par des rêves qui écrasent la marche droit
derrière moi car devant c’est très loin derrière, d’ailleurs je suis si près
de mon père que je deviens ce qu’il n’est jamais devenu, alors tu es
revenu à sa place et cette place m’écrase, elle tasse mon petit devenir
pensant qu’il faut toujours penser ce qui va arriver par la pensée même
pendant que je marche et j’ai pensé « m’aime pas celle-là » sauf que
j’ai penché pour la solution mais elle écrase toujours le problème auquel
je repense, que c’est lui chercher un sens qui fait que je ne ressens
pas ce qui veut me trouver devant sans éprouver de ressentiment où
je règle mon sentiment sur toi qui ne peut pas me sentir car je
descends d’un père que le derrière a écrasé pour subir son devant
avant qu’il ne surgisse, alors je continue de marcher pour croiser
l’auteur du problème qui rêve d’une solution comme on écrit son nom,
d’ailleurs comment je m’appelle, tu vas voir qu’on ne peut pas oublier que
c’est moi qui vais revenir car je descends bien d’un père que
le sentiment a donné pour dérégler son ressentiment et marcher tout
en devenant « celui-là » même quand il m’écrase, « m’aime bien
celui-là » j’ai ressenti
CE QUI REVIENT TOUJOURS
quand l’un demande, l’autre répond, toujours, quand je lui demande
pourquoi ça revient toujours, il me répond comment ça ne reviendra
plus, quand je lui demande comment être sûr que ça ne revienne plus,
il me répond pourquoi une telle question, alors je continue de le
questionner car ça revient toujours mais lui ne cesse de répondre que
c’est à cause de la question, que c’est la question qui provoque toujours
ce qui revient, alors moi je demande ce qu’il y a derrière la question et
lui me répond qu’il n’y a que ce qui veut revenir, que c’est devant qu’on
arrête de voir, mais moi je lui demande ce qu’on arrête de voir, ce à
quoi il me répond d’arrêter de voir ce qui revient toujours, alors je lui
demande comment voir sans que ça revienne puisqu’il faut bien
comprendre et lui me répond qu’il n’y a rien à comprendre car ça
reviendrait à se comprendre soi-même — ce qui revient, venant de soi
— et se comprendre soi-même reviendrait à ne pas être, alors je lui
demande comment peut-on ne pas être, lui me répond que c’est en
étant responsable de ce qui revient toujours, alors je lui demande
comment ne pas être responsable de ce qui revient toujours, lui me
répond que c’est en étant responsable de ce qui est en train de venir,
alors je lui demande de m’expliquer, lui me répond qu’expliquer ce qui
est en train de venir fait revenir ce qui revient toujours, que c’est
chercher derrière la question sachant qu’il n’y a rien à voir, que c’est
devant qu’on arrête de voir, ce qui revient toujours, venant de soi, fera
venir autre chose, alors je lui demande quelle est cette autre chose, lui
me répond que c’est cette chose qui déplace la question dans l’en train
de venir, je lui demande alors si ça ne revient pas au même, lui cette
fois me demande de revenir à moi-même
IL N’EMPÊCHE
je ne vois pas ce qui m’empêche car je suis ce qui m’empêche,
il n’empêche que si j’en parle c’est que ce qui m’empêche ne
m’empêche pas complètement, je sens bien que je peux m’autoriser
encore à ne plus être empêché, ça commence comme ça, c’est une
question d’adresse, il y a quelque chose qui veut s’adresser à un autre
pour être autrement parce que sinon je suis toujours ce qui m’empêche
et non celui que cette chose n’empêche pas mais cette chose ne
fait que vouloir car elle questionne l’adresse au lieu d’y répondre
directement par l’adresse pour justement voir ce qui empêche, si
c’est l’autre, moi ou les deux, il se trouve que c’est souvent les deux
quand on choisit une adresse que l’autre refusera, sans le savoir
évidemment, cela s’explique au moment où on nous a refusé cette
chose qui nous autorise d’accepter ce qui nous empêche car on ne peut
pas tout accepter ou alors tout accepter différemment, c’est-à-dire
accepter de ne pas être accepté sans chercher de raisons, en se
persuadant par exemple que tel autre nous refuse parce qu’il se
refuse lui aussi de voir, de voir ce qui l’empêche, à la différence qu’il
le dissimulerait, en interprétant donc ce qu’on prête à soi comme vrai
mais qui nous empêche de vraiment vivre tel ou tel autre comme une
part de soi qu’on voit mourir pour pleinement renaître, je vois ce qui ne
m’empêche pas car je ne suis pas ce qui m’empêche
AIME
Il t’aime tel qu’il ne s’aime pas, comme il n’est pas, mais ce que tu aimes
c’est qu’il ne t’aime pas ainsi car si en plus tu dois aussi t’aimer, ça fait
beaucoup, ce que tu aimes c’est qu’il aime ce que tu n’aimes pas chez
toi, vous êtes deux à chercher l’amour chez l’autre qui a trop aimé vous
le prendre, je veux dire que cet autre n’était pas prêt à le laisser vivre
comme il l’a donné malgré lui, on peut penser qu’il le voulait au point
d’y penser, jusqu’à ne rien faire que toujours le reprendre pour ne jamais
être surpris, puisqu’il faut bien garder l’amour contre soi et ne pas
regarder qu’il provoque, autrement c’est trop de place dans une place
vide, je parle de ce qui ne veut pas parler car en aimant il donne sa
place sans savoir que tu la lui donnera à ton tour, de sorte qu’on
tourne autour de cette grande place qui vous tient dans une
contenance où l’on retient le déplacement, celui de deux êtres au sein
d’une même place qu’ils partagent, sans quoi c’est chacun sa place
et il manquera toujours un peu de chaleur pour manquer le froid qui
envahit le manque parce qu’il serait trop envahissant, c’est sûrement par
peur d’être envahit, envahit par lui, mais on comprends bien que ce qui
l’envahit c’est de pouvoir être l’objet de ce manque car c’est un objet
qui prend la place du sujet tandis que le sujet lui, vit le manque comme
un pouvoir se renonçant à prédire ce qui pourrait l’abolir, encore faut-il
reprendre sa place sans chercher l’amour chez l’autre qui a trop aimé
vous le prendre puisque cet autre n’est plus vous :
il t’aime tel qu’il s’aime, comme il est, ce que tu aimes c’est qu’il t’aime
ainsi car ce que tu aimes c’est qu’il aime chez toi ce que tu n’aimes pas,
qu’il t’aime comme tu es tout comme ce qu’il aime chez toi c’est que tu
l’aimes, comme il est
INDIGNE
il justifiait ses plaintes avec l’injustice d’un monde qui avait échappé
à son propre monde dont il s’était fait l’étranger, sans le savoir, car
il défendait, comme un jouisseur défendu, ce qu’il ne pouvait défendre
à l’intérieur, un jouisseur d’extérieur que retient sa jouissance dans ce
qu’elle procure, naturellement, une jouissance bien en place qui ne
change pas de place et ne se trompe pas de monde, on ne règle pas
un problème, on dérègle une solution, toute solution étant un raccourci
qui rallonge l’étendue du problème car toute solution est de croire
l’autre monde à notre portée comme si cette portée était mondialement
accessible mais c’est en fait ne pas croire au monde que nous
intériorisons, ou alors c’est vouloir mondialiser ce qui a été localement
mis sous silence, à titre personnel, où chaque projection vers l’autre
devient le titre d’une grande page de couverture sans livre à vouloir livrer
la vérité d’un sauveur qui peine à se sauver car c’est matraquer l’objet
de sa peine comme on traque un rebelle qui braque ce qu’on a chouré
chez lui, une cause qu’il s’est approprié pour ne pas s’occuper de la
sienne, je parle de la cause qui ne cause que sur lui-même et pas sur
ce qui le provoque en écho, à ce qu’il a vécu comme provocation, en
écho de coco, envieux de ce qu’il n’a pas eu parce que le coco envieux
veut absolument tout avoir sauf son être, ou alors en écho de bobo qui
s’écoute parler du monde entier, monde qu’il divise en deux pour
simplement faire entendre soit une haine sans amour soit un amour
sans haine selon ce qui l’arrange dans telle ou telle situation,
parce que l’oppressé évoque avant tout son impossible vocation, celle
de ne pas être devenu cet oppresseur rencontré à la naissance,
d’ailleurs, ce qu’il déplore provient d’un manque dans ce qu’il n’a pu
explorer, un pleureur qui questionne l’objet de ses pleurs, un pleureur
en quête de sujet : il justifie l’injustice du monde avec ses plaintes que
son propre monde laisse échapper et dont il se fait l’héritier
PAS DE PROBLEME
il voulait ce que je ne voulais pas, je voulais ce qu’il ne voulait pas, c’est
pas toujours facile, nous sommes deux à vouloir, vouloir différemment,
que nous soyons deux n’est pas problématique, c’est bien normal,
la problématique c’est de ne pas s’entendre sur le vouloir car chacun
veut être pleinement lui et pas l’autre qui veut l’être aussi sauf que ça
peut devenir un problème où l’un empêche l’autre d’être et inversement
alors on finit par vouloir que l’autre ne veuille plus ou alors ne veuille
plus que ce que l’autre veut sauf qu’à ce rythme on piétine sur l’être qui
se relève avec de moins en moins d’être qui voudra de plus en plus
contenir ce qu’il veut pour de vrai car celui-ci apprend à ne devenir que
cet autre pour le garder, c’est en réalité un faux problème car on peut
bien vouloir à deux et même différemment, que nous soyons deux n’est
pas problématique, c’est bien normal, la problématique c’est de ne pas
vouloir s’entendre car chacun n’entend que ce qu’il veut et l’autre aussi
sauf que si chacun entend le vouloir de l’autre ça ne deviendra plus un
problème et l’un n’empêchera pas l’autre de vouloir car si je comprends
ce qu’il ne comprend pas, qu’il comprend ce que je ne comprends pas,
ce sera plus facile de vouloir ensemble comme deux êtres vivant
pleinement leur vouloir, chacun pourra exister pour l’autre sans
disparaître et à ce rythme au contraire on sera porté sur l’être et quand
il piétinera de ne plus être on le relèvera avec de plus en plus d’être qui
voudra de moins en moins contenir ce qu’il veut pour de vrai car celui-
ci apprendra à devenir avec cet autre pour cette fois le regarder, ce n’est
plus un problème
IL N’Y A PAS MIEUX
Il n’y a pas mieux, je me dis, pas mieux que toi, dans ce que tu fais,
pourtant je ne te connais pas, je n’ai aucune idée de ce que tu te dis,
peut-être tu ne te dis rien de ce que je me dis, peut-être que c’est normal
pour toi, peut-être tu te dis même, qu’on peut faire mieux, voir qu’on fait
mieux, ailleurs, je ne sais pas, en tout cas, je sais qu’ailleurs, il n’y a
personne, car ailleurs, on ne sait jamais et si je crois qu’il y a quelqu’un,
ce n’est que moi qui me voit en un moi qui voit tout ce qui se fait de
mieux, un grand moi qui se revoit quand il était un petit moi, qu’on a
voulu grandir, parce que la grandeur dépassait ces autres moi dans ce
qu’ils avaient de trop ou de moins, ce qui les poussait à me repousser
jusqu’à ce que moi je les repousse pour grandir par moi-même, alors
il n’y a pas mieux, je me dis, pas mieux que moi, dans ce que je fais,
car ce que je fais n’est pas ce que tu fais, c’est facile à dire, pourquoi
ce que tu fais est ce que j’aimerais faire,
pourquoi je n’aimerais pas faire ce que tu n’as pas fait, je me connais
pourtant, j’ai bien une idée de ce que je me dis, peut-être tu n’es rien
d’autre que cet autre que je n’ai jamais voulu être mais que je suis
devenu, faute de moi, peut-être que c’est normal pour moi, peut-être
je me dis même qu’on ne peut pas faire mieux voir qu’on fait bien mieux,
ici, je ne sais pas, en tout cas, je sais qu’ici, il n’y a que moi, car ici, on
sait toujours, et si je crois qu’il y a un autre, ce n’est que toi qui me voit
en un moi qui voit encore mieux que ce qui se fait de mieux, un petit
moi qui se revoit déjà avoir été un grand moi, qu’on a voulu diminuer,
parce que ces autres moi ne dépassaient pas la grandeur dans ce
qu’elle avait d’indépassable, ce qui la poussait à me pousser jusqu’à ce
que moi je la repousse pour me grandir moi-même
TRANSGRESSION
il voulait transgresser le pouvoir de sa graisse qui le transportait
lentement comme chaque pas qu’on reporte pour asseoir une paresse,
c’est pour ça qu’il voulait grandir son paraître et snober l’authenticité
trompeuse de cette graisse ou plutôt faire apparaître l’endurance de
son origine tout en épurant son corps, il voulait transformer sa pensée par
l’abolition des questions et des réponses car ni l’un ni l’autre ne pouvait
pas nier le chemin qui chemine dans le pas même surtout quand ça
glisse, parce que c’est là qu’il voulait transgresser la loi du sol qui
l’engraisse avec son goût pour la paresse en arrêtant de vouloir, il avait
alors décidé de voir, de voir à l’extérieur de lui car à l’intérieur on veut
toujours croire à ce qui empêche le pas et dépêche la paresse qui
dissimule sans dire la détresse au lieu de rencontrer son désirant en
train de désirer autre chose que ce qui devait absolument le désirer
car dans ce k ce sera toujours la déception d’un k venu pour analyser
le manque jusqu’à l’anesthésier, histoire de rester dans l’histoire,
une histoire qui manque le présent à venir pour désirer son désir absent,
il racontait alors comment régresser l’amenait cette fois à engraisser
la transgression de son pouvoir qui le transportait rapidement comme
chaque pas qu’on porte pour grandir une paresse, c’est pour ça qu’il
ne paraissait plus mais transgressait dans l’apparition, faisant
apparaître l’origine de son endurance tout en incorporant son épurant,
il pensait l’abolition par la transformation des réponses en questions