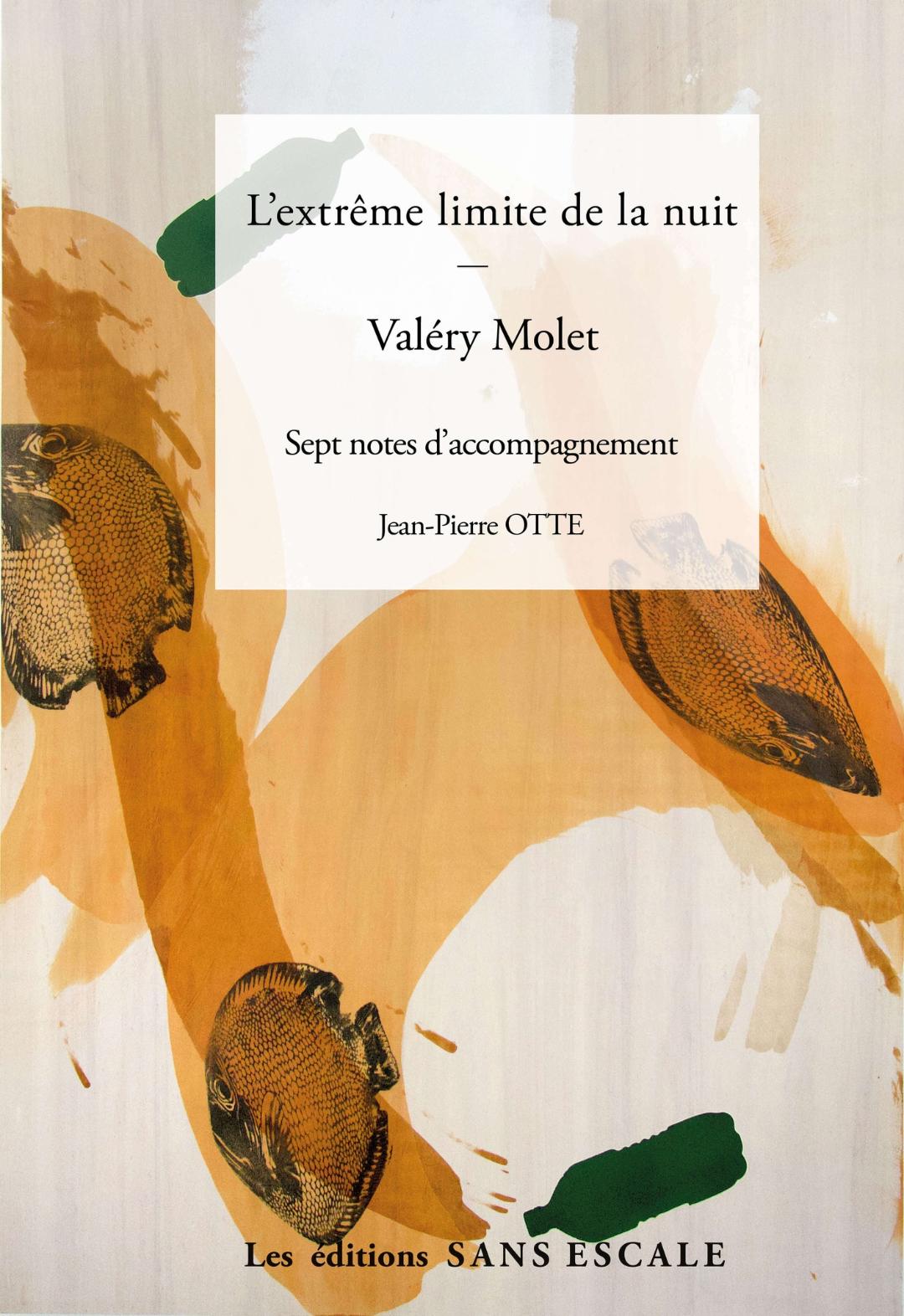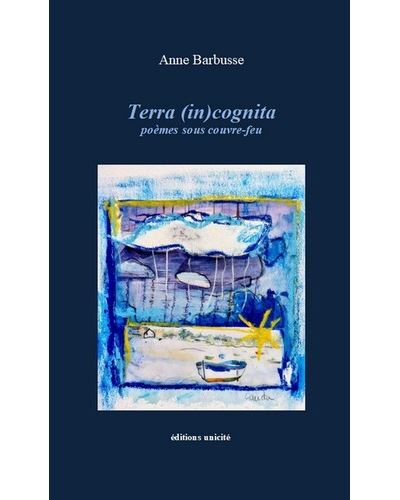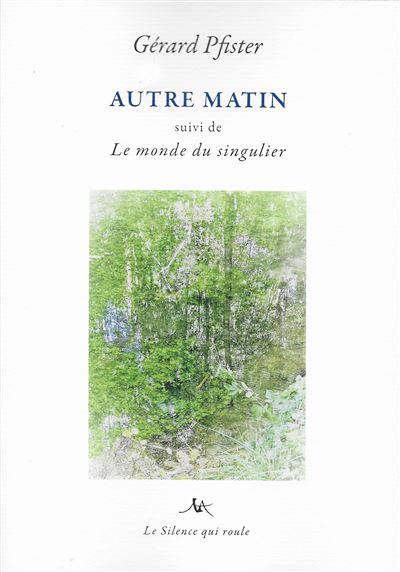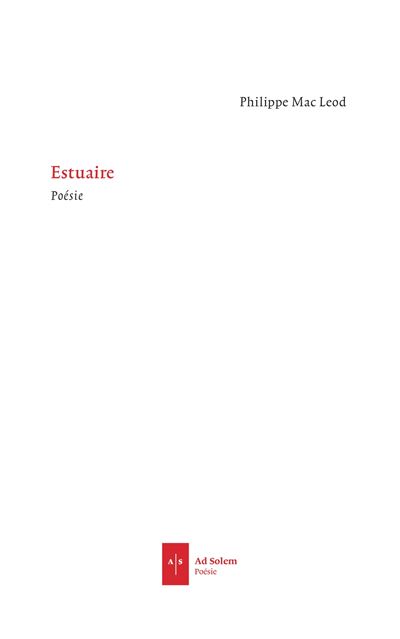On ne peut pénétrer dans la culture des Natifs sans se situer vis-à-vis des quatre points cardinaux qui leur donnent une relation géopoétique avec la terre. Ainsi Béatrice Machet évoque-t-elle les quatre vents cardinaux dans un superbe poème chiastique, « Rafale 49 » (76) :
Vent.
Chinook.
Squamish.
Williwaw.
Souverain de
l’espace entre ciel et terre entre ciel et
mer.
Aquilon.
Auster.
Eurus.
Zéphir.
Les compagnons à travers
l’espace.
En regard des quatre vents français cardinaux qui ont leur origine dans la mythologie grecque et romaine, il n’y a que trois vents natifs. Si le chinook correspond au zéphyr en étant un vent d’ouest chaud et humide venu du Pacifique, le squamish est un vent du nord glacial qui souffle de l’Arctique vers la Colombie britannique et le williwaw est un vent d’est froid et violent qui descend des montagnes et souffle du détroit de Magellan jusqu’au Groenland. Les deux vents froids définissent le climat dans lequel Béatrice Machet a effectué ses périples hivernaux sur les bords du lac Michigan. Elle souligne l’importance de l’ordre quaternaire dans « Rafale No. 40, » citant les rythmes des saisons, des ordres d’existence, espèces animales, et races humaines, dans les niveaux de rêves et les opérations de l’esprit, les étapes de l’existence humaine, les circuits à suivre, les arbres de vie « plantés aux quatre coins » avec « la cérémonie. . . jouée en quatre actes » (64). La créativité poétique prolonge ainsi la pensée native à son diapason, ouvrant des possibilités infinies.
Comment ne pas être sensible à l’appel de ces grands vents venus de très loin, porteurs de traditions immémoriales ? Ils font désapprendre, voir et sentir différemment. Ils forcent la poète à se dépouiller de ses habitudes. Se perdre. Marcher à l’infini pour se vider, pour faire silence. Epouser le vent. Devenir une avec la nature, les arbres qui cassent sous la glace, les oiseaux. Se recueillir en elle-même. Voir le temps « reculer au fur et à mesure que je marche » (29). C’est seulement alors que le vent sauvage et libre qui dans la froideur et la blancheur d’un hiver de neige et de glace ne porte ni senteur ni couleur, s’équilibre entre force vive et force ravageuse. Être au bord du lac, c’est comprendre qu’il est « une part du ciel comme il est part terrestre d’une danse nuptiale jouée en noir et blanc » (66).
Tantôt la poète se laisse posséder par l’anglais, tantôt c’est la langue potawatomi qui nous introduit au cœur de ses promenades. Rafales est un livre trilingue, chaque langue étant une référence culturelle étagée. Partant du français, sa langue maternelle et poétique, Béatrice Machet utilise des expressions américaines qui indiquent sa familiarité avec un monde anglophone remarquable par sa brièveté linguistique de bâtisseur d’empire. Les mots potawatomi sont soit répétés en français dans le poème, soit cités dans un glossaire difficile à découvrir et dont la position en fin de volume force une relecture, une reprise de contact en profondeur avec la culture native figée en résistance contre la langue américaine du devenir.
Chaque plage a un sujet différent. Forest Park Beach décrit l’environnement géographique, le terrain, la température, et l’expérience de la marche. Illinois Beach State Park ajoute la rencontre avec un gardien natif. À Waukegan North Beach, l’inscription « Notre langue native est comme une seconde peau et fait tellement partie de nous que nous résistons à l’idée de la voir changer constamment » [ma traduction] donne cours à un examen des noms de lieux issus des langues natives. Milwaukee (Millioki, Milleioki, lieu de rassemblement près de l’eau), Wausaukee (de « wassa, » lieu lointain, nordique), Pewaukee, Packwaukee, Waukegan, Waupaca (ville blanche). Suivent, dans cette partie qui est la plus longue du volume, la description de coutumes natives comme la récolte du riz sauvage, puis une description de la marche épuisante qui met la poète en état de quasi-hallucination où le « heave heave heave » dont elle s’encourage fait écho au «hey heya heyo» des Natifs cité en page 34. West Beach et Portage Beach étaient des centres importants de « portage » (mot français adopté par les trappeurs et bûcherons du grand nord) qui indique l’importante activité commerciale entre les natifs avant et après l’arrivée des Européens. Le vers « Qui s’en ira vers le golfe de Mexico à travers l’Illinois River » du poème « Rafale No. 36 « (58) fait référence à l’activité des Natifs entre le lac Michigan et le fleuve Mississippi, au commerce des Indiens des grandes plaines entre le Canada et le Golfe du Mexique (dont la poète respecte l’orthographe mexicaine), puis au commerce des Européens après leur arrivée dans le Nouveau Monde.
« Rafale No. 36, » contient encore deux mots essentiels cités en anglais, « keep safe » et « keepsake. ». Le verbe et le nom, unis dans un cercle parfait. Car, dit Beatrice Machet, l’important est de « garder en sécurité » un « objet de mémoire. » Plus qu’un souvenir et moins qu’un trésor. Un objet chargé d’un poids sentimental, d’un poids de mémoire, garant de survivance. Message central qu’elle nous apporte de ses pérégrinations hivernales. Le livre atterrit sur deux pieds en bouclant cette longue danse avec le vent. La légende de Shawondasee, le vent du sud, nous révèle non seulement le quatrième vent natif, mais l’humour printanier qui le fait tomber amoureux d’une belle blonde étendue sur une prairie. Ayant attendu trop longtemps avant de se déclarer, il découvre que la belle blonde est devenue une vieille femme aux cheveux blancs duveteux – Shawondasee était amoureux. . . d’un pissenlit. Le point d’orgue de cette brève légende remet en suspens le magnifique canto de Béatrice Machet qui continue à nous interpeller longtemps après que nous ayons refermé son livre.