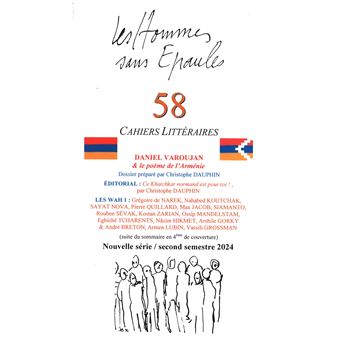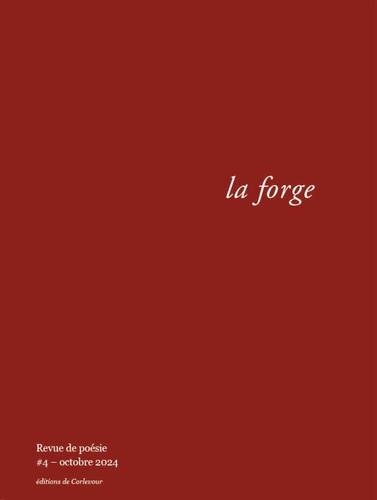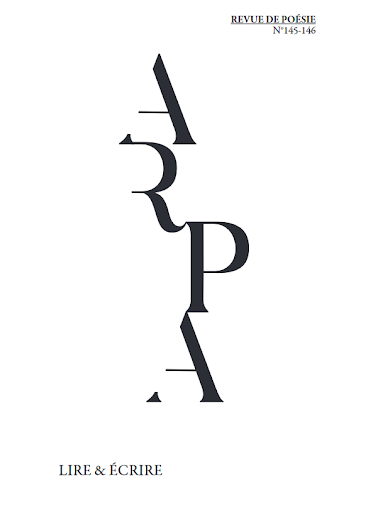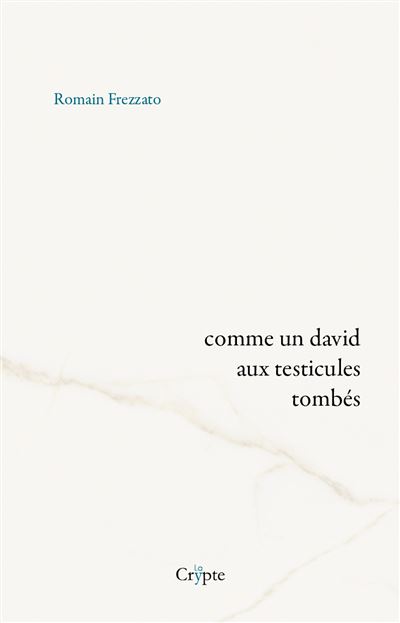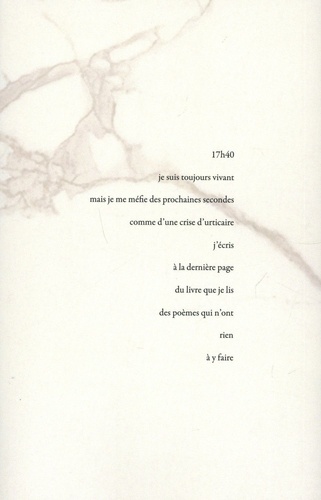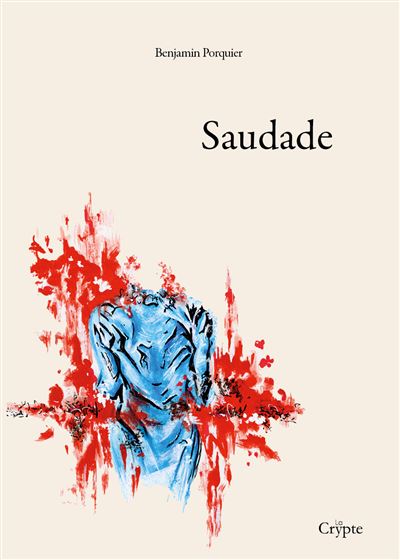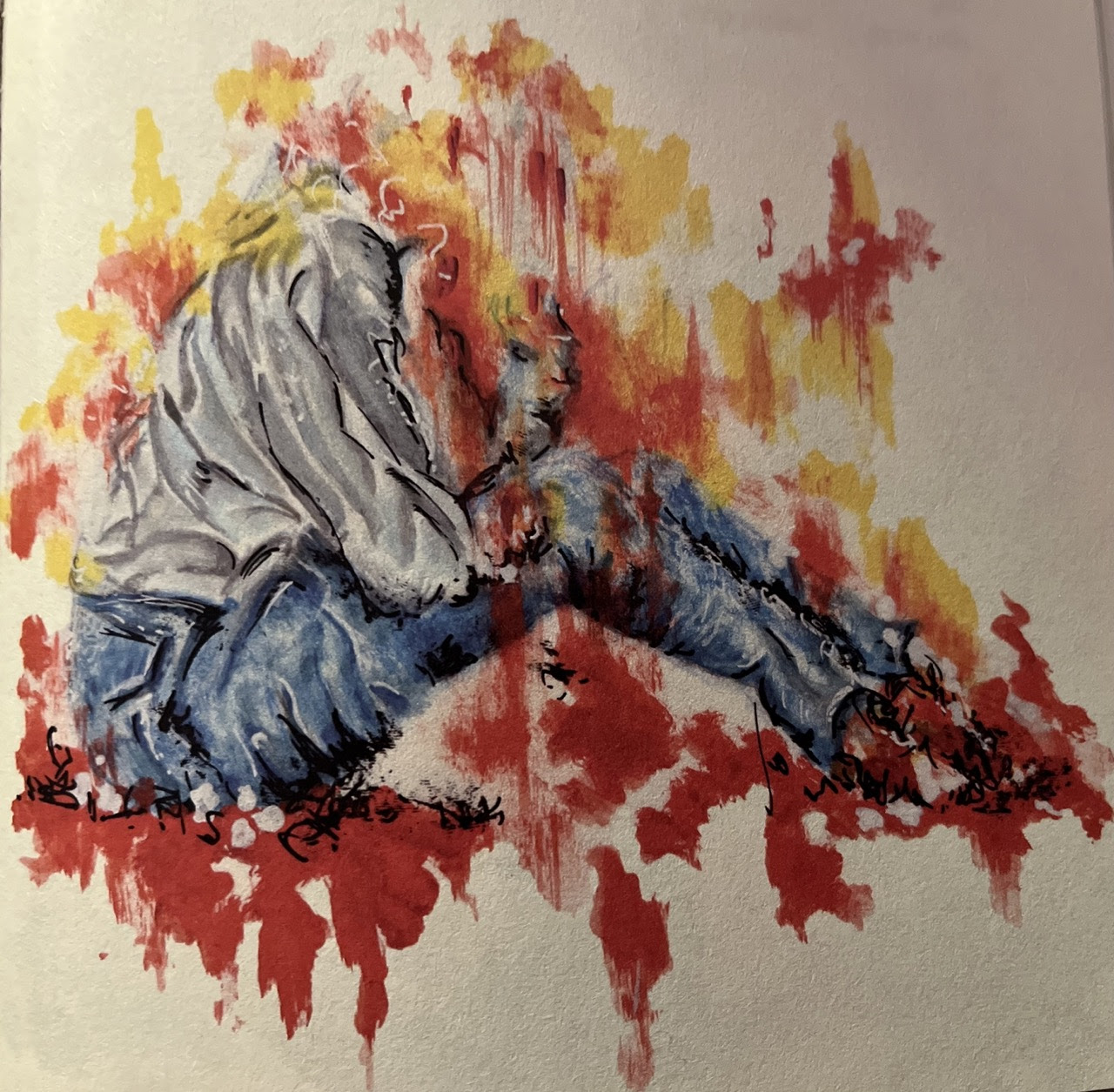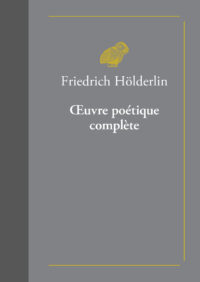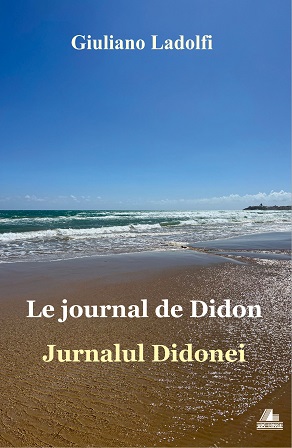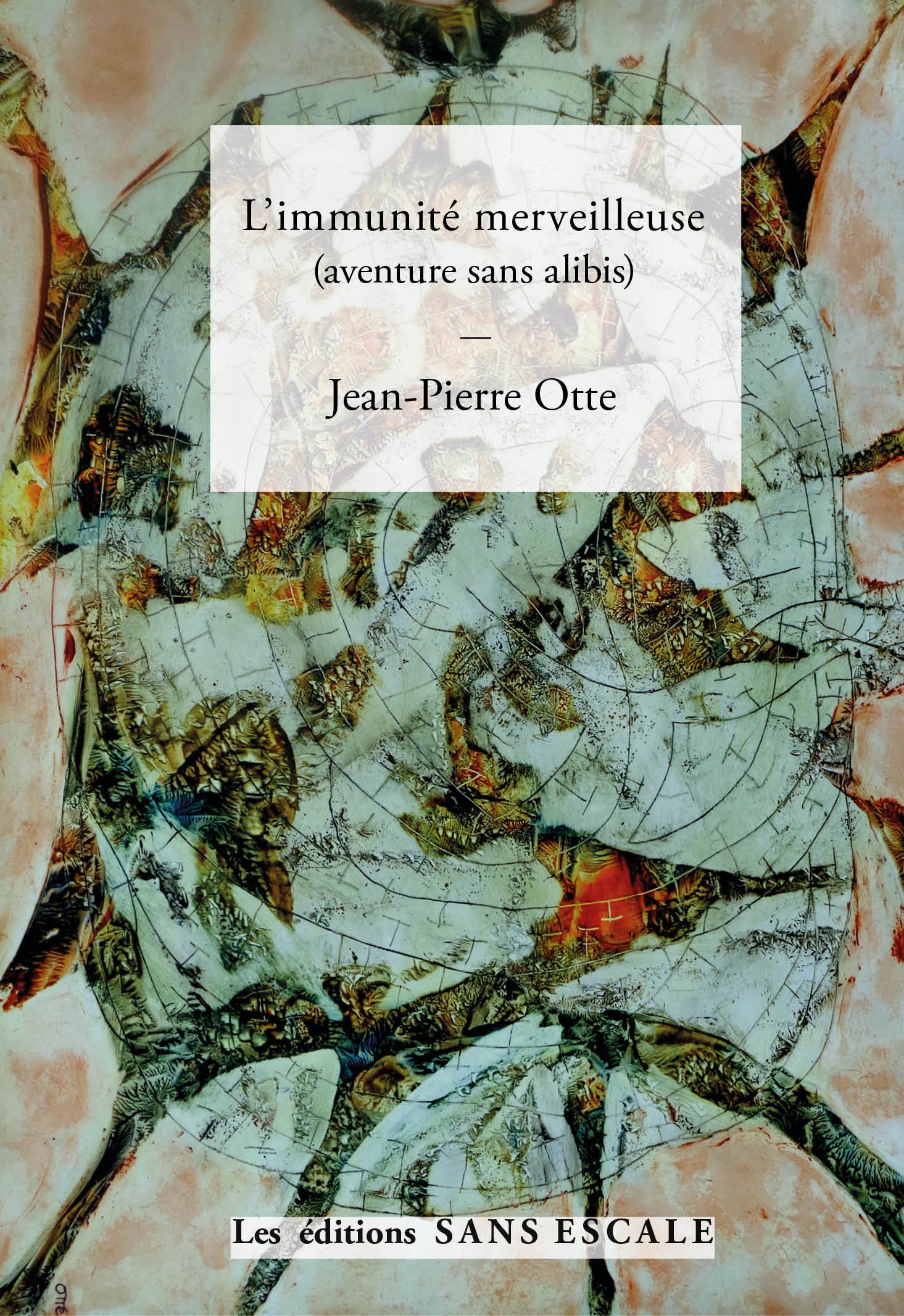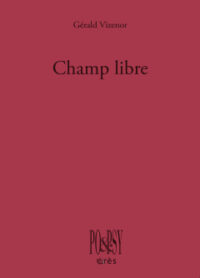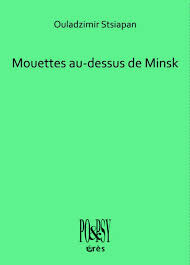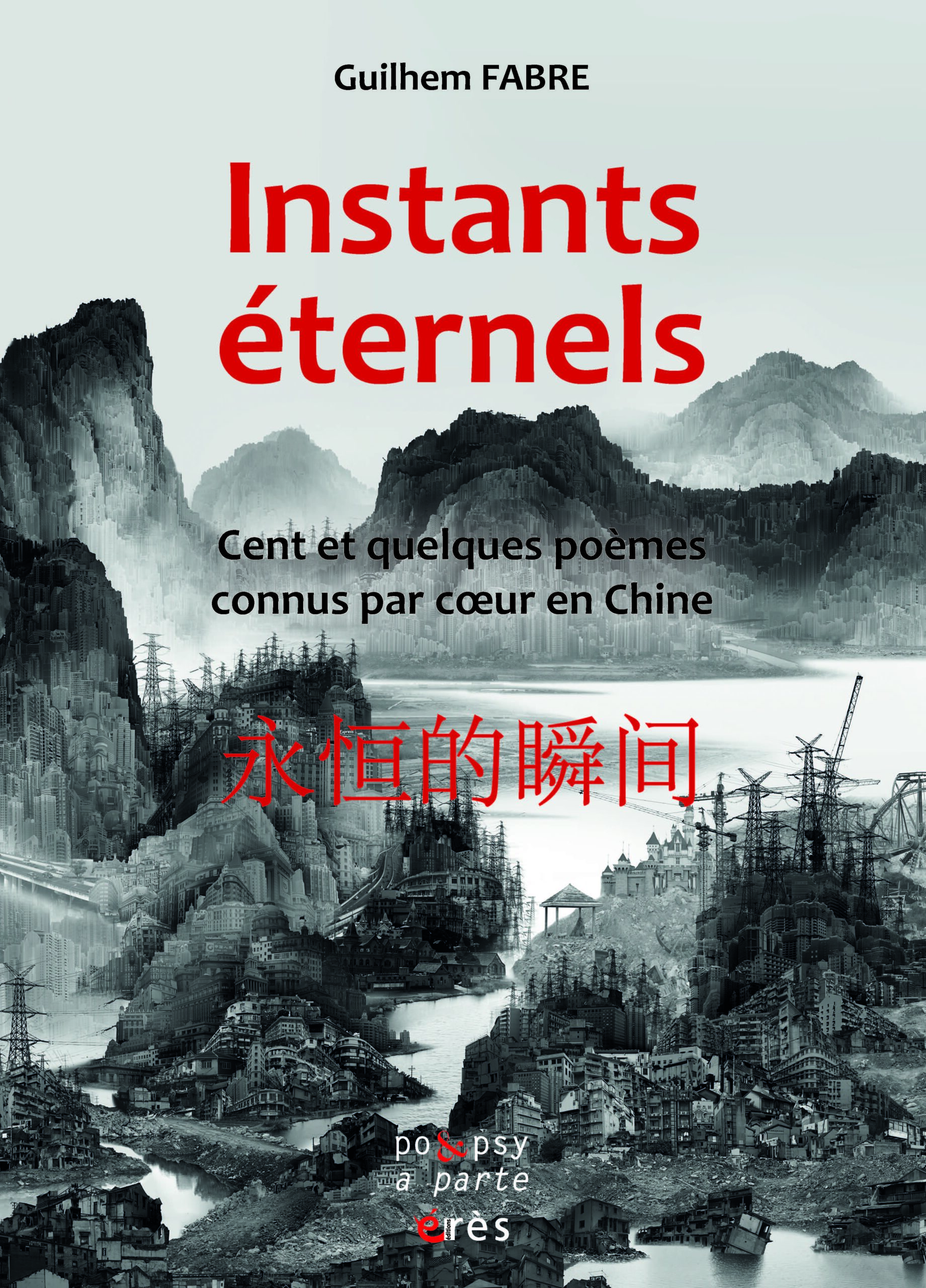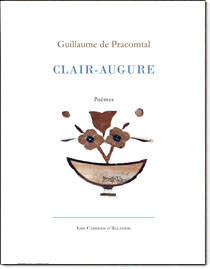Pour bâtir son roman national, le royaume de Prusse identifie quelques idoles classiques : Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller et… Friedrich Hölderlin. Le poète de Tübingen fait l’éloge de la géographie allemande, ses montagnes, les Alpes, ses fleuves, le Rhin, le Main, le Danube, ses villes, Heidelberg, Stuttgart. Idole de la république, il est surtout un citoyen de la Grèce antique qui inspire le génie allemand. Cet héritage de l’Antiquité transparaît, à Berlin, jusque dans l’architecture classique de Karl Friedrich Schinkel.
Le royaume, le pays, la patrie de Friedrich Hölderlin, c’est la Grèce, ses archipels, ses péninsules, ses isthmes. Sa culture classique correspond au désir de l’Allemagne de raviver la flamme de l’Antiquité. On imagine Friedrich Hölderlin, cet archéologue allemand, qui arrive à bon port dans le Pirée. Il est saisi d’aveuglement à Athènes face à l’Acropole, à Delphes face au mont Parnasse, à Patmos face à la grotte de l’Apocalypse de Saint-Jean. Son coup de foudre pour la Grèce est tel qu’il adopte le mètre classique des poètes de l’Antiquité, à l’instar de Friedrich Gottlieb Klopstock. Voyageur du temps, il emprunte le rythme des Anciens, faisant le grand écart dans un abîme de deux mille ans. L’aède de la Souabe s’approprie les mythes de la Grèce, ses dieux, d’Achille à Ganymède, et également Héro, Hercule, Hypérion, ainsi que les Titans, ses divinités, les Parques, Mnémosyne, Sybille, ses poètes, Empédocle et Homère.
Armé de cette lyre de la poésie grecque, Friedrich Hölderlin peut sculpter les frises, orner les fresques, couronner les frontons. Du haut de son mètre soixante-et-onze, Friedrich Hölderlin traite les plus grands mythes de l’Europe, géologiques, les Alpes, le Rhin, la Garonne, géopolitique, Christophe Colomb, scientifique, Johannes Kepler, philosophique, Jean-Jacques Rousseau, religieux, Martin Luther. Depuis les siècles des Lumières, le poète, humaniste et idéaliste, définit les valeurs universelles que sont la liberté, la vérité, la beauté, l’amitié, l’amour, ainsi que la religion, à travers l’immortalité et l’eucharistie.
Après ses tribulations politiques et philosophiques dans la bonne société, Friedrich Hölderlin prend sa retraite. Loin de ses fréquentations de jeunesse, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel à Wilhelm Joseph Schelling, il connaît les plaisirs d’une vie rustique, dans le giron de la famille Zimmer, le menuisier Ernst Zimmer qui a le sens de la mesure. De méchantes âmes placent le vieux garçon qui est fatigué par les épreuves de la vie, à la croisée de la folie et de mélancolie.
À Bingen am Rhein, patrie d’Hildegarde de Bingen, à moins que ce ne soit à Tübingen, dans le Bade-Wurtemberg, aux antipodes de Königsberg, Friedrich Hölderlin trouve refuge. Fou de dieu ou bête de foire, il ressemble à un saint chrétien qui a des visions de béatitude. Dans son fief du Neckar, le poète exilé a l’air d’un prophète de l’Ancien Testament, Élie ou Ezéchiel. Ce brave homme construit, à ses dépens, sa légende dorée dans la poésie universelle. La cité de Tübingen qu’arpentèrent Philippe Melanchthon, Ludwig Uhland, Alois Alzheimer, devient un lieu de pèlerinage, dans le droit fil du sanctuaire Notre-Dame d’Altötting, dans le sud de la Bavière.
Sous les yeux du poète Hölderlin coule la rivière de son enfance qui borde sa mère patrie, Lauffen am Neckar. D’ailleurs, il jouit, à partir du 3 mai 1807, déjà le printemps, des rives du Neckar, affluent du Rhin qui est la colonne vertébrale de l’Allemagne. Dans une vie antérieure, le poète de génie a jeté tout le feu des dieux. De sa poésie au long cours de jeunesse, il se tourne vers une poésie courte dans sa vieillesse. D’un poète majeur, Friedrich Hölderlin deviendrait un poète mineur. Dans sa tour ronde à poèmes, il achève des quatrains, où la rime frappe à sa porte, à l’image du poème « Le printemps » :
Quel bonheur c’est de voir, quand revient l’heure claire
Où l’homme satisfait couvre les champs des yeux,
Quand les humains de leur santé s’enquièrent,
Quand les humains cherchent à vivre heureux.
Le capitaine Hölderlin n’a plus la force physique de naviguer dans les grandes eaux de la poésie lyrique, épique, tragique. Sa poésie, digne d’un journal intime, témoigne d’une forme apparente de douceur et de sagesse. Éternel ami de la Mère nature, il signe un retour aux sources de sa jeunesse, lorsque le poète romantique faisait l’éloge du rossignol, des chênes, d’une lande. Il aborde les saisons, surtout le printemps, car Friedrich Hölderlin naît le 20 mars qui rythme sa retraite, un rayon de soleil ou un chant d’oiseau qui égaie sa journée à travers les deux fenêtres de sa chambre. Dans ses égarements de l’esprit, ses œuvres complètes ne peuvent qu’être incomplètes. En pleine révolution industrielle, entre le charbon et l’acier, Friedrich Hölderlin s’éteint, à l’âge de soixante-treize ans le 7 juin 1843, avant les feux de la Saint-Jean.