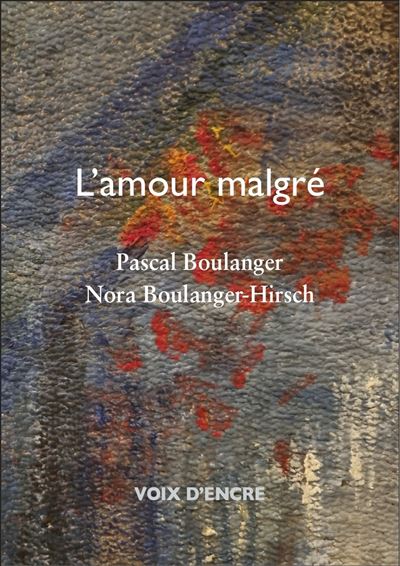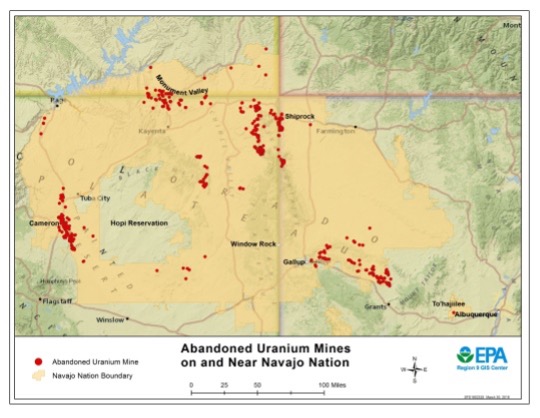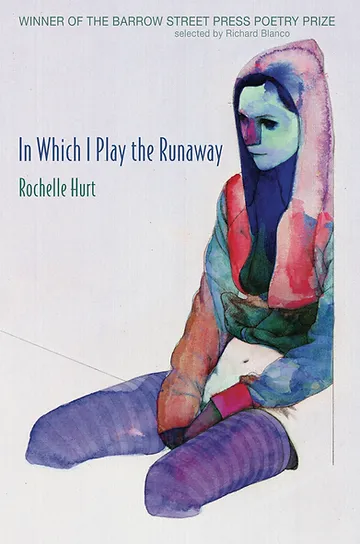Laurent Pépin, Clapotille
L ’incandescente enfance de l’art
Clapotille est arrivée chez moi comme par enchantement via d’invisibles atomes crochus, mais « Je suis mort encore et encore, cette-nuit-là ». C’est dire si le conte – car c’en est un, le troisième d’un fameux triptyque qui a commencé avec Monstrueuse féérie (2022) et s’est poursuivi avec L’angélus des ogres (2023) – fraie dès son orée avec l’obsession, la répétition de l’effroi et surtout la permanence d’une conscience au sein même de la mort.
C’est la magie du verbe ou de toute forme ou folie poétique que d’avaler ses monstres, de les loger dans sa poche, ses entrailles, sa mémoire pour les recracher tout humides d’une salive salutaire, éminemment capable de métamorphose. Et celle de Laurent Pépin est particulièrement saisissante, apte à s’emparer d’un drame familial par tous les mécanismes de ses bars à rêves, à jouer tous les rôles, à donner voix, comme un Ulysse au seuil des Enfers, au père, à la mère, à la fille, à Lucy, au petit Antonin… tous créatures entre deux mondes qui ne cessent de se confondre. C’est qu’il faut parvenir, par ce choral, à juguler la puissance dévastatrice de l’ogre paternel et planter sur sa dépouille des fleurs sauvages protectrices.
On songe à ce rare court-métrage d’animation norvégien, tout aussi exceptionnel dans sa poésie anxiofuge, qu’est Sinna Man (L’homme en colère) d’Anita Killi sorti en 2010 et dans lequel le père enfle et traverse des crises de violence monstrueuses ; mais grâce au roi, il sera soigné dans un paradis asilaire. L’enfançon terrorisé, tout autant que la mère, ouvre au sein de ce cauchemar des bulles de rêve d’une délicatesse bouleversante. Et comme la littérature, onirique en l’occurrence, est un carrefour d’univers qui se subliment les uns les autres, on songe aussi au conte Bonhomme de neige Bonhomme de neige de Janet Frame, paru en 1963 dans lequel l’angoisse métaphysique de la disparition ou de l’engloutissement taraude l’écriture.
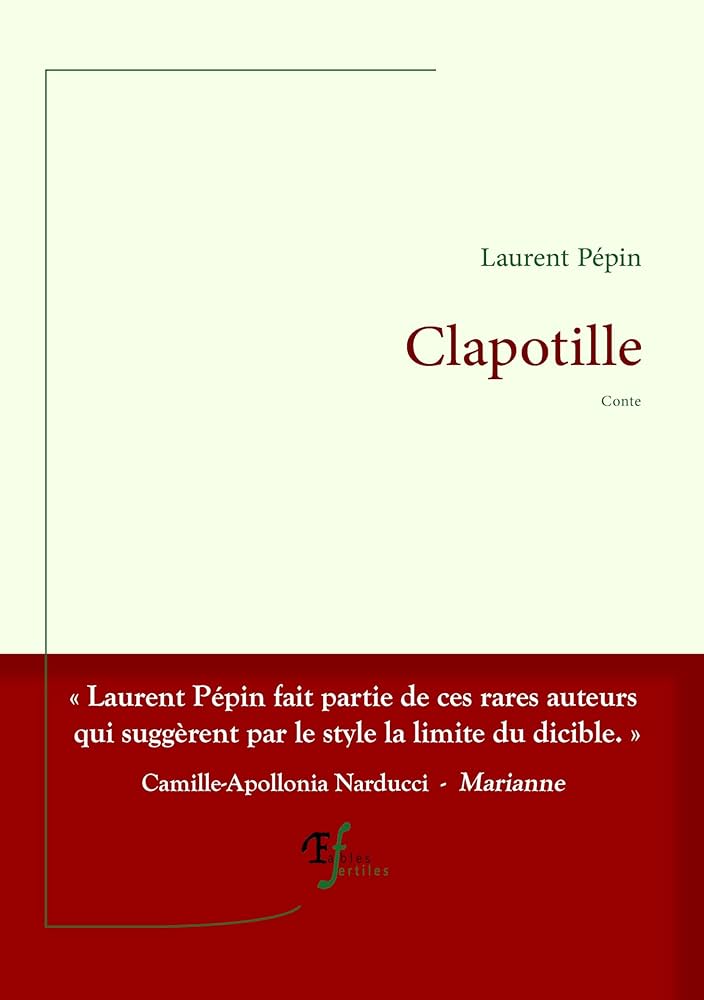
Laurent PÉPIN, Clapotille, Ed. Fables fertiles, 127 pages., 17,50 €.
De façon plus lointaine, la lumière noire de la folie n’est pas sans nous rappeler Tous les chiens sont bleus du Brésilien Rodrigo de Souza Leão où le chaos de la schizophrénie repense cet autre chaos permanent qu’est le monde. C’est bien cela, la poésie, en tout cas celle de Laurent Pépin, un maelstrom cérébral qui vous attire vers des gouffres d’où seule la langue peut vous sortir.
Dans Clapotille, qui n’a peut-être pas conscience de ces trois références, la folie, le rêve et l’angoisse sont portées par une langue incandescente qui se ressource continuellement auprès d’un imaginaire de survie. Les images affluent pour garder la tête hors de l’eau et juguler toute menace imminente par une sorcellerie blanche. Il s’agit de fabriquer du rêve pour réparer les souvenirs, de s’immerger dans une enfance secouée pour lui faire vomir sa viande mal digérée et en faire des merveilles, de détenir la clef de Barbe Bleue pour une reconnaissance des lieux de torture :
« Et devant le bar-à-rêves clandestin, maquillé en commerce de charme afin de tromper la vigilance des autorités, il y a un gardien des clés, officiellement chargé de surveiller les femmes nues dans les vitrines, lorsqu’elles accueillent leurs voyageurs. Quand vous vous présentez à lui, le gardien des clés vous scrute longuement : il attend de vous que vous recouriez à un signe de reconnaissance, chaque Rêveur, même brisé, ayant le pouvoir de troubler le sens formel des mots et de l’illustrer dans les expressions du visage. […] Je m’efforçais de voyager dans le corps de mes femmes disparues, espérant que leur souvenir dissiperait les créatures qui m’observaient dans l’ombre. » Hanté par des voix toxiques, c’est ici le père qui parle.
Il y a dans l’écriture de notre auteur un singulier mélange de simplicité syntaxique, héritière des contes pour enfants comme du parler enfantin, et de densité d’états psychiques qui passent par des images fortes, assénées avec un naturel désarmant - justement. On songe à Hans Christian Andersen, bien sûr. Il s’agit de remonter la pente du souvenir, un pas après l’autre, une voix après l’autre, un fantôme après l’autre, d’épuiser l’angoisse :
c’était épuisant de guetter tout ce qui s’insinuait de sale et d’inquiétant dans les entrées et les sorties du corps.
Et quand on parvient à l’épuiser, un tendre éblouissement nous est offert :
« Souvent, je fais le tour de mes rustines et les décolle légèrement pour voir où ça en est. Derrière, il y a toujours un petit embryon d’astre, pas encore assez mûr pour éclore, mais j’ai mon arrosoir avec moi, qu’il suffit de remplir en traversant un nuage inoffensif à toutes berzingues. »
Heureusement qu’il est encore possible, adulte, de pratiquer l’animisme de l’enfance et d’être capable de jouer à qui serait qui ou quoi. On passe ainsi d’une écriture en italiques à celle en caractères droits, d’un état penché aux prises avec les courants violents à un état droit qui maîtrise sa matière.
Voici bien une œuvre surprenante qui renouvelle notre vision du conte, nous plonge non pas dans l’enfance des enfants mais dans celle des adultes, avec cette puissance nerveuse d’une réflexion poétique sur les ruines de l’enfance, la disparition du réel, la schizophrénie ou la psychose. Psychologue clinicien par ailleurs, Laurent Pépin sait de quoi il parle.