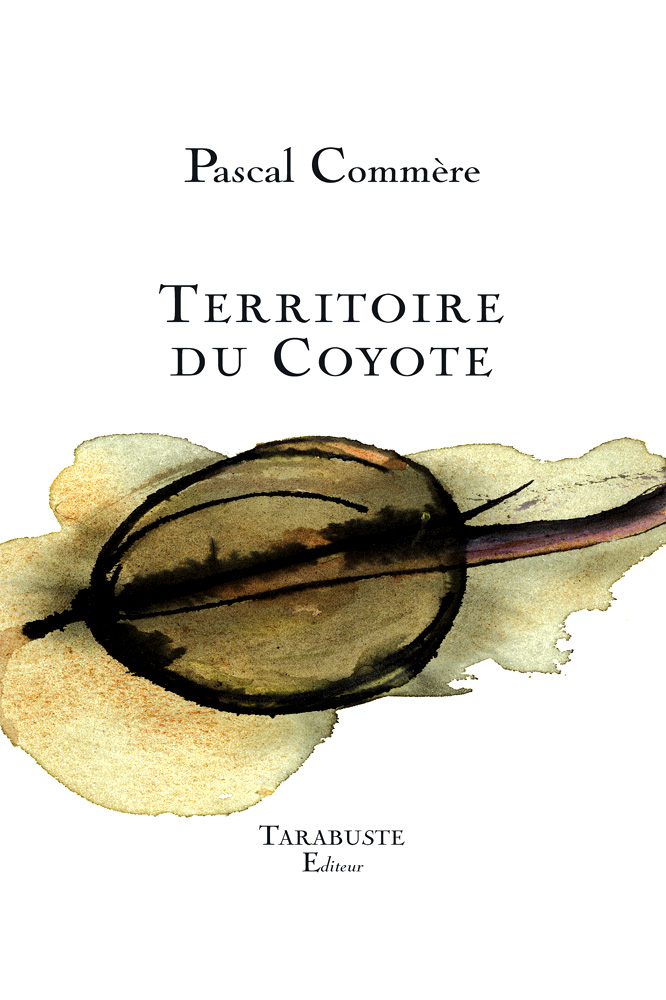La syntaxe, syncopée, défaite parfois de ses liens usuellement tissés par les articles personnels et les particules, opère une coupe franche dans le fouillis d’un réel ici épuré, condensé dans ses lignes/traits essentiels.
Non qu’il fasse froid dans cette poésie de Pascal Commère, mais “un froid qui serre” investit le premier lieu du Territoire du Coyote et la langue élague, taille, coupe, brûle, casse, ce qui n’est pas sans approfondir le regard.
(…)
quelque chose dur, et
rien pour arrêterce qui devant fait arc
loin devant emplit le regardla faille
une ombre surgie
entre deux
Il arrive qu’une simple énumération des éléments successifs d’un champ de vision forme le texte d’un poème. Car sans doute est-ce cela, aussi, l’hiver, une terre de dépouillement où l’observation- voire la contemplation- saisit les paysages de la saison, dans ses arêtes nues.
La neige ses coulées et le gris des bardages
une épave tôle jetée aux orties, le temps
comme en suspens un rajout
de ciment, transformateur poteaux en ligne
des cabanes du gris à vau l’eau,
(…)
Alors que vibre le souffle du vent, que bruits et lumière rayent l’espace hivernal, le silence et la solitude, quelques entités du décor (« un timon bras au ciel, pylônes / un plein d’espace, des éoliennes dans l’air / qui tournent (…)) » creusent leur sillon au ciel, à terre (« Le vent souffle. Un arbre sur le versant / à l’ombre, épargné, tient tête ‑noyer qui en vit / tant dans l’hiver, bras au ciel. (…) »).
Le style, singularité d’une langue particulière dont la parole poétique résonne, marque de son empreinte le livre, tout au long. Transcendant les signes particuliers remarquables (mots d’un même champ lexical, comme celui récurrent d’un monde agricole ou rural : « bétaillères », « bardages », « bosquets », « champs », « compost », « marcottes », « frontières rupestres », « champs d’épandage », « paturons », « bestiau », « fourrage », « potager », « emblavures », … ; vocabulaire spécialisé emprunté à différents domaines, mots populaires, locutions adverbiales familières, … : « supination », « pognes », « loufiat », « fornique », « à toute blinde », …) ; au-delà de figures littéraires ; déterminant le langage propre à un auteur dont on reconnaît là l’expression. Nous ne parlerions pas ici d’utilisation de comparaisons, ni de personnifications stricto sensu ou d’allégories d’une nature qui serait symbolique d’un état des hommes dispersé, ‑du moins l’auteur de ces lignes et la lectrice de la poésie de Pascal Commère depuis quelques parutions ne le perçoit pas ainsi. Parce que la nature y est serrée au plus près de ses fibres et de sa sève basse ou montante. Les lignes d’écriture et des emblavures s’y croisent, sans que l’intervention de l’auteur jamais soit celle d’un regard spectateur. Le poète parle ici, maintenant, avec ses mots, d’outils et d’une terre de labeur dont il connait la texture, l’allure, l’épaisseur, les carcasses, la boue, l’odeur. Il ne saurait être question de faire de la littérature avec ce qui laisse son empreinte par sa simple et rude existence et imprègne vigoureusement/rigoureusement la mémoire dans la durée de ses traces. Ce style induit un lecteur exigeant, ce qui en même temps valorise la poésie qu’il encourt.
Du côté de la thématique de ce Territoire du Coyote se déclinent la vie quotidienne laborieuse, rurale, dans cette saison « qui serre » ; les ondes intrusives d’une actualité dans un monde qui vacille (« (…) aux infos / restrictions de budget, s’attendre à …, spasmes / d’une Europe en crise, (…) » ; la présence souveraine d’une nature marquant le rythme des hommes la traversant, l’exploitant ou l’affrontant. Hommes tels des « attelages / déhanchés de remorques brinqueballant », quelquefois “à la manque”. Et cette présence (marquante et toujours pressentie dans l’œuvre de Pascal Commère), partout, des bêtes sur cette « terre, atterrée, peu causante », et qui demeurent et qui restent, …
… qui sont partout les bêtes
jusqu’au profond des mots, replis de nos mémoires,
errant au bas du jour, et quand l’automne
siffle le rappel de la saison froidie, on en parle
on y vient, sans savoir ce qui d’elles
ou de nous restera du toujours vieux langage,
ô hoquet fatidique !
- Vincent Motard-Avargues, Je de l’Ego « Narration entaillée » - 19 octobre 2020
- Vincent Motard-Avargues, Je de l’Ego « Narration entaillée » - 19 octobre 2020
- Jacques CAUDA, Fête la mort ! - 6 septembre 2020
- Carole Carcillo Mesrobian, Ontogenèse des bris - 6 mars 2020
- Matthieu Gosztola, Tu es et je voudrais être arbre aussi - 20 janvier 2020
- Patricia CASTEX MENIER & Werner LAMBERSY, Al-Andalus - 6 novembre 2019
- Claire Massart, L’aveu des nuits, suivi par Le calendrier oublié - 15 octobre 2019
- Matthias VincenotJ’ai vingt ans - 25 septembre 2019
- Lettre poème en hommage à Michel Baglin - 6 septembre 2019
- Olivier LARIZZA , L’exil, Jean-Paul KLÉE, Kathédralí - 3 mars 2019
- Catherine Gil Alcala,La Somnambule dans une traînée de soufre - 5 mai 2018
- Michel COSEM, La folle avoine et la falaise - 6 avril 2018
- Pascal Commère, Territoire du Coyote - 1 mars 2018
- Richard Millet, Déchristianisation de la littérature - 1 mars 2018
- Christophe DEKERPEL, De corps, encore - 20 mars 2017
- Jacques Ancet, Debout, assis, couché - 17 février 2015
- Jacques Darras, Je sors enfin du bois de la Gruerie - 18 janvier 2015
- A propos de Pierre Dhainaut - 20 octobre 2014