Patricia CASTEX MENIER & Werner LAMBERSY, Al-Andalus
Le "Journal d’automne" de Patricia Castex Menier nous offre un véritable voyage, nous ouvre « une perspective d’estuaire » que le lecteur découvre au fil des pages, traversé par l’onde poétique, « l’or mouvant des reflets, bien plus léger que celui des autels en majesté ».
Toute une synesthésie palpite dans la saveur des mots goûtés au pays de la lumière : les heures et des verres tintent dans une « rumeur aux terrasses », « le paon de l’Alcazar » nous la joue modeste pour laisser sa roue se faire le motif total du pays (« C’est le pays entier qui fait la roue : il n’est pas donné à n’importe qui de se nommer lumière »), « quelques coplas » pincent la corde de nos cœurs aussi vibrants qu’une guitare, un « moucharabié » nous rappelle à claire-voie quelques-uns de ses « contes du désespoir », … le récit d’une humanité ondoyante et chaleureusement vivante dans les rues andalouses déroule ici le road-movie de sa vie fervente et éclatante.
Depuis le bord du fleuve les rives remuent la vie, mouvante derrière ses murailles, « les vagues cogn(ant) la coque de la ville-bateau » bâtie par l’Histoire (« l’Atlantique, ce dernier envahisseur » ; « (…) la place au soleil (…). Au centre, si l’on se le rappelle, le noyau de la nuit de l’Inquisition, là où on brûlait les corps, les âmes, et la libre pensée »).
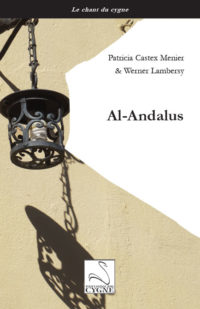
Patricia Castex-Menier & Werner Lambresy, Al-Andalus, éd. du Cygne, 2019, 44 p., 10 €.
La vie lestée par le nuancier des saveurs qui infiltrent invisiblement mais sensuellement son âme voyageuse (« Churros et orangeade », « une journée au goût de citronnade », …) ; la vie habitée par « le muezzin », « l’azulejos du ciel », « l’infini, à la fois le semblable et le changeant ». La poète Patricia Castex Menier fait sa place au soleil comme au mystère tout en clair-obscur de la force et de la beauté du poème (« L’infini (…). Colonnes et arcades, le poème qui viendrait, qu’on souhaiterait pour survivre à l’émotion, n’ose même pas y toucher »). Elle tire à fleur d’interlignes - des profondeurs de la mémoire du pays andalou jusqu’à la surface miroitante du poème - ce que l’humanité conserve en ses entrailles, en ses croyances, en ses certitudes, doutes et espoirs : « Ici comme ailleurs, du fracas, des batailles. On l’oublie trop aisément, bercé par l’élégance des formes. Un répit, c’est si facile la lumière, avant que la mémoire l’engloutisse, rapide, tel le soleil du couchant, ce plongeur de fond ». Davantage, elle tire par les haleurs du poème (« chevaux nez au vent, puis montures mâchant le mors ») l’onde oubliée recouverte par les vagues coruscantes ou frénétiques des précipités du fleuve quotidien qui nous traverse et qui cependant continue de porter des alluvions invisibles mais significatives du passé bâtisseur/éclaireur de nos chemins présents. N’est-ce pas le rôle du poète, de faire resurgir à la surface du réel ce que nous oublions vite faute d’y consacrer du temps, de la réflexion, de laisser Orphée se retourner vers le pays des ombres et du songe pour mieux regarder par la suite devant lui un avenir plus ensoleillé, à hauteur d’hommes / d’humanité ?
Dans une bibliothèque on peut classer aussi les livres selon
leur même dimension, leur même hauteur. Comme ici,
naguère, quand se côtoyaient la Torah, le Coran et l’Évangile.
De ce "Journal d’automne" perpétuel nous pourrions écrire ce que la poète Patricia Castex Menier écrit à propos de l’une de ses journées, perçue entre ses interstices, saisie dans ses instants d’éternité :
Une journée au goût de citronnade, une nuit aussi
ténue qu’un noyau d’olive, un éveil dans la senteur des
choses qui demeurent à nos côtés comme si le jasmin
était une fleur d’automne
Dans ses "Mémoires épisodiques", le poète Werner Lambersy avance dans le labyrinthe exotique de l’ailleurs andalou, se voulant « le passant tranquille » d’un monde (trop) bruyant, piéton émerveillé de la « troisième rive » (cf. l’exergue inaugural de ce livre récit-voyage réalisé en octobre 2018 en terre de Séville, Cordoue, Jerez de la Frontera, Cadix : « Là où le livre invente la troisième rive » Jacqueline Saint-Jean). L’émotion ne baisse pas la garde, phare intarissable de la vigie du poète voué à l’édifiant étonnement, sans cesse reconduit : « (…) j’ai tremblé d’émotion / À cause / Des hommes devant la calligraphie / D’Inoue / Et les colonnades de la mosquée de / Cordoue ». Le poète écrit bien « à cause de », non « grâce à ». Autre temps, autre(s) émotion(s) -l’actualité tragique tamisera toujours le filtre du regard clairvoyant (voire visionnaire) du Poète-Voyant. Face aux tumultes actuels du monde ravagé par la violence et ses ramifications de termites, le poète s’interroge sur la possibilité même d’un passage « tranquille » dans la traversée du labyrinthe existentiel, nuance son émerveillement premier.
Comment savoir avec ces palmiers
Dans le
Jardins à quelle saison et même en
En quelle année
Ou siècle on est le passant tranquille
Être « en » et « à » (comme « à quel saint se vouer ») ne signale pas même posture qu’être « dans » (une année / une saison) : le choix des prépositions est pesé par le poète, renvoyant à une instabilité / une insécurité d’être aujourd’hui, ici, dans la quiétude relative du Métier de vivre (Cesare Pavese). Aux figures et motifs architecturaux andalous correspondent « l’architexte » d’un jeu de l’ombre et de la lumière tel qu’il s’exécute sournoisement en ce 21e siècle où les obscurantismes envahissent peu à peu de nouveau notre Histoire. La tranquillité est peut-être dans l’intervalle de ce « pas espagnol suspendu / Des chevaux », dans l’entre-deux trouble parfois poreux du combat et du divertissement où l’homme-cheval-destrier parfois abandonné à la haine se double de son avatar paradant sous les œillères / le masque d’imposture ou d’insouciance de la complaisance. Car il en est ainsi de l’œuvre viscéralement / foncièrement poétique de Werner Lambersy : sa portée résonne immanquablement, de la mire des contingences visées avec leur immédiateté attractive jusqu’au mille de la cible métaphysique.
Dans le « remue-ménage » de la ville, que ce soit « (…) le long du large/Guadalquivir » ou « la surexcitation de Séville », le poète s’exécute à « bouger » :
On m’interpelle à chaque coin
De rue pour
Des tickets des billets d’entrée<
Des plans
Ou des prospectus en couleursJamais
Une chaise libre très longtemps
(…)
Je n’avais pas
D’excuses la vie passe trop vite !
Et je traîne…,
écrit le poète après s’être comme apostrophé lui-même précédemment : « Je n’avais pas / D’excuses j’étais venu pour / Bouger ! ». Les enjambements figurent la cadence soutenue des villes andalouses ici traversées, si remuantes que le poète se demande
C’était comment
Avant
La foule des visiteurs
C’était comment
Avant
L’ouverture des portes
(…) »,
avant l’afflux du tourisme de masse (« L’univers plie et replie/Le papier glacé/De l’agence de voyage »), avant l’advenue d’une ère frénétique infiltrée par « la vie numérique »… L’amour laisse entendre son air romantique
C’était comment
Quand
On entendait encore le
Jet d’eau
Des fontaines s’épuiser
Par amour
(…)
Quand on n’était que
Que nous deux
Dans les secrets
De l’azur et les noces
De l’ombre »
La voix poétique si singulière de Werner Lambersy, touchant l’âme des êtres et des choses universelle, s’entend tout au long de ce voyage auquel le poète nous invite par « mémoires périodiques » comme les intermittences d’un phare retentissent en nos traversées trébuchantes ou clinquantes, le temps d’écouter bruire le murmure du monde où « verser de la lumière / Aux azulejos » de nos cœurs s’épand dans le cours des jours et des instants recueillis plus clairement qu’aux frontières circonscrites des agitations convenues ou des habitudes.
Aucune nostalgie ne point pour arrêter le poète, puisque le passé se projette dans un présent ouvert vers l’avenir tel « le temps andalou » rythmé avec « le talon flamenco ». Le poète opiniâtrement avance, continue de se laisser surprendre / reprendre par le temps des baisers (« qui n’apaisent pas / La faim »), par le temps espéré d’un « continent perdu » à retrouver.

