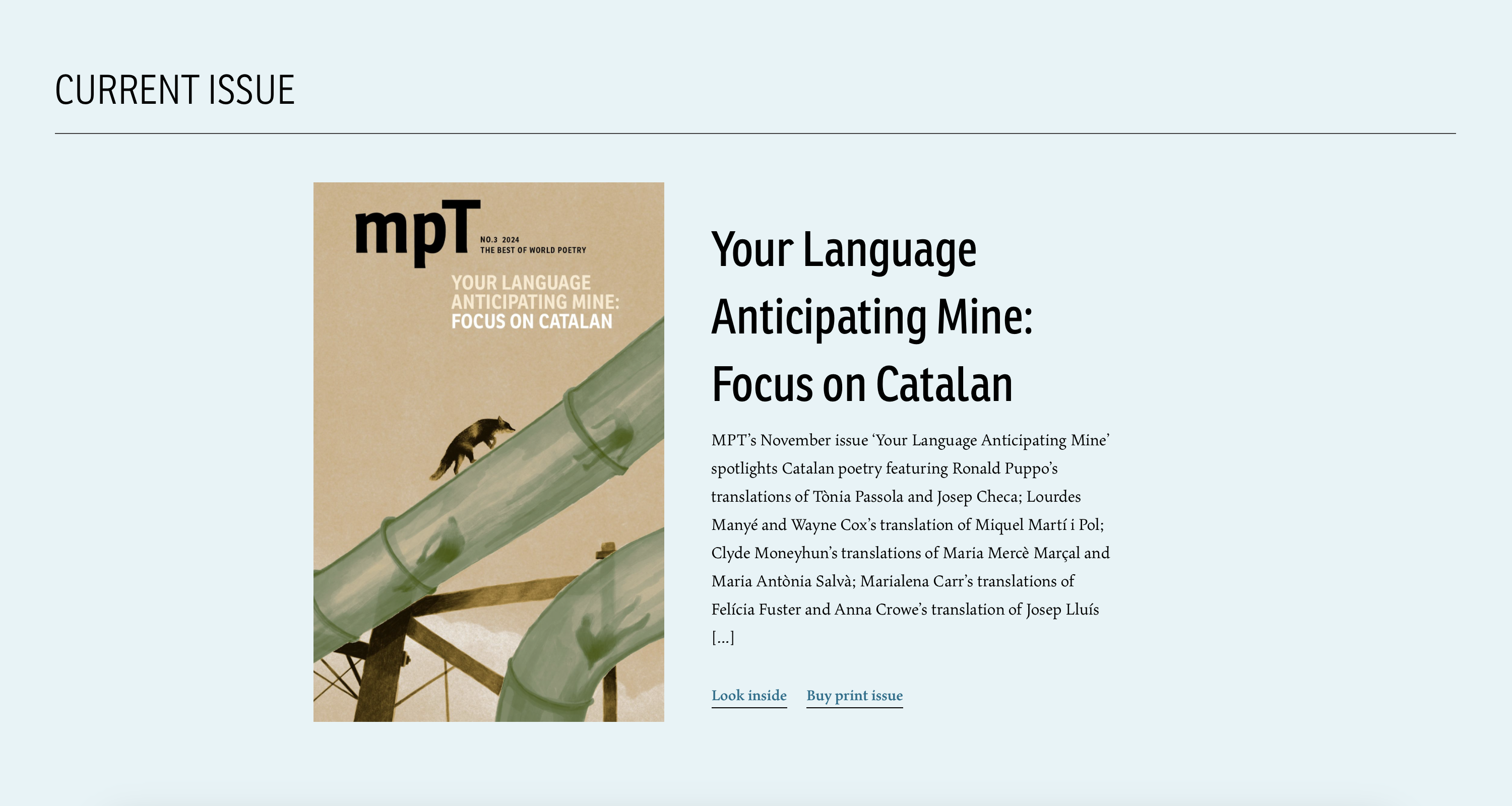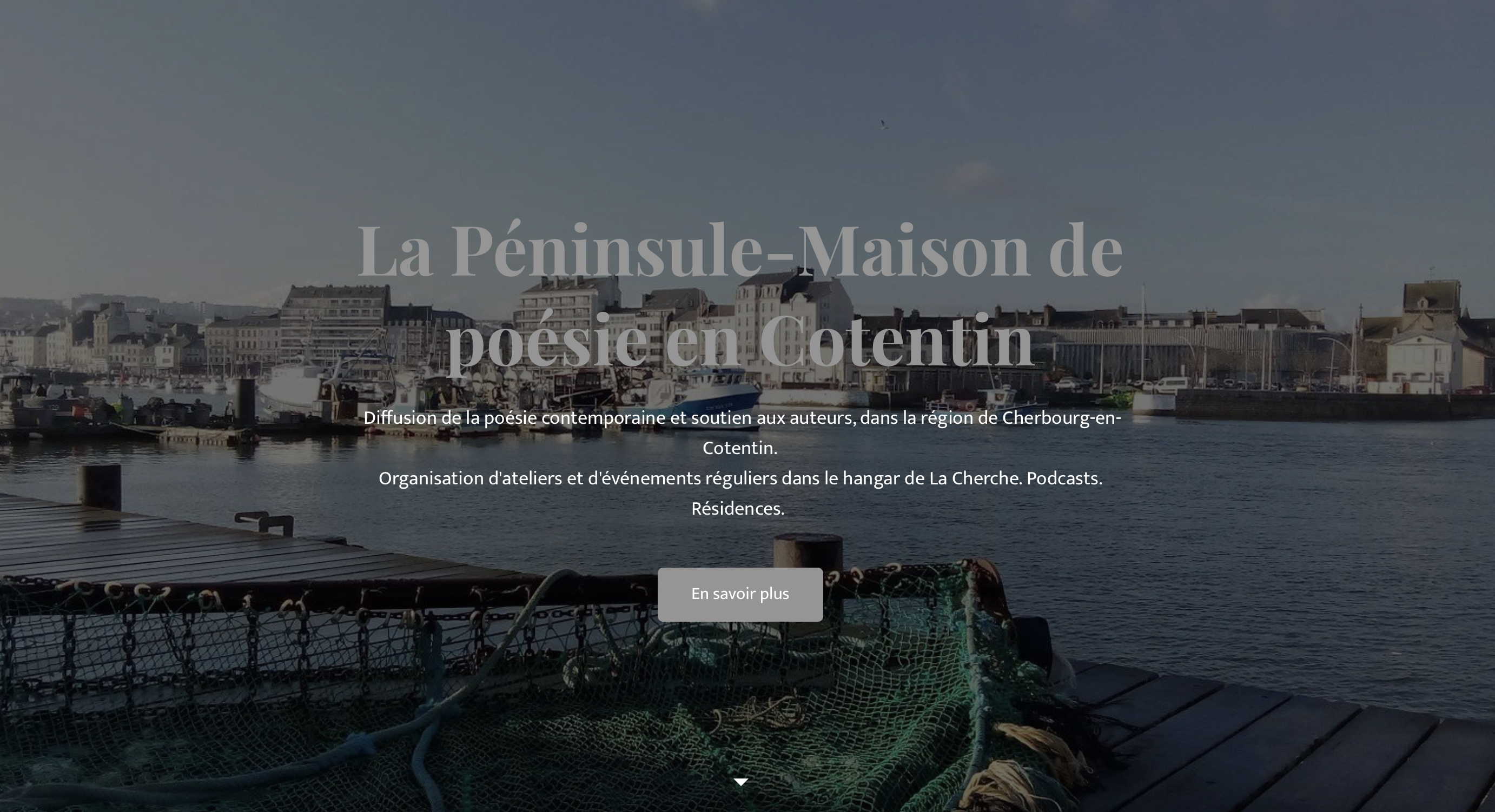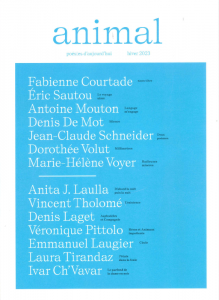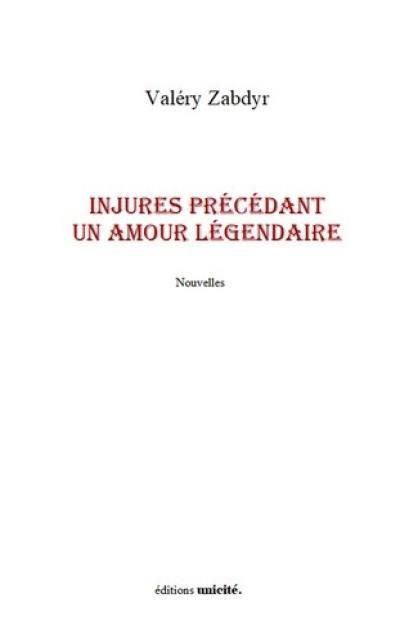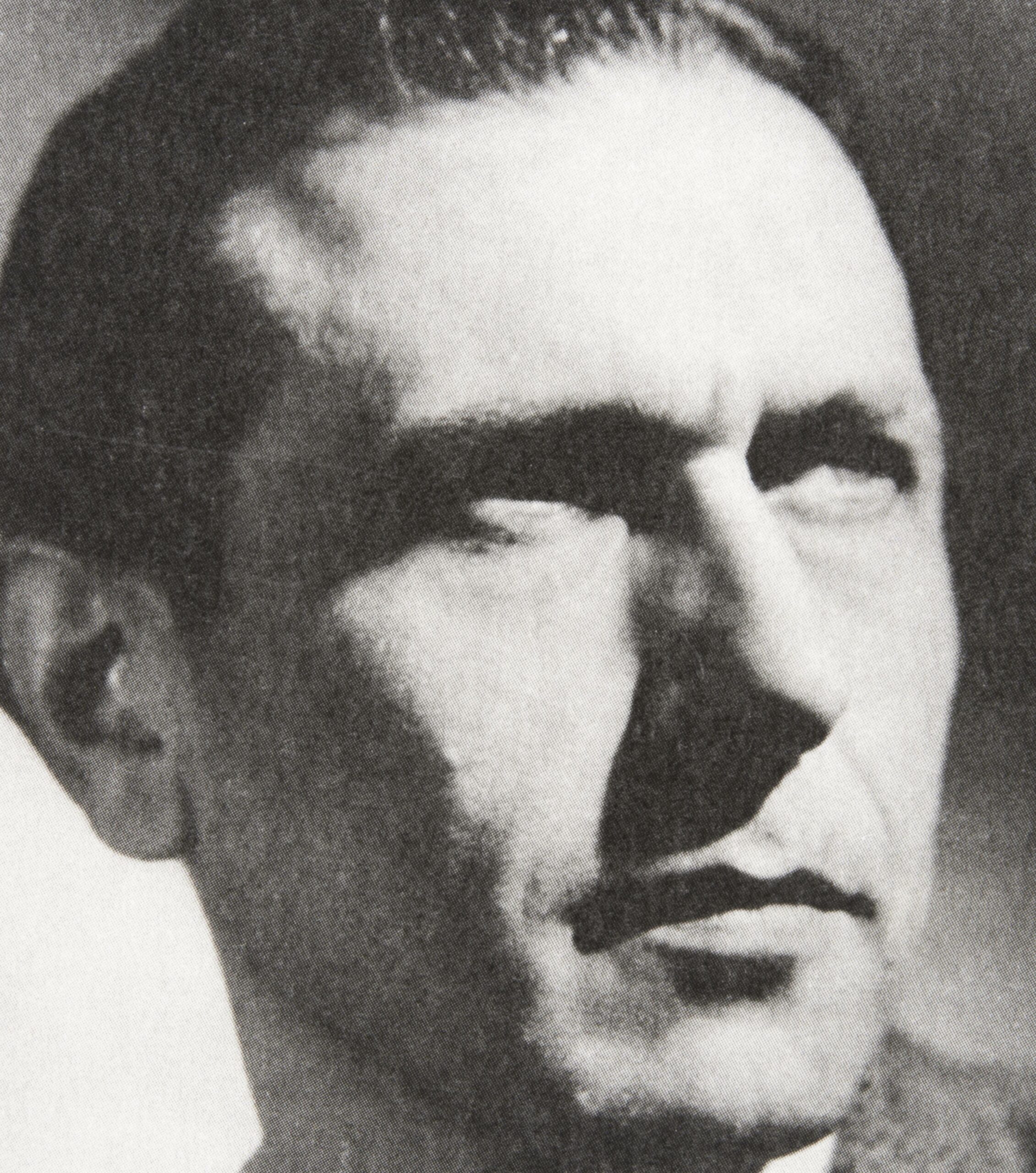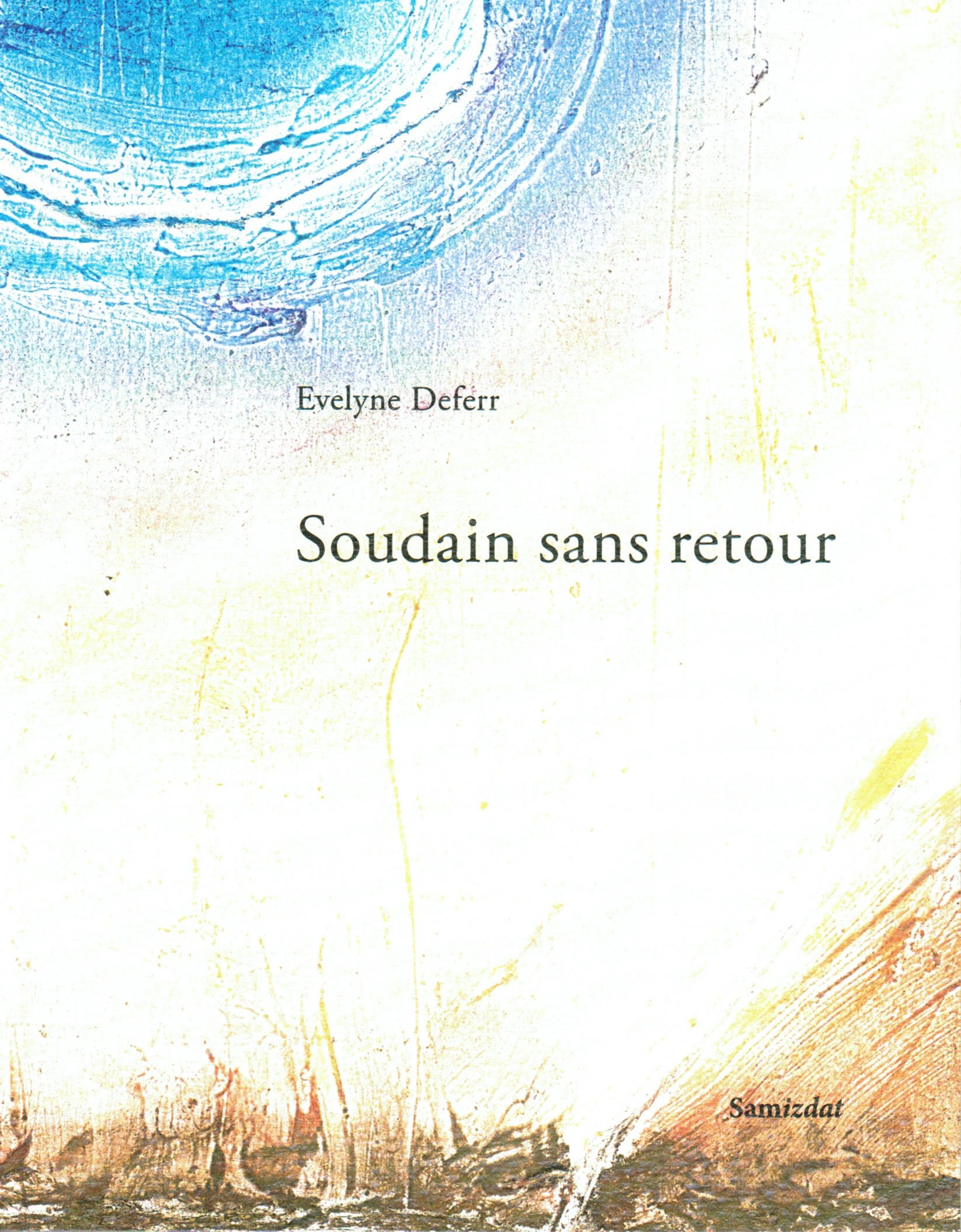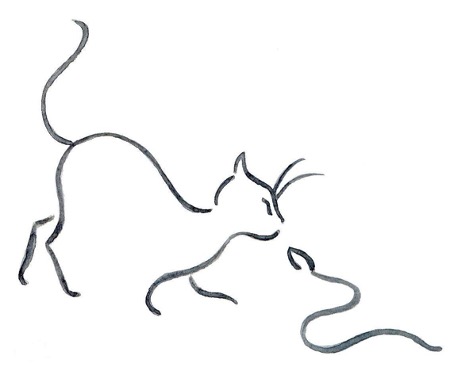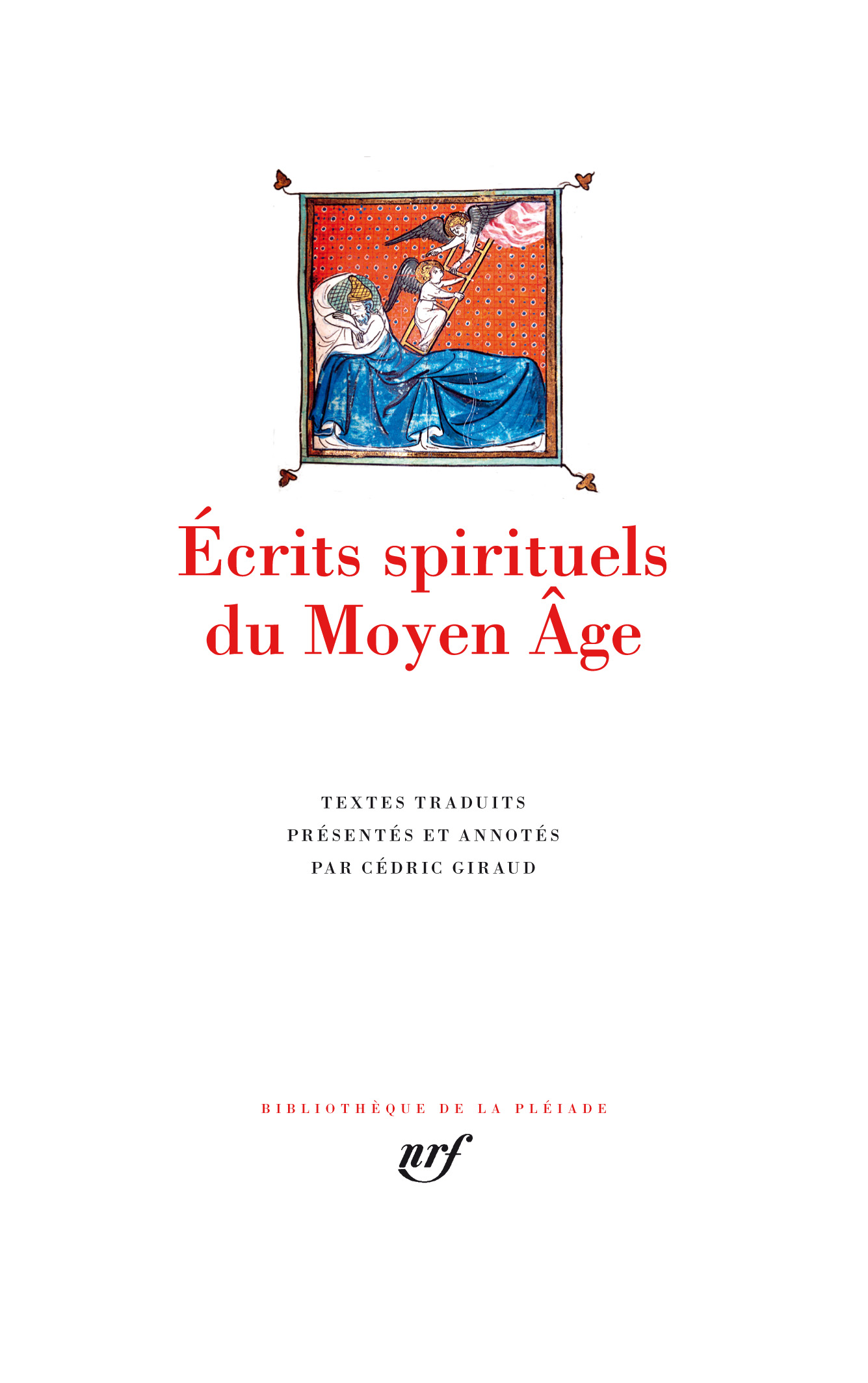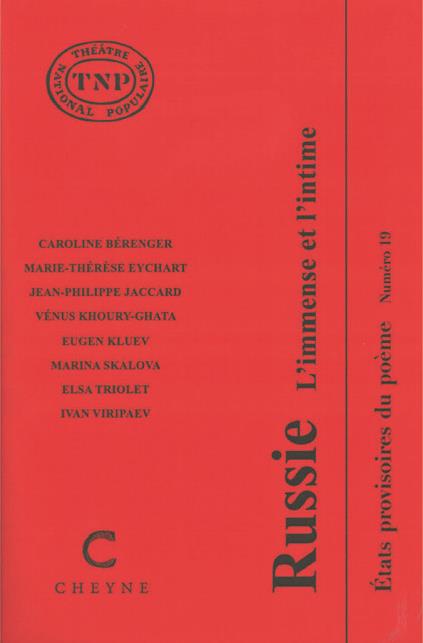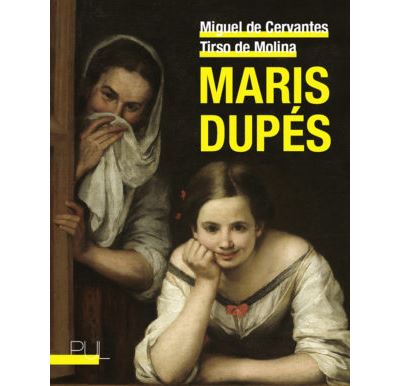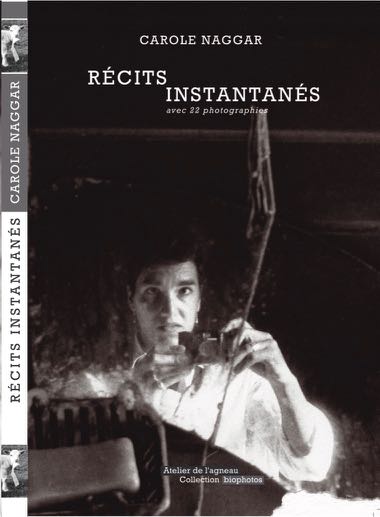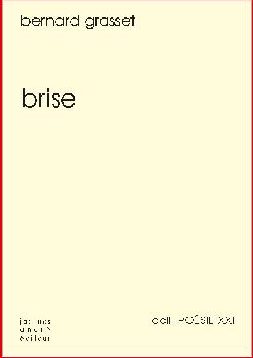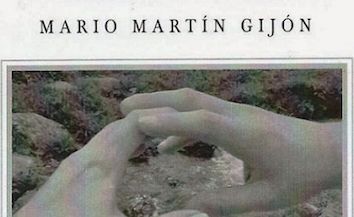La Vie moderne, que vous venez de publier (éd. P.O.L.), se déroule entre deux références, Juvénal et Blaise Cendrars. Quelle est l’importance de ces repères dans votre poésie ? Pour le dire autrement, à quoi ressemble « le beau corps d’aujourd’hui » de Calliope enserré dans un corset pareil ?
— Cendrars, c’est anecdotique. J’ai relu récemment, un peu par hasard, quelques uns de ses poèmes (beaucoup aimés quand j’étais jeune homme) et y ai trouvé la phrase que je mets en exergue p. 141, parce que l’image à la fois douce et sanglante du bébé fraîchement né me semble dire quelque chose de juste de ce qu’est pour nous le corps à la fois désirable et repoussant de « l’actualité » vue par la presse.
Juvénal est un nom, emblématique de la poésie « satirique » dont je me suis aperçu, au fur et à mesure que j’accumulais les poèmes qui allaient constituer le livre, que c’était ce que j’étais en train de faire : sarcasmes et ironie sur les apparences kitsch de l’actuel. Un chant, mais atterré, profane, assis (« licet et considere ») à hauteur de la « res vera » : du réel tel que fixé en légende par les infos quotidiennes.
Pourquoi le journal ? Que dit la presse à la fois d’effrayant et de comique sur notre époque, sans même le savoir ?
— J’essaie de ne pas faire des « recueils » de poésie, mais des livres (composés). Diviser le livre selon des rubriques qui sont celles de la plupart des quotidiens (société, politique, culture, etc) était cohérent par rapport au matériau traité. J’ai surtout travaillé avec des coupures prélevées dans Libération, qui est le journal que je lis chaque jour — même si je lis aussi, plus sporadiquement, Le Monde, L’Equipe, Ouest-France. Ces quotidiens légendent les images (photos) du monde dont ils sont censés nous informer : comme ils sont statutairement soumis à une identification du présent à l’ « actuel », du réel à la « réalité » (la version toujours déjà idéologisée et symbolisée du réel), ils surlignent toujours des traits alternativement sanglants, spectaculaires, scandaleux, kitsch, jargonneux, snob. D’où ce mixte constant de comique et de tragique : monde marrant/monde navrant, comme je le mettais déjà en scène dans le petit recueil de mes chroniques TV (Le Monde est marrant).
On est saisi, en lisant votre recueil, par le paradoxe d’une pseudo-forme rigide (trois quatrains en hendécasyllabes) et la liberté folle, l’étonnante inventivité qui en fait exploser le carcan. Il me semble que cela tient à la fois de la complexité mallarméenne pour les jeux sur la syntaxe, de la richesse érudite d’un Ponge sur le plan des échos lexicaux, graphiques ou phonétiques, mais aussi de ce que l’on pourrait peut-être appeler une certaine gratuité ludique de l’Oulipo. Retrouvez-vous là quelque chose de votre travail sur le langage dans cette jonction singulière ? Comment cette tension/torsion s’établit-elle au moment de l’écriture ?
— La forme n’est pas « pseudo » rigide, elle l’est effectivement. J’ai besoin de cette rigidité tendue, dense, intriquée : c’est elle qui fait « forme », c’est-à-dire qui essaie de ne pas réduire le poème à un ru répandu sur la petite boue des confessions, des expressions sensibles, des déclarations furieuses et des énoncés oratoires (le projet « satirique » s’y prête sans cesse). Mais, à l’intérieur de cette forme impérative, j’essaie de fabriquer du vivant, une vitalité interne à la forme. D’où le jeu prosodiques, les enjambements acrobatiques, les rimes bouffonnes, le côté multipiste de la signification, le tambourinage sonore délibéré, etc. J’aurais voulu que cette vitalité hétéroclite, bariolée et cacophonique constitue, bien plus que ce que les poèmes disent dans le détail de leurs significations, une représentation synthétique et bouffonnement surlignée de ce monde dont les journaux nous disent qu’il est notre actualité.
Vous avez un usage assez particulier de la parenthèse, qui joue souvent le rôle de métadiscours critique. En quoi cette mise à distance, qui peut aussi passer par l’anglicisme et son effet fashion toc, est-elle nécessaire ?
— Anglomanies, fashion toc, angélisme bobo, jargon pub, toutes les versions pseudo-dandy du spectacularisé consommable, oui : c’est une pellicule de veulerie, de coquetterie, d’inculture, de langue fast foodée, d’hédonisme servile, de cynisme ploutocrate qui fait emballage cellophané et membrane prophylactique entre « réel » (la succulence coupable, l’hétérogène à tout, le menaçant vertige du monde de nos plus profondes expériences affectives et sensorielles) et « réalité » (la version édulcorée, homogénéisée, encodée, mercantile et publicitaire qu’en donne la représentation quotidienne). Mettre des effets de « réel » entre parenthèses dans la coagulation de la « réalité », pour y faire trou, distance et situation (de) « critique », oui, ce peut être un projet d’écriture — il me semble même que c’est, osons dire toujours, celui de la « poésie ».
« … on dé / Sespère dans ces virtuosités ma / Thématiques d’illico pas virer gaga ». Pas virer gaga, non plus, de ces virtuosités poétiques ? Doit-on aujourd’hui chercher la poésie quelque part dans cette part congrue du langage, entre indicible et inaudible, soit à revers de toute implication lyrique ?
— Si « on » le « doit », je n’en sais évidemment rien. N’étant pas ce « on » et ne me sentant obligé à rien d’autre que ce à quoi me poussent mon angoisse, ma culture, mes dégoûts, mes étonnements et mes manies stylistiques, je creuse ces manies, c’est tout. Sans rien me refuser de ces « virtuosités » qui ne sont pas des ornements rhétoriques mais des outils pour épaissir la résistance goguenarde que la singularité de l’énonciation « poétique » telle que je la conçois persiste à opposer au nappé du lieu commun : du parler médiatique primaire (idéologisé, homogénéisant, asservissant). Mais il ne s’agit pas, ce faisant, de récuser, ou d’assécher le « lyrisme » : c’est aussi un « je » qui s’exprime dans et par cette épaississement résistant de la langue ; et c’est un « chant » qui s’y réifie, même si ce chant est anti-mélodique, savamment rugueux, grinçant, bouffon, à mille lieues des enchantements du bel canto.
Quelques récurrences thématiques semblent affleurer, le sexe, le corps performant, l’artifice, l’aveuglement du spectacle… La dimension satirique vise-t-elle le faux généralisé qu’est devenu le monde moderne annoncé par Debord ou bien la pauvreté de son langage ? De quelle espèce de résistance, de refus même, la poésie est-elle l’impossible trace ?
— Sexe, corps, spectacle, etc : c’est ce dont la presse traite principalement, c’est son fond d’obsession et de commerce. Et c’est au corps de ces questions, ou de ces thèmes, que le clinquant mode de sa langue cherche à donner une vêture « actuelle » : désirable et interprétable dans les termes de la circulation marchande des produits immédiatement consommables ou proposés comme objets de désirs plus ou moins accessibles (objets de distraction, de culture, de pensée et de savoir y compris). On ne saurait dire que ces vêtures constituent des « faux », des masques, des déguisements. Elles constituent, comme tout effort de réajustement des représentations, un « moment du vrai » — et la pauvreté même de la langue qui crée ces parures et ces masques de pacotille est une condition de l’apparition de cette vérité en tant qu’utile (simplifiée, homogénéisée, lisible, consommable). Ce pourquoi ce n’est pas le « faux » ou le « mensonge », qu’il faut en l’occurrence combattre, mais l’absolutisation du provisoirement et partiellement vrai en norme modélisante exclusive et immuable (la mode, par exemple, dans tous les domaines où elle dicte sa loi, ne tient qu’à ériger sa loi, d’autant plus contingente que fugace, en impératif transcendant face auquel fleurissent, éternellement coupables même si indifférents à la loi, le dépassé ou le « ringard »). Ce combat n’en passe pas par la « dénonciation » (en poésie, en tout cas — même « satirique ») mais par une sorte de grossissement homéopathique des effets, qui essaie de rouler tout ces minuscules absolus (normes morales, consensus culturels, oukases des modes, correction politique, etc) dans une farine de relativités bouffonnes.
On sait l’importance de la musique et de l’oralisation dans votre travail. Faut-il lire à voix haute les poèmes de « La Vie moderne » ? Pensez-vous vous-même les faire entendre un jour ?
— Les poèmes de ce livre (comme ceux, un peu avant, de Météo des plages) sont plutôt faits, délibérément, pour ne pas êtres « lisables » : pour qu’il soit impossible, en tout cas difficile, de les lire à haute voix. Le choix du mètre impair, d’une prosodie complexe (qui ne coïncide que fort peu avec la syntaxe), de mots découpés en tranches syllabiques, d’une partition non mélodique (à la fois atone et cacophonique), d’une multiplication des pistes simultanés de signification — tout cela est destiné à empêcher ou en tout cas à rendre frustrante et finalement sans objet l’oralisation de ces poèmes.
Propos recueillis par Frédéric Aribit