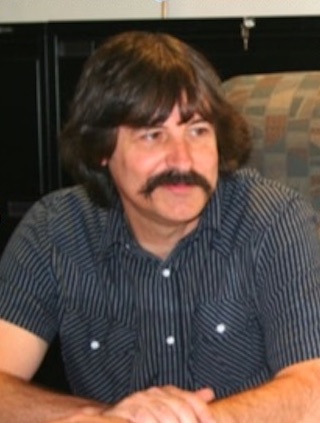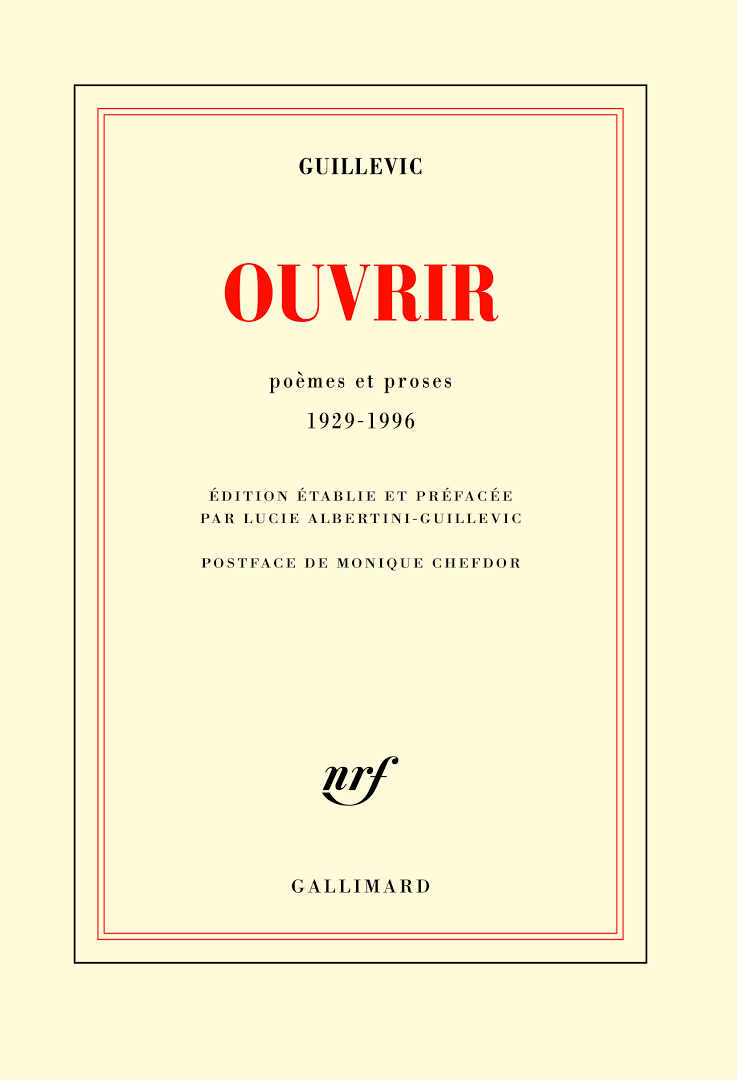Les arbres cachés encore
Mais déjà hors de doute
En tel monde, les arbres seraient des êtres. Ils borderaient notre vie, nous le voulons, qu’une forêt soit si forte qu’elle existe. Plus que bois, liés à nos corps comme au ciel (« intensément bleus »). Cela qu’une vérité invérifiable nous fait pressentir, cela lié à l’encre. Entre le bleu, le noir : le poème, ses quatrains réguliers, rassurants – pour ce livre, mille cent strophes.
La table des matières de l’ouvrage, en fin de volume, pourrait nous incliner à penser que l’on a en main un ouvrage didactique complet, à l’ancienne, sur l’arbre. La présentation tend vers l’exhaustivité : essences, parties de l’arbre, son environnement et sa localisation précise, l’usage qui en est fait, sa place dans la vie et la création humaine. Chaque partie, nommée « livre », porte un titre d’étude latinisant, commençant par « De »…
Ainsi, la première partie s’intitule : Des arbres en général et de l’arbre en particulier.
Au début de chaque quatrain, le groupe nominal « les arbres » grisé, détaché du reste du texte, semble une excroissance vivante et menacée (une essence). L’anaphore ancre l’expression et la met en relief. La redite, le refrain : ils donnent vie. On pense aux « branches », celles du Moyen Age, qui désignaient les chapitres d’un livre, parties d’une histoire ou sections d’un texte aux multiples ramifications. Arbre / être, nous sommes de vivantes racines qui plongent en une terre où la vie prolifère.
Nous entourant, ils deviennent démiurges protecteurs d’une vie exposée sans eux et garantissent l’espace ouvert de la danse ou du vent :
« Les arbres cette ronde
Sous les chênes célèbre
Le culte du vent le vide
S’emplit de vaines chansons. »
Danse initiée par le vocabulaire : la forte concentration du lexique des arbres et de leur environnement (taillis, bosquets, lisières, haies, clairières…) construit une représentation où la feuille signifie et figure. L’attente (« Un taillis est une forêt /Qui attend son heure ») : projection d’émotions et du temps humain. Patience d’arbre où lire la tristesse plane des champs labourés avant le sous-bois qui annonce les arbres petits ou grands. Ils seront nommés (nerprun, cornouiller, fusain, viorne…) : le vocabulaire usuel des variétés communes autant que celles plus rares pour un chant polyphonique, comme celui des oiseaux.
Le temps des dissections est mentionné, comme toute activité humaine qui coupe et casse :
« Un temps singulier où les branches
Furent retirées du tronc
Et le tronc libéré de ses racines. »
Épopée en vers dont l’essence se lit dans l’aubier, comme les arbres, les hommes, « [d]ans le cœur de l’homme mutilé ». Les coups, matérialisés à la coupe du vers par « tant /[d]e ». Arbre, au milieu, placé tel un totem autour duquel trouver inspiration, force de poursuivre. Ses propriétés gagnent le narrateur-poète, par imprégnation : à son invitation, l’élévation.
Le regard à l’assaut des cimes. La seconde partie, De chaque espèce selon sa nature, pour une énumération patiente des variétés d’arbres : chênes, hêtres, frênes, châtaigniers, érables, ormes, aulnes, trembles, saules… et chacun, à sa place, se tient. De sa particularité fait une force :
« Les arbres hirsutes
Trois petits osiers
Montent la garde
Négligemment. »
D’un chant le refrain, ce seraient les noms variés, à la rime, le son [e], fermé, clôture de songe car, fruitiers ou non, toute variété devient socle et symbole (« larmes bleues » du prunier en quête de sa « propre énigme »), témoin d’une histoire personnelle (le figuier : « Enfant j’y recueillais / La promesse du monde. ») ou universelle (l’olivier : « de haute époque il m’ignore. »). L’hommage traverse ces noms : reconnaissance d’une existence, ils titrent chacun des poèmes à la manière d’une encyclopédie(l’index final recense 70 essences différentes).
Le culte panthéiste met au centre du vivant et du sacré la vigueur de l’arbre qui, dans la diversité de ses espèces, nous dit : « Me voici forêt » !
La troisième partie, Des arbres dans le génie des lieux, replace l’arbre dans son environnement géographique précis. Évoquer le « génie d’un lieu », c’est d’abord faire implicitement référence à un être surnaturel qui l’habite : dieu, déesse, nymphe, djinn, korrigan (en Bretagne), fée, lutin… Ce génie, il importe de ne pas le mécontenter(comme les dieux Lares des Romains et les anaon des Bretons pour la maison).On sait que, dans un sens plus moderne et imagé, il s’agit du caractère propre et particulier d’un endroit, ce qui le rend unique. À chaque lieu, son arbre (et le génie qui le caractérise), ou même sa forêt.L’énumération précise dresse l’inventaire d’une forêt composite, plurielle.
Place au rêve, au ralenti,aux souvenirs d’une enfance, d’une vie, « la toile du pays lent ». Il est associé au silence, sa condition, son multiple. Alors les lieux nommés soulèvent une poussière fertile de mots (Orry-la-Ville, Morvan, au sud du mont Beuvray, ici, en France, ou ailleurs, Inde, Japon, New-York) : aux noms propres s’associent les couleurs, celle de la toile d’azur environnante mais aussi ce qui ne se peut nommer. Part d’énigme, temps immémorial suscité autant que son mystère ou son absence.
Place aussi à l’horreur quand arrive sous les arbres de Lampedusa les débris des bateaux et les corps des enfants noyés qui, « partis sans panier », « sans carte ni permis », ne cueilleront jamais les « pommes d’or » de l’exil. Horreur quand la forêt de pins bavaroise semble si paisible autour de Dachau. Horreur devant la forêt disparue de Matushima, où marchait Bashô, forêt emportée par le tsunami…
Et toujours, anaphoriques et loués, « les arbres », l’encre effacée revenant sur le devant du poème, du quatrain, pour rappeler, chanter et taire une force tangible et secrète. Comme si nulle géographie n’échappait à ce pouvoir diffus, ils reviennent et lancent les vers. Toute saison traversant rencontre les arbres et le poète au cœur de ce dispositif de branches : « Les arbres me voici » en écho au titre du livre, scellant une rencontre inscrite et désirée.
Les lieux s’élargissent à l’univers entier, Des arbres dans leur rapport au cosmos, en quatrième partie. À l’impératif, une déclinaison d’actions pour l’arbre devenu démiurge : fermez, nouez, soufflez… Aux poètes, il ouvre son sens dans une cosmogonie signifiante (autour des saisons, de la pluie, du brouillard, des oiseaux…) :
« Et poètes accrochaient
Les saisons de la lune. »
Arbres et livres, en équivalence et en acte, réveillant les « oriflammes » de « rois en fête ». Procession flamboyante ou défilé rituel dans lequel l’arbre en tête indique où se rendre – et pourquoi. Ostensiblement.
Le poème et le livre s’ouvrent en ultime partie, Des arbres comme écriture et comme imaginaire. Se confondent le règne végétal et celui de l’encre, le poème devenu racine de l’être aspire à effleurer l’essence. Chacun dépasse ce qu’il semble être, « ce que j’appelle ainsi » menant à l’énigme, l’un passant par l’autre, dans une affinité singulière et signifiante. Comme si l’être humain, unissant la verticalité du tronc à son socle de terre, avait fait vœu de ciel et d’étoile au terme du poème.
Alors le titre s’est paré de l’écorce de ces mots : « Me voici forêt », que disent tour à tour chaque arbre, chaque poème, le livre et le poète lui-même.