Sanda Voïca : Trajectoire déroutée
La dédicace en forme d’épitaphe (« Pour Clara Pop-Dudouit (1994-2015) »), sous l’austère couverture, semble ériger un classique tombeau poétique - mémoriel monument de mots dont on ne sait si la « déroute » du titre concerne la poète affligée, ou la précoce interruption de la jeune vie qui est pleurée.
Toutefois, dès les premières lignes, ce recueil n'a plus rien de la forme attendue – rien de plaintif ni de lyrique, dans cette noire élégie où tout le corps même de la poète, se dresse « tombe blanche / ovale dans [son] corps » - comme une maternité inversée. Et le « coup de poing dans le plexus » évoqué par l’auteure frappe aussi son lecteur, happé, contraint à se pencher avec elle, sur l’infini puits de douleur d'où elle arrache les mots comme des morceaux d'elle-même. Lire est une grande douleur partagée pour qui, emporté au fil des effrayantes métamorphoses de ce corps écrit, douloureux et survivant, dans un récit dur, précis et sans pathos, découvre que cette lamentation ne sera pas du tout un livre-stèle, l'eulogie d'un chant funèbre, mais la voix, éraillée de douleur, de celle qui tente de se restructurer, par le labeur de poésie, avec son crayon qui laboure la page, contre la douleur qui ronge celle qui écrit «Je suis celle qui s'extrait / de MON jour / de SA nuit».
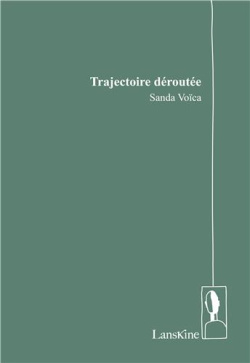
Ce qu'on lit, c'est la relation scrupuleuse d’une saison en enfer, à laquelle on participe tant la description est puissante, une lutte contre la possession vampirique de la vivante par la morte : «la fille revient / s’empare de moi (…) je mets la fille disparue / dans mon échine ». Ce cheminement tracé sur la page vers la libération des deux entités conjuguées dessine une sorte de Livre des mo(r)ts : le livre de la morte/vivante encore dans le corps de la mère – la recherche au fil des mots de la prière qui va l'aider à sortir enfin du monde – comme dans le Bardo Thödol, le Livre des morts tibétain, décrivant le chemin ultra-terrestre parcouru par le mort en route vers sa libération, à travers des épreuves comme autant d'étapes de couleurs, aidé de la parole de ses proches. Le poème est une « navette » (p.47), « outil à passer le fil / dans le métier à tisser », ce linceul des fils de deux vies croisées à dissocier désormais - mais comment, lecteur effrayé, oublier que ce mot désigne aussi la barque, le bac, permettant l'ultime traversée, à travers les poèmes qui l'emportent ?
Des images archaïques vous assaillent dans toute leur brutalité. C'est donc ainsi que l'on pleure – vraiment - dans sa chair, dans ses os. Sans fioriture. Sans joliesse. La douleur est ogresse - comme la morte et son souvenir : « Ogresse, elle / moi aussi ogresse / Qui mangera qui ?»
Enfermée, double et solitaire, dans ce corps « découpé/dépecé », qui ne lui appartient plus, la poète « tâtonne », dénoue les « cordelettes blanches », devient larve, insecte, disparaît, tente l'envol vers plus de blanc, de bleu... toujours attachée à la fille qui n'est pas souvenir, mais chair de sa chair « faisandée vivante », plantée en elle et qu'il faut aider à partir...
Je colle à mes tripes
Je colle à mes mots
Je colle à la mort.
(…)
Ma mort est celle de la jeune fille.
En vol, on ne voit
que l'air sous nos ailes ...
Le texte se lit comme une longue parenthèse hallucinée, dans laquelle se renversent toutes les évidences, où s'inversent aussi les fonctions des choses du réel : les murs attaquent, l'air est solide, le corps devient pierre, et « toutes les dalles / de l'allée et des parterres rectangulaires / ne sont plus celles de mon jardin / mais celles d'une tombe (...) » dans le magnifique paysage inversé des pp 49 et 50.
Lorsque Voïca écrit les vers commençant par « Retable », on pense inévitablement aux peintures baroques, à L'Enterrement du Comte d'Orgaz, à l'horreur sous nos yeux de ce passage qu'il faut affronter, chacun seul, inventant ses propres solutions pour survivre, afin de ne plus porter enfin qu'un souvenir poreux... Et la poète qui tente de réinvestir ses mots évidés/son corps/sa vie, en creusant une tombe avec ses poèmes, nous entraîne aussi dans une sorte de transe chamanique, où devenue « géante aux godillots », elle observe « le monde, en bas », le vide aussi, comme le visage absent de la fille, devenus « gués vers un univers plus blanc / malgré le pullulement de toutes les couleurs ».
Puis la douleur se résorbe avec le souvenir – et Sanda Voïca puise au plus profond des mythes universels pour nous narrer l'involution de la mort, les échanges entre existants et revenants évoqués à propos des toiles de Chagall, le tissu désormais plus lâche, comme une nasse, qui va la libérer assez pour déclarer, comme ressuscitée parmi les mots : « Me voilà » …