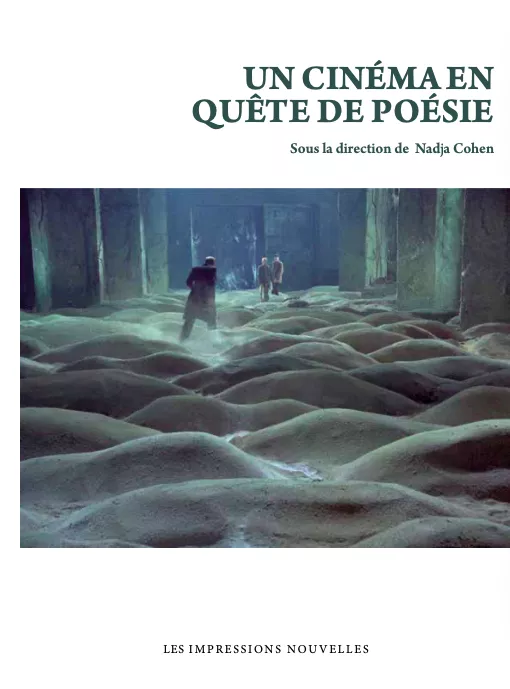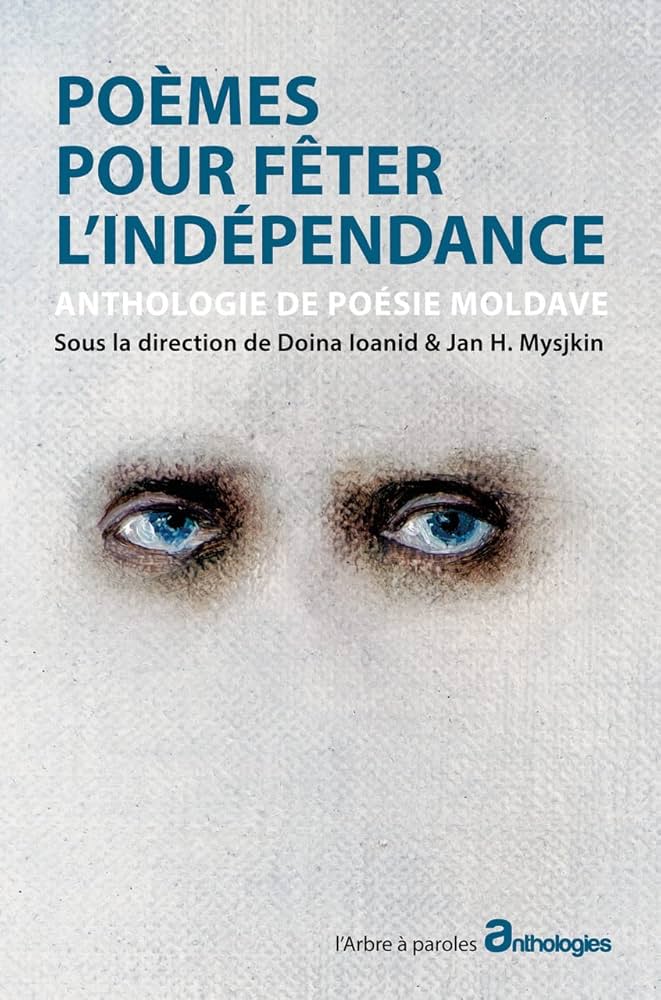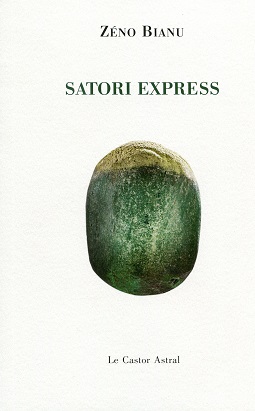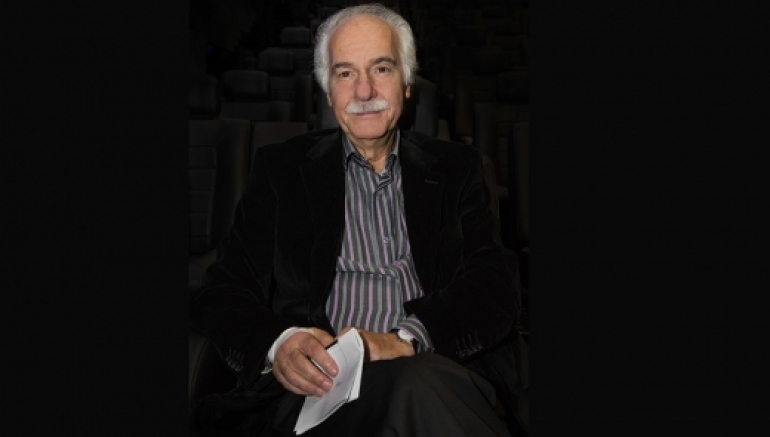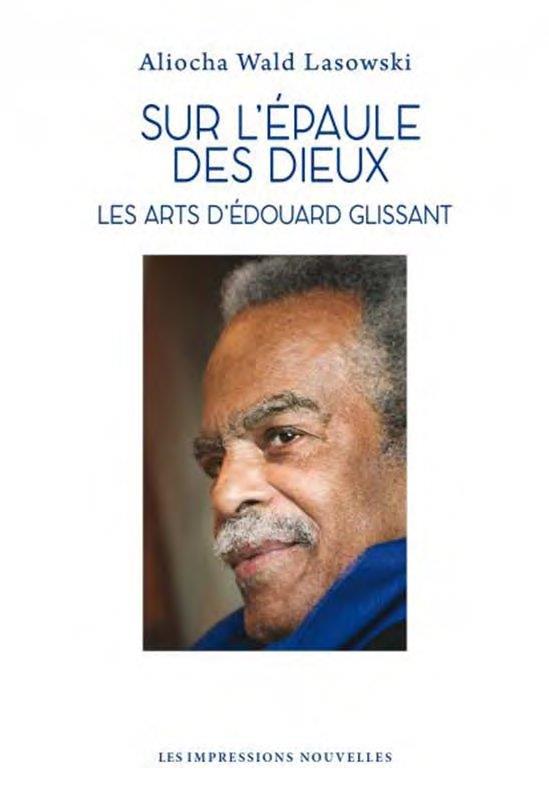Nomade pour l’éternité …
Une émotion puissante plane sur l’œuvre de Cabral tant la rage de vivre face à tout ce qui indigne le poète grave le recueil d’une force tellurique ; recueil au cœur duquel résident aussi une présence insaisissable, une impuissance face à l’espoir et une fissure souvent proche de la rupture.
En effet, découvrir la nature tragique, absurde, dérisoire de l’humain, c’est affronter son ombre portée, c’est l’éclairer pour tenter de s’en arracher. Mais un cri de haine, un geste violent sont aussi difficiles à imiter qu’une aurore au ciel, que l’océan apaisé, aucun mot n’aura donc le pli de l’évidence. L’intention de l’auteur est de parvenir à s’emparer de la face obscure du monde, de pointer du verbe les injustices multiples et les tragédies quotidiennes. Cabral parcourt ainsi la terre par la tempête qui la traverse, par le bouillonnement des eaux démontées, par les falaises et les rochers déchiquetés :
« Je suis plein de nuits blanches ;
Des rafales d’étoiles mortes
M’ont couché sur le sable ;
Des bêtes aux yeux d’amantes
Roulent parmi les vagues ;
C’est encore la guerre… » (P22)
Le poète aurait certes pu simuler ce désastre grâce à une parole entièrement maitrisée, mais il préfère l’assombrissement pour marquer un ciel en colère. La présence sonore extrêmement forte des guerres passées et présentes résonne en des phrases de révoltes clouées aux pages comme des rouleaux prêts à éclater contre les récifs. Tout poème, qu’il soit d’alexandrins ou de maximes, est une plongée sur la terre où s’échouent les vagues intempestives du monde. Arrachée à l’adversité, au milieu de cette tempête ontologique, glisse une écume blanche de mots à peine visible qui nait de l’union d’une esthétique précise et d’un aléa du sensible. En approfondissant la métaphore filée de la mer omniprésente, l’écume apparait peu à peu comme l’homme perdu au large et bousculé par des rouleaux gigantesques, coupable ou non, peu importe, sa rencontre avec le réel suscite un sentiment de vérité et renforce la certitude d’une humanité insensée où règne l’odeur âcre du sang : « Ici l’eau ne fait plus /que du ciment /on ne peut plus la boire /mais quel mur pourrait /retenir le sang ? » (« MUR », p 69)
L’œuvre de Cabral est placée de la sorte sous le signe d’une passion ardente. Parcourue de tensions, elle intervient au cœur de mutations diverses, dans l’interstice ou plus précisément la faille entre monde ancien et société industrielle, matérialisme et sacré, persistance du mythe et conscience révolutionnaire. Le poète transforme sa nostalgie en arme critique. Il ne se désempare pas de l’intime, il le renforce en engageant un vécu. Sa poésie invoque le réel, disant la blessure, la fragilité de tous, le lieu commun d’une nostalgie sans doute fraternelle. Chacun de ses poèmes permet d’aller plus en avant, jusqu’au bout du voyage, dans le souffle de la partance, jusqu’à la vaste solitude des mers, recueillant ainsi de lointaines âmes perdues. Et si son œuvre prend toutes les formes de l’insaisissable et de l’insurrection, c’est pour s’acharner contre l’impossibilité de changer le réel, sur quoi nous continuons à buter. La parole dit en conséquence l’informe, l’incorporel et son mouvement, la violente nature et la menace qu’elle fait naître. Le poète ne s’arrête pas aux images d’un monde défait, il en montre la progression, la tourmente et explose en une nature cambrée de douleurs ; nul « matin sans cicatrices » quand l’océan et le ciel s’obscurcissent de rouge sang !
En somme, le cœur de l’innommable est suggéré par un sentiment d’enfermement, d’étouffement et de disparition. Le poète dessine des reliefs insoumis pour créer des plongées aux quatre coins d’un univers englouti. Ses visions font naitre des peintures d’où ressortent principalement la grisaille, la substance et les remous. Son œil a besoin d’une loupe à grossir le bruit du temps pour découvrir que le hurlement confus du monde se décompose, dans une réalité plus saisissante, en une foule de souffrances très différentes, jamais entendues : une apocalypse de cris. Le poème devient alors cette voix où quelque chose chante inlassablement l’absence blessée, une voix qui se fige, se cristallise et se brise. Les soufflements incessants de ses mots nous plongent au cœur même de la vérité. Il ne s’agit plus d’écouter mais de ressentir.
Ainsi le grand large envahit le texte et se confond avec la couleur du ciel (dont la ligne d’horizon est également floue); la masse grisâtre domine les rares vues dégagées et renforce l’effet d’enfermement. Mais ces claustrations successives tendent à circonscrire un domaine autant qu’elles constituent un itinéraire. Chacun de ces chemins, ou poèmes, fait ainsi l’épreuve d’une interrogation mêlée au souffle violent du monde jusqu’à en être recouverte. L’œuvre débute sur le vent et ses incidences, la parole exerce un va-et-vient irrégulier sur la végétation bretonne et la ligne d’horizon des guerres lointaines. Ces images représentent aussi bien la face errante du souffle invisible que le point de vue d’un objet, des branches chahutées par le vent, les poèmes restituent par là-même une solitude concentrée, un désastre où nul repos n’est permis pour qui saigne, crie ou écrit : «Toujours plus d’hommes/ Pour enterrer les hommes !/ La terre n’en peut plus ! » (P16)
La parole de Cabral s’apparente toujours et encore à une lutte entreprise contre la violence immaîtrisable du réel. Dire le voir devient donc dire l’invisible le plus terrifiant. Cette poésie traduit la force mystérieuse qui pousse à l’acte créateur de l’homme révolté : saisir l’insaisissable du Mal. Mais le poète le sait, l’individu, en présence d’un milieu perdu et gigantesque, est face à une réalité qui le dépasse. Si le rouge cendré sert de toile de fond aux mots du poète, si l’espace n’existe plus, les humains n’ont donc plus aucune voie de respiration, comprimés de force entre deux figurations du ciel et de la terre, la claustration se renforce jusqu’à l’évaporation de l’être, et c’est la nuit qui se referme sur les visages…Le poète approche ainsi une partie du mystère des ombres filantes en ne faisant qu’un avec elles ; sans quitter les horreurs du monde, sans dépasser la hauteur des branches, il devient une minuscule silhouette dont la voix prend en ampleur. Seule la façon dont ses mains crient indique qui il est. Et si Cabral paraît être là de façon accidentelle, au milieu de ce monde incohérent, si les couleurs assombrissent son regard, sa parole sait éclairer avec fougue la nature de la Vie et de la Mort : soit le jour est simplement tombé, soit l’obscurcissement justifie l’approche du chaos évoqué.
Si vaste d’être seul est donc un recueil de poèmes à vif qui résonnent en plusieurs sens. Le lyrisme y est sans concession, s’engouffrant dans le bleu insolent de la mer ou s’écrasant à même le rouge sang de la terre. Voilà pourquoi l’apparent identique et le juste leitmotiv dominent la structure du recueil, ces représentations sont calquées sur l’agitation toujours recommencée du monde fait à l’image des hommes. Les vagues ne naissent-elles pas, ne grandissent-elles pas, n’éclatent-elles pour mourir et se recréer de nouveau ? De ce fait, l’Ailleurs reste interdit, nul lieu d’exil, nul repos, à peine quelques rives chargées de mémoires dont nous ne percevons plus que de fugaces ombres. Le ciel, à l’instar des oiseaux de Cabral, demeure définitivement muet et tombe sur le monde. Tout ce qui forge un tant soit peu l’humanité est terre de silence. Dans cet univers de perdition, le temps n’en finit pas de mourir, la vie s’immobilise et, pourtant, le lyrisme sauvage et abrupt de Cabral fait trembler un incessant et presque imperceptible désir :
« J’écris les yeux fermés ;
J’écris mon livre à genoux,
Aux yeux de l’amour et de la mort
Je n’ai pas mon pareil
J’écris avec sur le cœur
Une petite main de sang
Les mots qui sauvent les mots qui perdent
Je les trouve au buisson ardent… » (« Mon livre », P23)
En effet, par un singulier amour, Cabral nous arrime à sa tribu. Le poète est celui auprès duquel peuvent s’agréger tous ceux qui sont agités par le cauchemar de l’espérance. Le paradoxe de cette situation est décrit comme la confrontation du sujet à ce qui le dépasse et lui échappe, ce devant quoi l’homme ne peut que mesurer sa fragilité, mais aussi ce à quoi il peut se raccrocher, un entretemps poétique où s’expriment sa faculté de résistance et la luminescence de sa force intérieure. Les jours s’en vont, nous « demeurons »…..
- Au bas des ombres, une lueur veille… Sur la poésie de Didier Manyach - 29 décembre 2015
- Si vaste d’être seul, Tristan Cabral - 19 octobre 2014