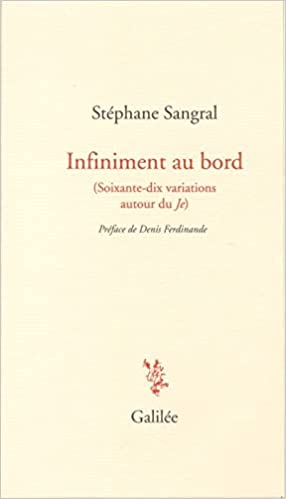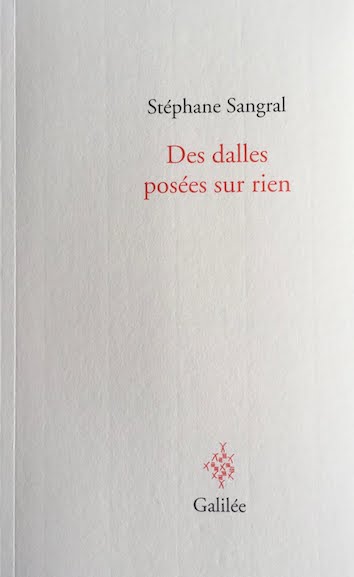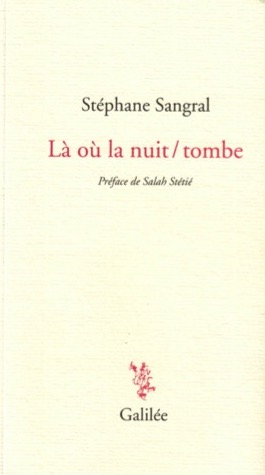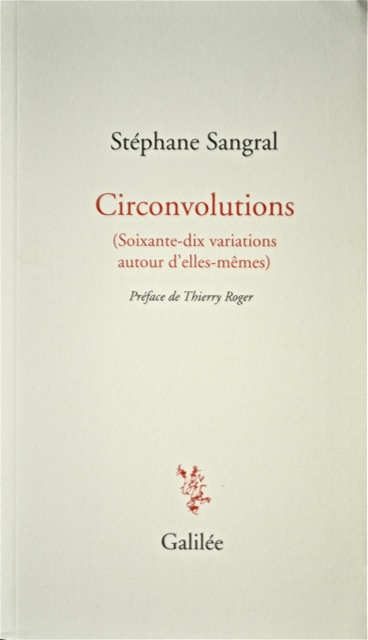Des dalles posées sur rien : autre visage de la poésie : se regarder en face sans concession.
Qui suis-je ? Qui est je ?
Stéphane Sangral nous montre que la raison, malgré les expériences et les connaissances avancées, ne peut apporter de réponse aux questions fondamentales de la vie. Le lecteur s’enferre dans des explications rationnelles qui n’atteignent pas la raison. Le questionnement tourne en rond et finit par afficher complet, assez…merci. Au bout de ma définition …

Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien, Editions Galilée Prix 17 euros.
Trop peu ouverts, prisonniers de nous, nous sommes comme Michaux « un passager clandestin ». Abandonner les questions sans réponse nous propulse en avant, témoins éberlués, nous lâchons les causes trop incertaines et même parfois sans cause. La connaissance, dans son inutilité, peut être un obstacle pour nous à occulter nos vies. Nous trébuchons quand la réponse qui est en nous ne se voit que hors de nous. Pouvoir vivre est oublier que l’on vit. Toute la science accumulée est une informationnulle pour la réponse à la question. L’information nous tient lieu d’un savoir à découvrir, jamais découvert, il est impossible de se l’approprier.
L’auteur approche la vérité du corps et de l’esprit, leur dichotomie, l’enfermement de la matière pour laquelle la science nous révèle que tout est chimie, nous rendant par là moins responsables ou plus du tout responsables. Comment aller de la désespérance vers l’acceptation, est-ce possible ? Sortir de soi. Est-il possible qu’on ne soit que tas de molécules ? Comment avec aussi peu de moyens se reconditionner face à une connaissance en expansion ? Serait-ce un problème de langage, les mots faisant obstacle à l’approche de la chose, bien que nous n’ayons que des mots pour nous en approcher ? Cette difficulté à comprendre qui je suis, est-elle fondamentale, n’est-ce pas un tourment de l’esprit, une fiction ? Est-ce une méthode pour apprivoiser la mort et la repousser ? Ce que je suis, pourra-t-il être volé par ma mort ?
Plus la conscience se pénètre et plus nous abordons une infinichotomie ne contenant rien et contenue dans rien, comme si nous n’atteignons jamais la profondeur. Un questionnement qui tourne en rond, un approfondissement qui ne dit pas son nom. Les mots ou groupes de mots répétés tels quels accentuent le doute et renforcent la certitude du même coup. Exister n’est que quasiment se raconter existant, et le non-sens de la fin de l’histoire n’est quasiment et tristement que le seul sens du récit, et ce texte n’a tristement pas les moyens de sa propre finalité.
La conscience comme élément fondamental de l’être et d’être, le point de départ de toute fiction, de toute représentation, de toute vision du monde, elle raconte et se raconte dans la vérité de l’être et de son mensonge. A partir de n’importe quel point de départ, la conscience peut se forger une finalité provisoire, un sens atteint qui ne tient pas :subjectivité en est le nom et le processus. L’obstacle à la visibilité, à la lisibilité du monde, c’est moi : l’indépassable, le trou noir aussi bien que sa lumière.
Tout est pourri par l’arbitraire. N’est-ce pas atteindre aux limites de l’écriture qui n’est peut-être que naïveté et masque portés aux limites de la volonté d’exister et de faire éclore à reculons l’invraisemblable : la mort différée, la mort hors conscience, dernière traînée de brume à la lumière d’automne. Mort qui n’est qu’une anticipation. Stéphane Sangral analyse nos pauvres conditions humaines : la mort, le néant, la conscience, le rapport avec soi et la vie, le rapport avec les autres dans son flot de mouvements, de paroles, de répétitions et d’amplifications, un manège qui n’en finit pas de tourner où l’on repasse par les mêmes points dans des cercles toujours plus larges à ne trouver aucune sortie. Ouvrir les yeux sans concession sur notre condition que l’on occulte parfois en confondant la vie et sa vie conduit à une révolte, colère brassée au fond de nous dans son impertinence et sa forme, sa force de majesté surgie au bout de la conscience dans son ressassement. Mort qui se dissimule derrière la phrase, derrière le texte, derrière le blanc à son impossible échappée, quels que soient les angles de prises de vues. Ce parler, il ne s’agit pas de l’abolir mais de lui rendre une épaisseur et le renforcer dans sa présence-absence, en faire une seule idée, obsession de l’éternité. Peut-être, tout cela, n’est-il qu’un jeu de l’esprit, le simple plaisir de durer et que cela prenne sens. Propos obsédants et libérateurs à la fois enfuis dans des textes protecteurs qui jouent leur rôle : être des illusions.
Dans ce petit aperçu d’un monde sans fin bien que fini, alors écrire… pour conjurer la mort ou continuer d’en parler par écrit, d’y mettre une distance et une solitude à postposer vers les autres. Ces idées sur la mort sont rendues présentes et détruites à la fin pour renaître et ainsi de suite. Un oubli qui ne s’oublie pas, une présence qui crée l’oubli, un oubli qui crée le présent. Est-ce pour s’y perdre : Tout être conscient est fait d’une mortelle immortalité. Recueil qui n’est pas mortifère mais tente l’espoir ou tout au moins l’espérance. Le drame est cette confrontation des contraires qui ne peuvent se résoudre. La pensée est clairvoyante dans les deux cas qui ne peuvent se confondre et restent séparés à tout jamais. « La vie ne vaut rien puisqu’il y a la mort » est aussi vrai que « la vie est infiniment précieuse puisqu’il y a la mort ». Ce ne sont que des évidences indépassables et même de bon sens commun où la pensée aussi forte soit-elle est insuffisante. Nous subissons jusqu’au terme et le point final ne sera même pas une clôture, mais le début d’un retour à rien, à de la matière incorporée.
Ce recueil n’est pas une anti poésie, mais une poésie autre qui lui associe la philosophie en tant que celle-ci n’est pas d’aller d’un point vers un autre dans une démonstration, mais dans une évidence qui n’est pas la ligne droite, mais la courbe et puis le cercle. C’est donc bien d’une invention qu’il s’agit, d’un acte poétique.
L’usage de signes typographiques particuliers et différents accentue parfois la pensée, en modifie des facettes, en accroît l’intensité, la dirige ailleurs vers un non-dit parfois suggéré. Les mots sont aussi utilisés comme des clefs musicales, ce qui comme les notes en modifient le nom et la sonorité. Le texte devient l’entièreté de ce qu’il exprime et la chose contenue est ainsi mise à distance en guise de conclusion ou d’impossibilité à en dire plus marquant ainsi un arrêt qui ne s’arrête pas. Parfois la chose concrète devient une abstraction ou vice-versa. Malgré tous ces appels, nous restons dans une contradiction invivable qui conduit à la solitude comme passer de quelque chose à rien. Il s’agit inlassablement de trouver un sens à la vie, sans fléchir, répétition après répétition par des idées contradictoires qui se cherchent dans des mouvements différents qui se reprennent, tournent en rond jusqu’au silence ou jusqu’à une autre parole. Forme et fond sont uns. Bégayements, quelquefois qui assurent la pérennité de la pensée incluant la chose l’impasse à ramener le sujet à sa triste condition d’objet déclinée en plusieurs versions. Mots tournés dans tous les sens dont il ne restera rien. Je reste en face de Je l’étranger.
Toutes les pensées sont bonnes pour sortir de notre condition ou plutôt de l’idée que l’on s’en fait, pour donner du sens à ce qui n’en a pas.
Qu’est-ce que le Je ? : Septante réponses orphelines à cette question. Réponses en fragments.
Paroles qui parlent et se parlent dans un exil dont nous sommes exclus. Paroles qui perdent tous sens utilitaires vers une communication qui disparaît, paroles qui ne brillent que par elles-mêmes. Elles deviennent rythmes, issues du rythme, elles deviennent événements, ouvertures, surgissements d’un monde achevé dans son inachèvement. Le signifiant prend le pas sur le signifié et l’abolit par exclusion. La force répétitive des paroles n’apporte rien. Ce n’est pas un jeu de langage mais une recherche de sens dans un labyrinthe encombré : Je ne suis que l’idée de « je suis »,
Une fracture ouverte et malgré la recherche tous azimuts, il n’y a que de l’inapaisement.
Etre de naître pas à pas……. Etre ? de n’être pas.
L’auteur signale qu’il lui est parfois impossible de trouver : le point final de ce texte. La décomposition de la phrase en rupture avec la logique grammaticale imposée aboutit aussi à une question sans réponse, question de trop, peut-être, mal venue. Sens et contre-sens font sens en ne s’appuyant sur rien…posées sur rien. Il ne nous reste qu’un rythme scandé, quelquefois, d’assonance en assonance, de mots aux mêmes mots, de phrases aux mêmes phrases, de blanc au même blanc. Rythme qui soutiendrait une espèce de danse de l’esprit, une virtualité : et l’absurde, ici et maintenant, m’est presque tout.
Recueil difficile à cerner qui échappe sans cesse car on croit le saisir et puis tout retombe comme si rien n’avait été dit, comme si tout avait été dit. Cette recherche de sens dans la vie comme impossibilité offre quand même de la présence : Je ne sais pas si je suis mais, par cette phrase imprimée là, au moins, j’aurai été. Recherche qui passe par l’écrit pour ressortir vite son esprit à la surface : supportable, alors. Mais à d’autres instants : Et ce texte ne vient rien dire. Recherche de soi qui inlassablement passe par la perte et les retrouvailles, la perte et les retrouvailles, ….. la ….. vailles . (Petit pastiche)
Recherche de soi par la dislocation de la pensée qui se resserre comme un éclat qui réintègre son centre, après de multiples tentatives à travers le prisme d’un texte où certains mots échangent leur sens comme la couleur du kaléidoscope, espèce de tourbillon dont on espère la sortie de quelque chose. Rien,écrit vain, retour à soi, à rien. Le carillon des mots aura sonné l’absence reportée toujours plus loin, lent entendement de la situation du je soumis à sa propre échappée partout, nulle part au fond d’un texte qui ne le libère de rien. Tout est vrai et faux à la fois qui passe par l’écriture comme seule réalité du Néant, parole aux deux bouts perdue, pendue.
Tout un recueil pour dire l’évidence, l’essentiel en une petite phrase : Etre c’est être la révolte d’une impossibilité ;
N’allons-nous pas cogner répétitivement contre la même vitre du néant/Néant du non-sens, le rien, particulièrement quand le texte écrit en italique laisse supposer qu’il est repris chez quelqu’un d’autre. Texte à voix double parfois dont la phrase interrompue laisse le possible d’une ouverture, d’un changement, d’autre chose. Voix double qui contient l’autre en éveil, petit espoir : N’être rien, ou presque, désespérément …où cependant tout se résume à cette question : à quoi bon car tout n’est que pensée, vue de l’esprit même à partir de l’évidence et conduit à dire : tout n’est pas noyé. Le lecteur passe par des phases d’acceptation, de refus où néanmoins on construit l’édifice de sa respiration.Il y a une volonté à vouloir vivre : conceptualiser le fait que j’ai tout ce que je suis et qu’après tout, toute pensée n’est jamais rien qui peut se dépasser pour entrer dans l’apaisement et cesser d’écrire. Poser les bonnes questions n’élude rien quand on sait par avance qu’il n’y a pas de réponse. Recueil où la lecture s’étouffe, ressentie jusqu’au profond du corps, sa nullité, descendre au plus bas de soi est déjà vouloir remonter. Recueil salutaire : je cherche frénétiquement mon être où autrui intervient comme miroir ou comme preuve. La non-existence est un lieu géométrique :
la parallèle, le désespoir.
C’est étrange d’être.
Et d’être seul.
Affirmation, constatation, point zéro, accalmie même provisoire, tout cela serait-il une base suffisante pour retrouver le je de la solidité qui poserait le doute comme une certitude, un acquis, une densification qui conduirait à une conceptualisation de mon être, une forme de disparition dans la présence. Richesse impénétrable dont le lecteur n’aborde que le pourtour, forêt vierge mentale où l’auteur lui-même peine à pénétrer, entre et ressort, comme s’il n’atteignait pas le point central d’où rayonner sur l’ensemble. Lecture heureuse par un dépassement de sa propre pensée dont le tout et un insaisissable, un flou qui s’en pénètre et contre lequel le lecteur vient buter à la recherche d’un amas causal solide. Conclusion toujours provisoire mais qui marque un pas / Je suis parce que je suis. Y aurait-il un début d’acceptation, de réponse à la question posée, de la finitude en la finitude ?
Je marche vers moi. Que suis-je ? Qui suis-je ? Je suis une contingence qui rêve d’absolu.
De plus en plus, les questions deviennent liées à l’environnement, à autre chose, aux autres, et, passe aussi l’idée que j’aurais pu être autre chose, une autre vie. Nous touchons au fortuit. Malgré les apparences, ce recueil est le domaine de la sensation sous-jacente plutôt que le développement de la pensée. Ou une pensée développée à partir de la sensation : celle d’exister qui reste une certitude au long du recueil / Etre soi au centre des contradictions. Le Qui suis-je ? Que suis-je ? se fait de plus en plus présent dans son éclaircissement, si même Etre soi, étant trop évident, est évidemment inacceptable. Le ton de certitude implique que je est bien présent malgré tout ce qui le réfute.
Que reste-t-il de l’approche du je, de sa tentative, de l’approche de l’être et de son mystère ? Pas grand-chose pour ne pas dire rien, ou une écriture : posée sur le blanc de la page, fragile, perdue, à la limite de l’inutile c’est déjà ça… Peut-être presque quelqu’un d’autre ? Peut-être presque moi ?
N’être rien et le dire n’arrange rien
tandis que se taire
aussi n’arrange rien
dans cet espace qu’aucun mot n’élargira
j’auraimarché en pure perte
à savoir qui je suis
Ce recueil, je l’aurai suivi pas à pas dans sa démarche mentale. Il ne se passera rien qu’une volonté de connaître, d’élucider le mystère, il ne restera qu’un doute, un presque… Telle est notre condition d’être pensant. Au moins restera-t-il une légèreté, une illusion : marcher sur Des dalles posées sur rien.
- Marilyne Bertoncini, L’anneau de Chillida - 9 décembre 2024
- Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe - 14 octobre 2019
- André du Bouchet, la parole libre de son mouvement - 5 novembre 2018
- Berbard Desportes, Le Cri muet - 4 septembre 2018
- Philippe Lekeuche, Poème à l’impossible - 3 juin 2018
- Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes - 5 mai 2018
- Lionel Seppoloni, La Route ordinaire - 24 octobre 2017
- Philippe Mathy, Veilleur d’instants - 19 octobre 2017
- Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien - 10 avril 2017
- Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe - 10 avril 2017
- Fabien Abrassart, Si je t’oublie - 10 avril 2017
- Fil de Lecture de Jean-Marie CORBUSIER - 7 mars 2016
- Jean-Marc Sourdillon, Jaccottet écrivant Au col de Larche - 13 septembre 2015
- Philippe Jaffeux, Autres courants - 10 mai 2015
- Philippe Jaffeux, Courants blancs - 9 novembre 2014