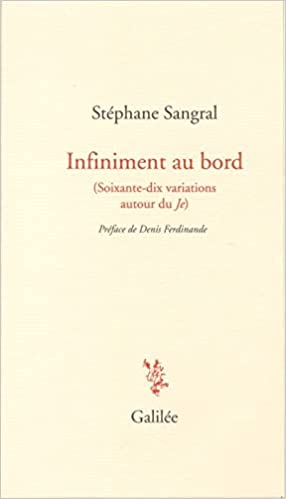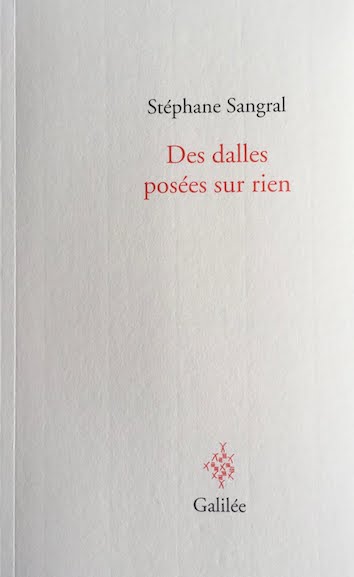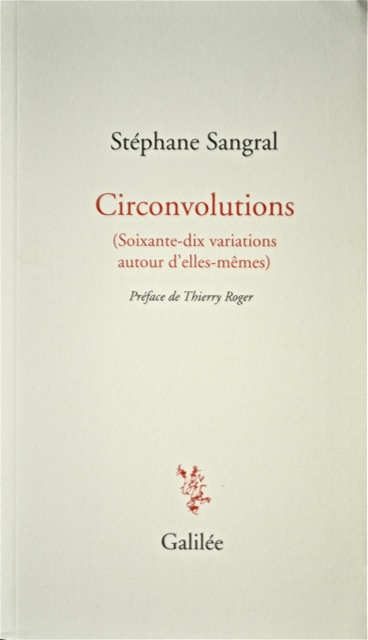Dans ce recueil à la mort présente, abondent les questions fondamentales aux impossibles réponses, qui mettent les réponses sens dessus-dessous où toute réponse, en tant que forme du poème, éclate en un saisissement aux éclats maîtrisés.
Toute pensée subit un retournement où l’espace des mots souffle par répétition comme s’il y avait refus d’entamer la réponse pour revenir au point initial, comme si l’événement se transformait en avènement. Dans cette langue qui ne joue pas avec les mots mais les fait livrer tout leur sens y compris leur contresens, Stéphane Sangral peut affirmer : … mais ma vie n’a aucun sens. En fait, le temps canalise cette vie et en même temps l’étouffe. Incessante question sans commencement ni fin qui s’origine au fond de l’être tant qu’il y a de l’être. Poèmes, dont la géométrie est une exigence structurée qui ne laisse place à aucun influx qui les déborderait. Tout est sous surveillance. Peut-être, la meilleure saisie est-elle : c’est ma pensée qui déploie ma pensée, pas moi… Les mots se décomposent et se recomposent. On passe d’une typographie aux lettres minuscules presque effacées, parfois, à de grandes lettres même en gras qui ponctuent le poème. La forme du poème, les points de vue varient pour trouver un ailleurs, hors la norme, hors les réponses communes et préfabriquées, hors les paradis artificiels…

Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe, préface de Salah Stétié, Editions Galilée, 12 Euros.
Ce recueil est une structure que la pensée anime avec ses courbes, ses lignes droites, ses labyrinthes, ses spirales qui définit une douleur mentale sans y enfermer le lecteur qui même s’il acquiesce, doit trouver sa propre porte de sortie.
Comme beaucoup, l’auteur refuse la condition de mortel : l’indépassable fait : n’être plus et dans le présent n’être pas, le réel mis en doute dans sa réalité. Entre le réel et ma réalité, il n’y a pas coïncidence mais impossibilité. Il n’y a pas de complaisance à l’égard du réel mais l’affirmation qui est d’être soi. Il nous manque peut-être une dimension terrestre : la saisie du réel en tant qu’absolu. Un dernier recours :
Je me suis exilé volontairement dans
les mots, loin du réel, pour tenter d’oublier
qu’involontairement on est exilé dans
les mots, loin du réel (à) jamais oublié…
armes de tous les vrais poètes, armes factices nous le savons. La rime, ici, nous rappelle peut-être involontairement, l’ancienneté de la chose. Parfois, il y a des tentatives de démonstration comme si enfin nous allions en sortir, trouver une ou l’explication mais tout retombe, nous tournons en rond et l’étouffement saisit. Nous sommes au-delà du temps ordinaire : 07h70 et nous ne reviendrons pas en arrière, nous sommes projetés en avant, nous sommes de l’inachèvement.Rien que des mots pour saisir une absence, un absent, cette même douleur indépassable : le temps qui s’éloigne et pousse toujours le néant en avant dans un Texte clos depuis longtemps.
La répétition, dont use hardiment Stéphane Sangral, est un espace qui s’agrandit par cercles concentriques et ouvre à autre chose qu’elle-même. On la dépasse dans ce paysage comme par exemple la nuit qui est tache de lumière et qui conduit à une transfiguration-… de mon bureau… car elle est substance, matière dans ce qu’elle a de volatile mais aussi substance souffrante.

Et cette répétition inlassable n’est peut-être que le silence de la langue qui arrive à maturité, la sienne propre dans une langue qui n’est que forme et non substance, comme le dit Ferdinand de Saussure.
Poésie criante de vérité, par ses moments vécus d’intensité et de renouvellement où le lecteur est surpris parce que c’est lui-même qui apparaît. La vie ne peut être pleinement saisie, il y a toujours un même obstacle qui s’interpose … trop lourd d’un réel pas fini. Qu’est-ce que je fous là. S’échapper serait-il possible avec le concours du monde extérieur avec cette renaissance d’un état plus heureux, tiré d’une apparence de néant : Boire ma soif jusqu’à la liberté//et me noyer de n’être//que moi, goutte dans l’océan//d’être…Dans cette mise à nu de soi qui est un dépouillement, il y a une force de libération par la négation de soi. Ce dépassement prend une forme de salut : la noyade impossible et ou la noyade possible. Duplicité de toute pensée, de tout sentiment, l’auteur affirme et nie à la fois, est-ce une façon d’épouser le monde, de le libérer de lui-même sans jamais le fixer dans une unique pensée ?
Il y a une profonde volonté, par les répétitions, point majeur de ce recueil, de progresser dans le même, le soi étant passé dans l’inépuisable désir d’être malgré tout, comme un désir d’envol : être un être, essayer et essayer encore, marque d’une densité mentale qui par coups et par à‑coups ponctue ces pages où le poème est un et à chaque fois différent. Langue torturée et parfois par hoquets qui aura rendu son essence : rien, rien en dehors d’elle ne se sera passé et pourtant dans ce sens, elle aura plaidé notre cause, notre ultime but : tenter d’y voir clair en nous quand nous nous superposons au monde même à … fouler le sens, même à nous nier : … il se nie … et Ma vie n’a aucun sens.
Le dernier poème rimé, mais il y en d’autres, répète plusieurs fois : passer son temps, le verbe est à l’infinitif, c’est-à-dire le mode où tout est possible, temps, nombre, personne, voix. Nous arrivons à passé participe passé qui clôture, qui conclut, synthèse de tout ce qui a précédé. C’est le temps qui n’appartient plus et que l’on a dépassé, comme si vivre était oublier que l’on vit, être un pas en avant de la mort, la crainte du néant enfin dépassée parce que la tête se relève.
Il y a une très belle confidence manuscrite à la page 105, qui dit qu’il n’y a ni fin ni début à ce livre : Il reste juste le temps. Juste le temps. Le lecteur naïf, voudrait poser la question : que s’est-il passé ? Mais ce temps est un appel à la vie, à notre être le plus élémentaire, à cette partie animale qui ne se pose pas de question sur l’existence : Chier reste possible, c’est-à-dire se soulager d’un excès qui ne fera pas souche.
Les parties de ce recueil sont des parties de temps de la nuit, un noir à traverser, quelque chose qui s’achève et ne s’achève pas. Ce livre nous absorbe en même temps que se lève un doute : ai-je compris et ce peu que j’en ai dit en est-il le reflet. Prenons le titre : Là où la nuit / tombe. Tombe, est-il verbe ou apposition, mouvement ou immobilité, possibilité ou impossibilité ? A chaque lecteur sa propre lecture. Ce recueil nous livre une sensibilité qui ne pratique pas la langue de bois. Il ne peut être que précieux à ceux qui exercent l’humilité de vivre et de penser.
Cette recension s’arrête, elle n’est pas achevée, ne le sera jamais.
- Marilyne Bertoncini, L’anneau de Chillida - 9 décembre 2024
- Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe - 14 octobre 2019
- André du Bouchet, la parole libre de son mouvement - 5 novembre 2018
- Berbard Desportes, Le Cri muet - 4 septembre 2018
- Philippe Lekeuche, Poème à l’impossible - 3 juin 2018
- Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes - 5 mai 2018
- Lionel Seppoloni, La Route ordinaire - 24 octobre 2017
- Philippe Mathy, Veilleur d’instants - 19 octobre 2017
- Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien - 10 avril 2017
- Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe - 10 avril 2017
- Fabien Abrassart, Si je t’oublie - 10 avril 2017
- Fil de Lecture de Jean-Marie CORBUSIER - 7 mars 2016
- Jean-Marc Sourdillon, Jaccottet écrivant Au col de Larche - 13 septembre 2015
- Philippe Jaffeux, Autres courants - 10 mai 2015
- Philippe Jaffeux, Courants blancs - 9 novembre 2014