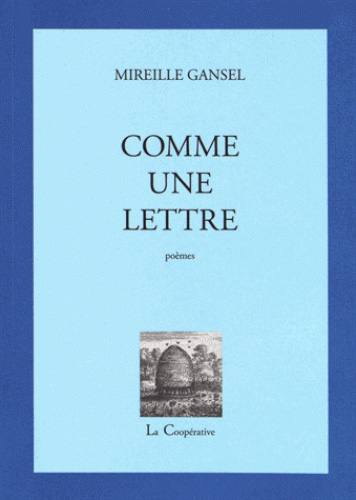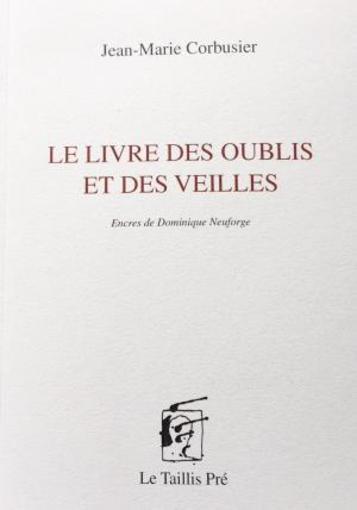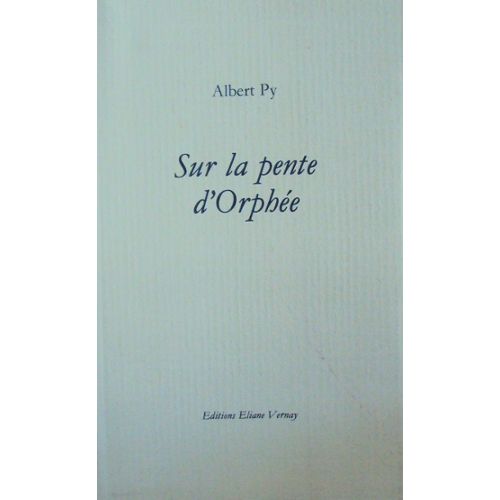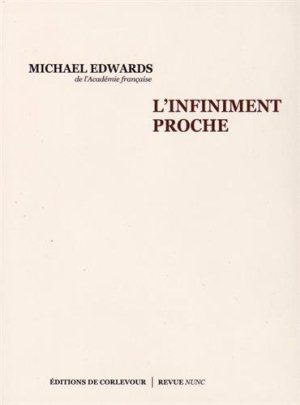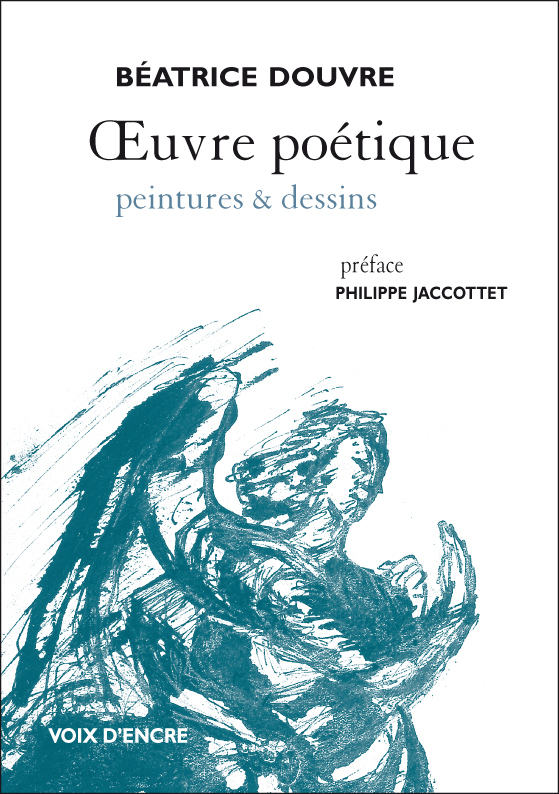Chronique du veilleur (31) – Mireille Gansel, Comme une lettre
Une liasse de lettres aux douces teintes d’aurore, fleuries, pleines de rêves et de souvenirs, d’instants glanés au hasard des rues et des paysages, c’est ce que le lecteur reçoit avec bonheur, en ce volume de poèmes de Mireille Gansel, Comme une lettre.
Et l’émerveillement suit, il répond à la fraîcheur de ces vers qui semblent pousser à la margelle d’une source discrète et mouvante, s’offrir comme « deux mains de lumière / ouvertes devant les fenêtres de la nuit. »
Le poète sait « prendre la part de lumière » qui est en toute chose et en tout être, il la recueille et nous la tend comme une coupe d’eau limpide, comme un pain fleurant bon le soleil. « La source / des choses simples » est la plus abondante et la plus pure. Elle jaillit ici à petit bruit, elle ne demande qu’à faire demeure dans le secret de notre cœur. Il suffit d’écouter :
ne passe pas ton chemin
écoute le silence des fleurs
dans le creux des heures
En ce modeste tercet, Mireille Gansel a tout dit : il faut goûter le temps, accueillir la beauté, qu’elle se tienne dans la rue Saint-Antoine, dans les hautes Alpes, au bord du Rhône ou dans la gare de Karlsruhe. Une lueur vient souvent opérer magiquement une métamorphose
et au soir
quand le soleil
brille à travers les nuages
la maison devient un vitrail
tu disais que c’est la plus belle heure
et c’était déjà au bord d’un fleuve
qui traverse des pays
en amont d’une île
aux grands arbres d’enfance
Ainsi le poème, comme la maison au bord du fleuve, s’illumine et nous invite à entrer.
Il va devenir en nous demeure secrète, familière, dont nous pourrons peut-être posséder pour notre propre vie la chaleur douce, la paix véritable :
il y a des maisons
qui sont un havreune manière de poser une pomme
sur une assiette avec un couteauquelques fleurs au bord de la nuit
offrir un verre d’eau
ne pas poser de question
franchir le seuil
ne pas être un étranger
Rares sont les livres de poésie qui permettent cette entrée aussi généreuse et apaisante dans un univers de beauté silencieuse. Celui de Mireille Gansel en fait éminemment partie et nous lui en sommes très reconnaissants.