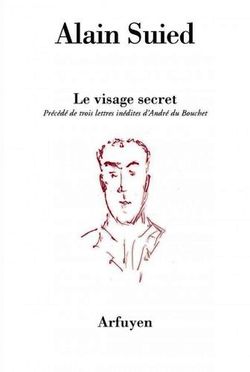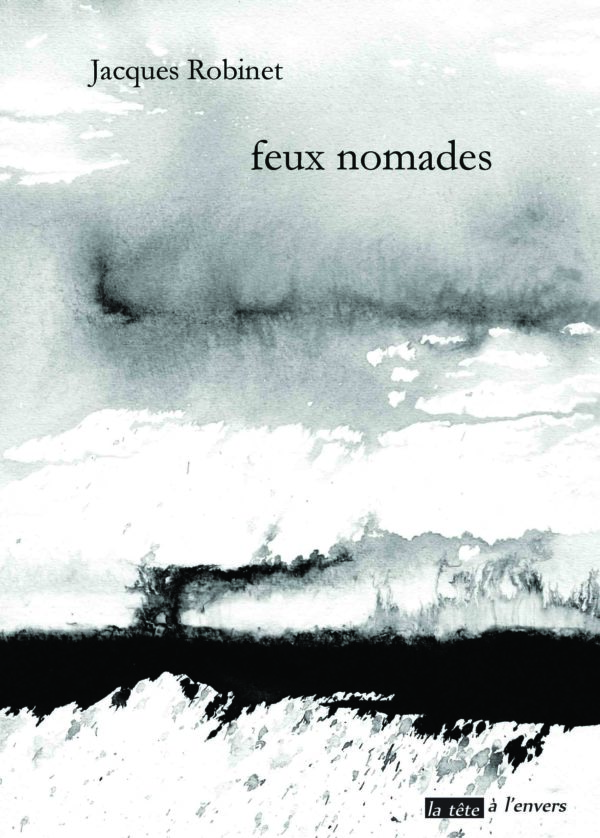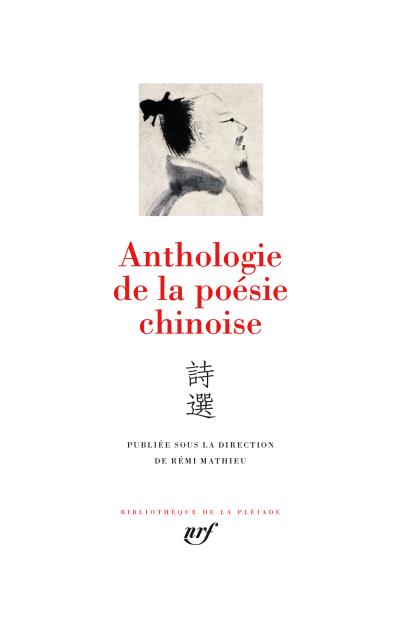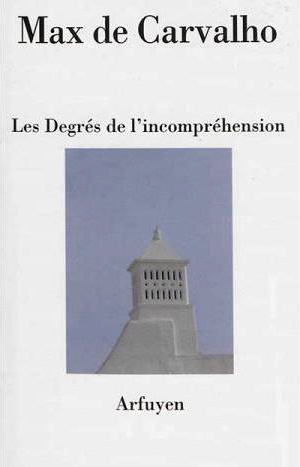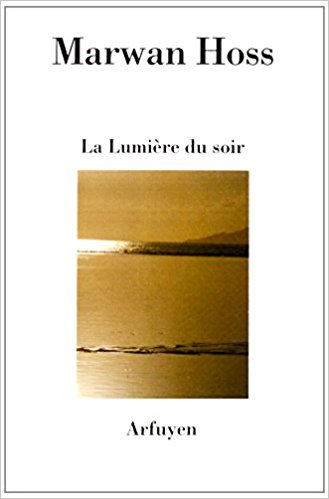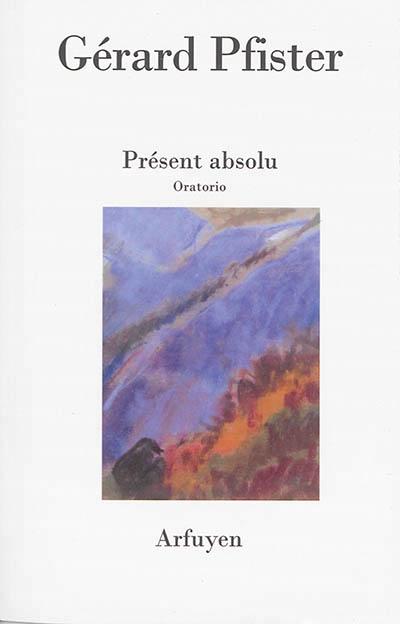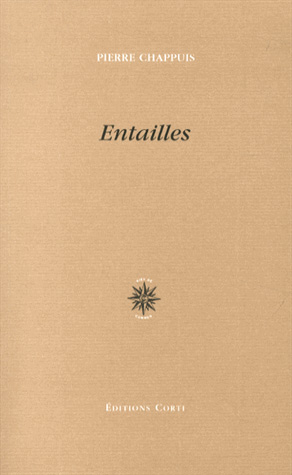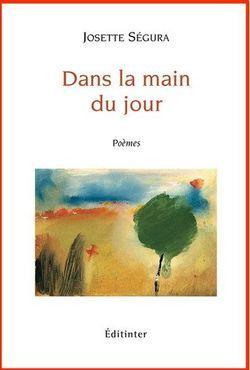Chronique du veilleur (21) – Alain Suied, Le Visage secret
L’œuvre d’Alain Suied est d’une très rare intégrité. Elle a commencé, alors qu’il n’avait que 16 ans, par un poème envoyé à André du Bouchet et publié par la revue L’Ephémère en 1968. Elle s’est poursuivie par deux livres publiés au Mercure de France, puis sa publication s’est interrompue pendant une douzaine d’années, reprise en 1985. Alain Suied, né dans l’ancienne communauté juive de Tunis, s’est trouvé déraciné à l’âge de 8 ans. Il n’a cessé durant toute sa vie, achevée en 2008 à Paris, d’interroger la vie, ses profondeurs obscures, ses origines, sa transmission. Très marqué par l’étude des grands psychanalystes contemporains, lui-même entré en analyse, il choisit les titres de ses recueils en parfait miroir de ses hantises et de ses recherches : « L’être dans la nuit du monde », « Ce qui écoute en nous », « La lumière de l’origine », « Rester humain »… Ses essais consacrés à Paul Celan et au « corps juif » ressassent d’une autre manière « la vérité de l’enracinement » et « la commune blessure de vivre et de partir. »
Le Visage secret, qui paraît chez Arfuyen, son éditeur très fidèle, qui a publié une dizaine de ses manuscrits et qui en publiera d’autres encore restés inédits, nous fait retrouver Alain Suied habité par « le mirage de l’absence » :
L’absence n’existe que pour les vivants.
Les disparus tremblent dans nos mains
leur souffle dans nos cris
leur effroi dans nos fièvres.
Nous nous tenons debout
dans la lumière du jour
pourtant c’est l’ombre
qui nous porte.
C’est toute l’aventure humaine qui circule dans ces pages, avec ses souffrances, son passé « de cris / de combats/ qui ne peut revenir ». Pourtant, le cœur de l’homme a des pouvoirs immenses et le poète peut les saisir dans ses créations, qui tiennent bon face à la poussière de l’éphémère et aux ténèbres de la mort :
ton cœur est une étoile de sang
et sa lumière secrète
brille au fond de la nuit intime.
Alain Suied parvient à donner à chaque vers, à chaque mot, un poids et une lumière qui touchent l’âme au plus profond. Il dit à la fois, dans un même poème, le « feu originel » et l’air si léger qui donne à l’existence humaine fragilité et beauté. Le tutoiement qu’il emploie souvent pour sonder son être nous appelle à le suivre dans ses paroles « de chair » :
Cette vie que tu construis
vient du non-être, de l’Impossible
elle vient du feu originel.
Mais elle repose sur un rire
d’enfant, sur le cri mourant
d’un inconnu, sur la soif d’une étoile.
De magnifiques poèmes parlent de l’enfant et de sa connaissance innée de la « douleur de la disparition », de cette intuition du « miracle familier de la présence », que le poète quelquefois partage avec lui. Le « visage secret » lui apparaît en pleine clarté, ce visage de vérité que l’homme a tant de mal à retrouver dans le tréfonds de son cœur.
Et il sait d’emblée
reconnaître l’ami et le fantôme
la fiancée du cœur
et la force maternelle.
Et il sait, dans la clarté, le nom oublié.
« Sous nos différences », un « cri unique » cherche à se faire entendre. La poésie d’Alain Suied capte ce cri, souvent assombri de ténèbres, immémorial, continu. Elle le fait avec une sincérité et une exigence incomparables.