« l’image /est bucolique et pourtant bien réelle »1 p. 28
On ne trouvera pas de nature, d’agriculture idéalisées dans ce recueil, dont l’auteur (arboriculteur de profession) écrit ses poèmes comme il éclaircit ses arbres, discernant la beauté là où elle se tient retranchée, la dégageant mais ne l’inventant pas. Ce n’est pas poésie d’exaltation, surjouant l’émotion originelle et l’amplifiant, mais plutôt recherche de la transcription juste de choses perçues dans leur potentiel expressif.
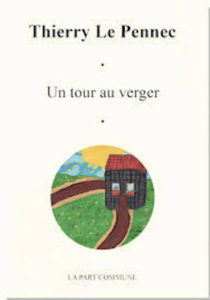
Thierry Le Pennec, Un tour au verger, La Part Commune, 2018, 90 pages, 13 €.
Un Tour au verger nous fait habiter diverses strates temporelles. Certains poèmes veulent révéler l’essence du moment présent : la cueillette des pommes se fait tandis que « D’heure en heure dans l’air immobile, et la rosée, pendent les branches », et « Ça se termine par les plus rouges là-haut, juste en dessous du soleil » (p. 84). Cet ancrage dans l’instant et le territoire ne craint pas une forme d’autocontradiction à l’ironie légère : le même poème évoque l’exportation des fruits vers la région parisienne et s’intitule étrang(èr)ement « Product of ». L’ambivalence des choses de la vie apparaît aussi dans le traitement du couple : entre érotisme et espièglerie, des ruptures de ton transcrivent ce mélange de profondeur et de légèreté, d’idéal et de pragmatisme quotidien qu’est la relation amoureuse.
D’autres poèmes sont la reconstruction d’un souvenir. Le poème « Substrat » (p. 69) dit que, comme il existe un substrat organique favorisant le développement des plantations, il y eut des observations d’enfance d’où sont nés les gestes de l’arboriculteur et avec eux une forme d’identité. Ce qui fut entendu autrefois, dit dans son entourage, « c’est moi / incarnation des présentes années / qui le dis à mon tour » (p. 9) L’aventure agricole se déroule dans « l’immense histoire en arrière en avant de soi » (p. 75), ses aléas sont un mouvement dans le mouvement, un courant dans un courant plus large. Ces poèmes ramènent le lecteur aux temporalités authentiques, qui ne se vivent que dans le monde rural ; le « xylophone » du tas de bois qu’on amasse pour dans deux ans (p. 58) joue la musique d’un temps apprivoisé, tout autre que le temps subi, possédé, rentabilisé, le temps corrompu dont nombre d’entre nous sont aujourd’hui les esclaves. Les travaux nécessaires de la campagne ont la valeur double et paradoxale des contraintes qui libèrent.
Le jeu des langues comporte aussi une dimension temporelle : le breton survivant s’articule au français, le langage passé des petits enfants alterne avec la parole élaborée du poète.
Le thème récurrent de la filiation, de la transmission, est en amont caractérisé par autre chose que les liens du sang (la « lignée » familiale de ceux qui travaillaient le métal s’est éteinte avec « le frère ciseleur », p. 10), en aval porté par les figures des enfants du poète, très souvent évoqués, notamment dans leur petite enfance aujourd’hui lointaine. Les enfants, à leur manière naïve, assistent leur père dans ses travaux, et ce faisant observent à la fois la même chose et autre chose que leur père, constituant sans le savoir leur propre « substrat » :
je le vois ma grande petite fille
reste à côté de moi cependant que je plante
un carré de choux-à-lapins dans le bas
du jardin comme à chaque printemps
elle assiste et commente
de sa langue mille fois tournée les actes
essentiels la bêche les vers de terre l’aide
qu’elle me donne. (« Jour feuille », p. 21)
On note le relai émouvant des regards du père et de la petite qu’il tient dans ses bras, tournés vers les oisillons du nid vers lequel il l’a portée (« Abraxas », p. 53).
De beaux effets de sens naissent de la relation du poème à son titre :
« viendrais-tu faire un tour sur l’étang ? »
dit-elle alors que j’étais
sur la rive délassant
mes chaussures d’une cueille nous montons
à bord du canot pneumatique elle prend
les rames c’est un rêve « que la mer vienne
à moi » gire son visage
sur fond de feuilles et de reflets nous sommes
au centre de l’immense monde sien. (p. 79)
« l’immense monde sien », presque un oxymore, dit l’infini de l’intériorité, et le titre, « Zodiac », superpose au tableau dressé par le poème l’image étoilée des représentations astrologiques (élargissement cosmique), tout en amenant la référence au canot à moteur qui parcourt les côtes océaniques aimées du personnage féminin (élargissement géographique). Ainsi, à la navigation dans le temps se superpose l’extension des lieux réels aux espaces désirés et imaginaires. Qu’on n’y voie pas une trahison de la nature réelle, mais plutôt l’expression de la conscience des échelles de temps et d’espace qui ne saurait jamais faiblir chez qui travaille sous la direction de la nature.
- Thierry Le Pennec, Un Tour au verger - 4 janvier 2019
- Refrain, de Bernard Grasset - 18 octobre 2017
Notes


