Yves Namur, Dis-moi quelque chose
Les 115 chants que nous donne à lire le Poète Yves Namur, l’une des grandes voix poétiques de la poésie belge, « Dis-moi quelque chose », suivent le cours des saisons. C’est musical, comme un ensemble incantatoire, profond comme un chemin qui nous emmène à travers les épreuves de vie, les plus ordinaires comme les plus tumultueuses : la profondeur des colères, nos tristesses et nos brûlures, Quand le ciel se fait terrible/Quand l’amour oublie/Qu’il fut roi » (chant 30), ou encore lorsque l’absence est longue (chant 18).
Il écrit Pour faire face à l’effondrement/Des murs et des montagnes (50), pour mieux respirer (14), rallumer les lampes pauvres (34) et trouver les appuis et ressources les plus essentiels.
Ces poèmes, par leur succession entêtée et inexorable, tissent le fil des insuffisances, et, dans le recueillement de l’écriture forment ensemble une marche méditative d’une lucidité vertigineuse qui cherche à pénétrer le réel, ses complexités et ses mouvements : Dis-moi quelque chose/Et nous parlerons enfin du réel/De ce que sont vraiment les oiseaux, les chevaux en pleine course/Les pierres tombées ou la pluie/Et aussi le silence des carapaces (112).
A vrai dire ces magnifiques implorations ont la puissance du désir, un désir de la présence, de se rendre présent au monde, au silence, dans la profondeur inattendue de la rencontre qui fondamentalement est celle de l’ouverture : quelque chose/Qui réveille la ruche obscure/Entrouvre portes et fenêtres (69), pour accueillir La main du passant/ses questions, ses fausses réponses (22).
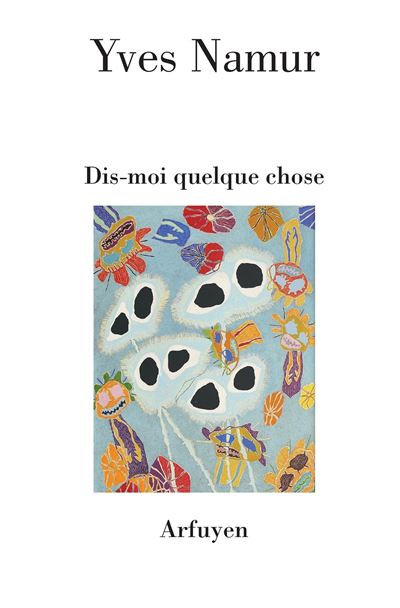
Yves Namur, Dis-moi quelque chose, Arfuyen, février 2021, 156 pages, 14 euros.
Loin de se répéter, ces fragments tracent un questionnement sur l’être au monde, autant dire sur la question de la limite et de l’errance du sens, fondamentalement de l’immense mystère de la vie. Et ce questionnement est inépuisable. Il est sans réponse finale. Il n’est pourtant pas sans but, dans le sens où il donne une réalité à la question et à celui qui la pose. Une réalité à l’attente.
Yves Namur soulève d’une manière bouleversante, sur le rythme conjuratoire des sizains, la tension du manque à être et à dire (l’impuissance de la langue à nommer), à l’endroit même où se ressource l’énergie poétique et s’accomplit le poème.
Edmond Jabès parle à ce propos du « miracle de la blessure »1, cette blessure sans cesse ravivée, qui loin de rendre l’écriture impossible en est sa source la plus pure, sa force originelle. Sa condition et son exigence ultime.
Il s’agit pour autant d’un combat intime sans repos, qui ressort ici comme une relation éveillée avec ce qui ne se laisse pas posséder. Il s’agit d’une tâche quasi spirituelle qui passe par le dénuement, revendique la simplicité, Cette chose si difficile à saisir/Si troublante à regarder (73), au vif des irrémédiables chutes vers l’en-bas du doute et de l’ignorance chers au poète, qu’il conçoit pour lui-même comme « des lignes de conduite »2 :
Dis-moi quelque chose
Et tu m’aiderais à ne pas savoirA ne rien comprendre à la pluie
Aux nuages bas aux abeilles noires
Et aux cendres tombéesOui ne rien savoir ou presque (29)
Yves Namur nous dit que l’œuvre poétique n’a pas d’autres raisons, pas d’autres objets que ce dénuement, que la libération des contraintes inutiles, des piètres agitations, des agrippements et de tous ces « trop » encombrants qui se voudraient garants de la plénitude, pourtant plus aveuglants que le vide lui-même. Dis-moi quelque chose/De l’ordre du peu du simple/Ou de l’invisible/mais quelque chose qui éclaire (47). Même si cela ne sert peut-être à rien si ce n’est à vivre, Et que la nuit danse de plus belle (56).
C’est par la voie d’un certain dessaisissement que se redresse l’être, que s’ouvre l’espace d’Une phrase légère/Ou même (d’)un mot ordinaire (70), un mot presque apeuré que le poète tente d’approcher, Qui à lui seul pourrait ouvrir/Le silence les regards noueux/Et les portes de la fragilité (64). Un mot délicat et si fragile/Qu’on se demanderait /S’il faut vraiment le prononcer/Ou simplement le regarder (110). Cette voie laisse venir le poème inattendu (51) et entrevoir ce qui sera (87).
C’est bien parce qu’elle est concise et nue comme le frémissement de la feuille, aérée comme un rêve, que la poésie d’Yves Namur fait tomber les mots dans leur plus grande justesse, qu’elle dit l’essentiel et ne cesse de rouvrir l’immortelle question dans une dignité poétique rare : Pourquoi l’homme est-il ainsi/Avide et criblé de trous (93). A être posée, la question fait retour vers la source poétique et tient le poème entrouvert.
Dis-moi quelque chose
Qui comblerait le manqueFerait de nos yeux vides
Une forêt de cœurs orageux
Une pluie étoiléeUn poème entrouvert (1)
La retenue verbale redonne force aux mots, décuple la densité du sens, les fait éclore dans une sensibilité particulière, où peut se lire ce qui se trame entre la chose, l’idée et le mot. Yves Namur est, écrit Paul Farellier, « l’un de ceux qui font passer le plus de vérité d’entre les mots et les lignes » (Revue Phoenix, 32, 43-45), mais aussi vers l’autre. Car la force de ce long poème est de s’écrire pour être entendu depuis le bas/Jusqu’au sommet de toutes questions/de toutes attentes (85) jamais comblées. Il s’écrit pour lancer un appel à un autre, un être, inconnu et/ou lecteur, et partager avec lui ce quelque chose dont l’homme puisse se couvrir (91). Sans doute est-ce un positionnement poétique essentiel, celui de l’homme, du poète et du penseur (et sans aucun doute du médecin), d’où jaillit un peu de clarté sur les horizons lointains qui n’en finissent pas de nous séparer de nous-même, de Nous enlever à nous même (101) : l’infini, l’indéfinissable, l’inévitable et l’heure ultime (52).
La poésie d’Yves Namur murmure, ne force pas la voix, ne rumine pas l’amertume. Mais elle laisse venir en une pensée rêvante errante, ce léger tremblement qu’on devine/Lorsque le matin s’invite (8). Elle s’inspire du souffle odorant qui sort des choses, circule entre elles, qui a le goût du fruit mur, et de l’eau claire, et ce grand pouvoir de creuser l’humain jusqu'au centre de Nulle Part/là où va le coeur obscur/et le poème nu qui n'en finit pas/de venir à toi, à moi, en nous comme il l’écrivait avec tellement d’intensité dans Creuse-nous.
Son écriture est singulière, vivante. En parcourant le monde de l’humain, elle en désigne les forces noires, les fuites et Ouvertures. Une écriture qui va dans les profondeurs de l’obscur et vole comme l’oiseau d’un poème à l’autre, vers ce retour perpétuel de la lumière.
Le sens se glisse dans le flux et le lent recommencement des cycles de l’existence, se lie à la substance du monde, aux éléments qui nous perpétuent et nous veillent, ainsi la feuille, le merle, la pluie et l’ombre, qui font le corps et lui donnent ses plus belles vibrations, comme des sensations présentes à l’intérieur de soi.
Dans la continuité des précédents, ce recueil est à considérer comme une réflexion poétique sur la poésie. Il est parole, parole pleine de l’éveil (72) et de la promesse qui ne cesse d’abreuver (et de s’abreuver à) ce mot qu’on n’emporte pas/Qu’on laisse en jachère/Sur le bord du chemin (55), un mot comme amour (71), comme lumière, dans lequel il faut avoir foi pour tenir indissociablement l’engagement de l’écriture et la tâche du vivre, de Ce qui reste à accomplir (37).
Dis-moi quelque chose
On l’accueillera avec ferveurOn le regardera
Comme un cristal très pur
Comme un ciel étoiléÉclatant de promesses (102)
Notes
1. Voir l’entretien avec Teric Boucebci dans le numéro 32 de Phoenix consacré son oeuvre. p. 12.
2. Ibid., p. 16.
