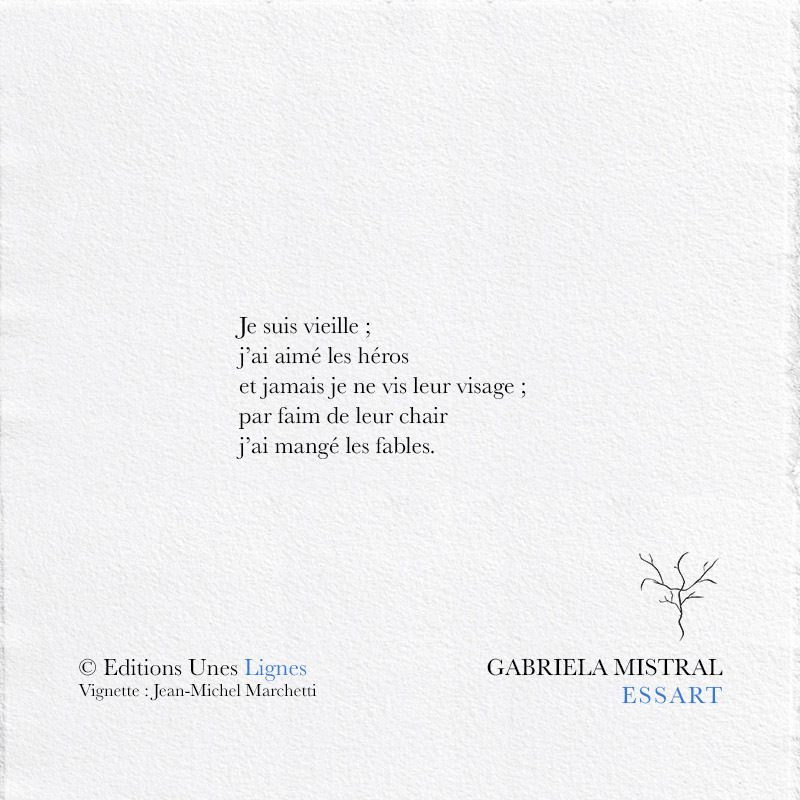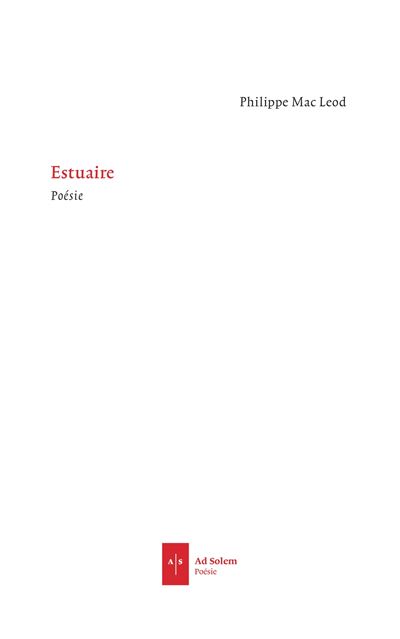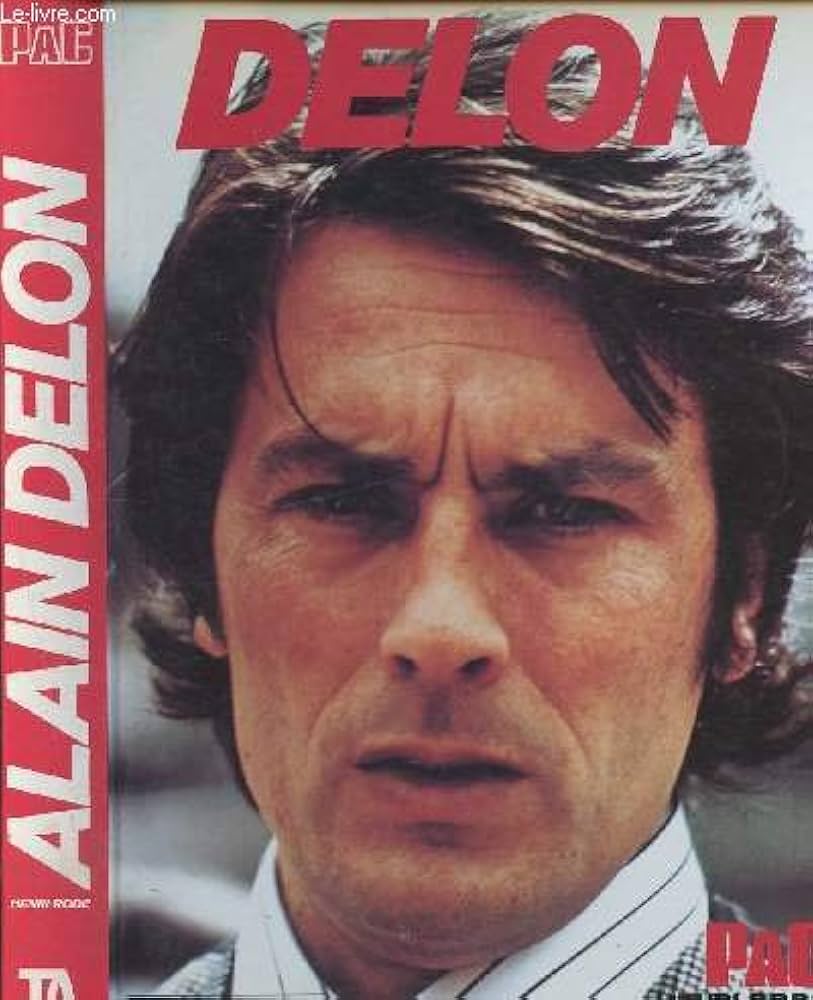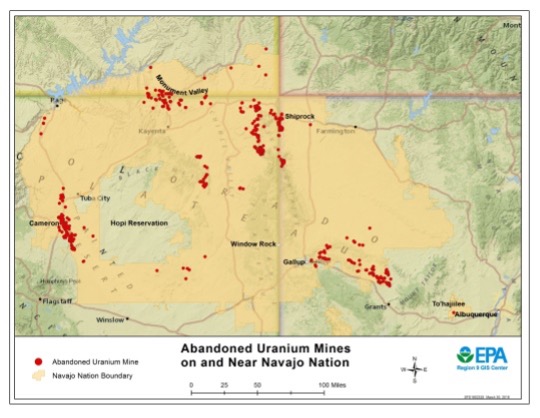Autour des éditions Alidades : José Ángel Leyva et Filippo De Pisis
Filippo De Pisis, Mais un peu de ta grâce
Les éditions alidades possèdent une collection bilingue qui permet de découvrir un auteur dans sa langue maternelle accompagnée d'une traduction, ici de l'italien par Franck Berger. De Pisis (Ferrare 1896 – Milan 1956) était poète et peintre. S'il obtint moins de notoriété avec sa poésie qu'avec sa peinture — elle représentait l'avant-garde de son époque — il fait néanmoins partie de ces auteurs importants, méconnus, qu'il est opportun de (re)découvrir, d'autant que sa vocation littéraire naquit avant sa vocation picturale et qu'il ne s'en départira jamais.
Édité en Italie par les plus grands, il n'a que très rarement été traduit en France où son œuvre demeure confidentielle, la dernière publication remontant à 1983 dans une traduction d'André Pieyre de Mandiargues. Dans la préface à la réédition de ses Poesie (Garzanti, 2003), Giovanni Raboni affirme : « une tendance psychologique, je dirais, plus encore que culturelle, à la clarté et à la limpidité ; l'adoption d'une forme tout à la fois retenue, et aux accents vibrants et chantants : voilà les traits, si l'on fait le compte, de De Pisis poète. »
L'ANGELOT
La messe dominicale :
mari et femme debout,
devant deux prie-Dieu de paille,
un peu perdus ;
elle, une petite brune, pâle,
lui un jeune employé
qui mène sa barque ;
mais sommeillant sur son épaule
la tête très frêle
d'un angelot blond.
Il a le bras tendu et sa main retombe
comme une fleur rare.
On sent presque jusqu'ici
le souffle léger
de la créature sommeillant.
Les chants maladroits
qui pleuvent de la haute tribune
sont là pour bercer son repos.
Le parfum de l'encens est là pour lui,
lui seul regarde
une rose mourante sur un autel.
— Soudain, à l'insu de tous,
descend pour veiller sur son sommeil
son ange-gardien
d'or tout entier fait.

Filippo De Pisis, Mais un peu de ta grâce / Ma un po' della tua grazia, éditions alidades, 2023, 44 pages, 6 €.
On pourrait rapprocher de Pisis de Sandro Penna, de dix ans son cadet, dans ces associations récurrentes chez l'un et l'autre de la joie et de la tristesse. De Pisis lui dédie d'ailleurs un poème :
FLEUR POURPRE
À Sandro PennaDans la chaleur pesante de l'après-midi d'été
unique consolation et miel
fleur pourpre
secret pathétique
au nom bucolique
Amaryllis.
[…] Ce peu de force qui me reste, vois,
je t'en fais don, noble fleur,
et assis à tes côtés,
j'attends des merveilles inouïes,
incorrigible que je suis.
Toujours chez De Pisis (comme chez Penna) le beau et l'agréable sont liés au tragique, jusques et y compris dans l'affirmation sans ambiguïté et sans tapage de leur homosexualité.
DÉPART
Dans le petit torpilleur
un marin à demi-nu,
maigre et suave s'éloigne du port,
assis dans une pose de philosophe antique.
— Et il emporte un peu de mon cœur.
Ce sont de petites touches délicates, comme dans le poème CHASSEURS :
Ils portent un fusil en bandoulière.
Dans la lumière de la lune
brillent les canons
— et aussi les épaules nues
d'un doux adolescent
que le plus âgé porte à califourchon sur le guidon.
Pour donner envie de découvrir ce beau livret, je dirai avec De Pisis, dans sa préface à l'édition de 1942 :
J'aime à croire […] que le lecteur attentif puisse trouver dans ce recueil, en quelque sorte, « l'histoire d'une âme », laquelle âme est faite, comme on sait, de rien, mais peut avoir un parfum d'éternité.
∗∗∗
José Ángel Leyva, LES TROIS QUARTS / TRES CUARTAS PARTES
Voilà une quarantaine d'années que les éditions alidades nous offrent des livres et notamment la collection bilingues qui rend accessibles aux lecteurs les textes de poètes de langues allemande, anglaise, arabe, espagnole, italienne, japonaise, russe et tchèque. Dernière parution : LES TROIS QUARTS / TRES CUARTAS PARTES du Mexicain José Ángel Leyva, traduit par Cathy Fourez et Jean Portante. L'auteur, quant à lui, est très reconnu dans son pays, par ses œuvres (poésie, nouvelles, chroniques littéraires...), également comme éditeur, journaliste et promoteur culturel. Ce recueil donnera une bonne idée de l'écriture de José Ángel Leyva pour qui, comme le confia un jour Éluard, la poésie doit être ininterrompue.
LA CHIENNE
Est venue la chienne te lécher les chaussures
Elle ronronne et se met à jouer pattes en l'air
Elle attend que tu la grattouilles et la caresses avec la semelle
L'animal manque de mémoire n'a pas de dignité
L'humiliation semble être le fondement de son espèce
tu t'informes en rage et ne peux éviter la répugnanceHier avec d'autres enfants tu l'as vue poursuivie et montée par les chiens
Eux ont alors décidé de la punir par dégoût ou pour s'affirmer
L'enseignement du maître ou de qui apprend à soumettre le faible
passait par la force et le jeu malin des juges
Ils l'ont suspendue par les pattes arrière à une poutre
Piñata hurlant de douleur entre les rires et les cris des garçons
Ils la secouaient à coups de bâton et s'amusaient à lui tourmenter
[ l'anus et le vagin
La douleur d'autrui est imperméable aux questions
Ce sont des temps de guerre pensais-tu alors que montait en toi
une pulsion de pitié ou de conscience
Tu as donc décidé de freiner le jeuCela fait des années que l'image de la chienne te poursuit
Elle est fidèle à ta douleur et à sa torture
Chaque matin elle est là sur le pas de ta porte
Dans son regard aveugle ce sont les mêmes yeux
qui depuis l'enfance demandent pourquoi
Les poèmes s'entachent du réel, comme aimait à le dire très justement l'auteur : ainsi de cette cruelle anecdote relatée ici, imprégnée d'un sentiment souterrain, s'ouvrant vers des abîmes.
Le titre du recueil — qui est aussi celui d'un poème — est une allusion à la part d'eau constituant le corps humain (en réalité, c'est moins : plutôt 65 %) et c'est le prétexte pour un flirt métaphysique : Une poignée de terre n'est pas un homme (référence au livre de la Genèse) / Les trois quarts font du rêve la substance et le poème teinté de transcendance se raccroche néanmoins au réel (et à la déréliction) dans sa conclusion : Du temps il y en a et de la soif pour attendre la mort / sous l'arbre sans feuilles qui jette de l'ombre / L'absence de dieu chasse la peur / Le père et le fils stimulent la synapse / qui laisse voir leur commune solitude sous les ponts / les trois quarts liquides de l'homme
Ces trois quarts évoquent inévitablement une incomplétude, le quart manquant, amenant le poète à douter de sa propre identité.
MIROIR
Étranges les poches des paupières
Les lignes intriguent sur le front
Il m'observe
avec des yeux de verre de stupeur de mort
Que répondre à un inconnu
la tête embrouillée par les nuits
Le miroir se remplit de petits points
s'assombrit
S'en vont l'image et la couleur
Je me dilue dans des ombres capables d'ignorer
les certitudes d'un moi qui n'est pas le mien
Je suis encadré dans l'écran
J'ignore la langue familière
Reflets de cette langue obscène de mon silence
C'est le même nez
Profondes entrées sur le front
Petites oreilles et cheveux noirs
les yeux sombres le teint la forme du visage
Je ne peux cependant pas attester
que derrière les épaules
il y a un dos dans le vide
Le poète est également voyageur, il n'en retire pas un bouquet d'images pittoresques ; toujours une question essentielle est posée, comme dans SON PRÉNOM EST BAGDAD : — Les bombes éteignent-elles la couleur du soleil / ou ôtent-elles l'ombre aux gens ? — / Me demande l'enfant de sa voix de sage
Il est attentif à l'Humanité, toute l'Humanité, comme dans ce poème qui dépeint en une merveilleuse parabole l'apprentissage du langage par un jeune enfant.
ÁNDER (QUATRE ANS)
Tout
est le mot qui fait le tour de ses mains
Tout
marche dans l'horloge biologique du jeu et de la question
Il pousse dans la maison sa petite boule d'éponge en solitude
absorbé il lui fait monter l'escalier
marche après marche
Il descend et condescend jusqu'à dormir sans elle
Il bouge ses yeux affamés autour du jour
Il ne sait rien des ignorances
Il recommence son travail de scarabée dans le langage
De nuit il en colle les parties avec sa salive
Il se replace derrière la balle
Parmi les résidus de langues et de signaux grandit
son objet verbal
le tour inutile de l'horloge que ses petites mains
retardent remontent avancent désordonnent
Le mot tout commence son tour
son vide
De cette Humanité, aussi bien il s'attache à une commère : Assoiffée dans du miel de figue et de plaisirs / Dense arôme de sueur et de larmes / Enlaçant l'encadrement de la porte […] suspendue à la nuit / elle se berce dans la canicule
Avec ce recueil, c'est un magnifique ensemble choral qui se donne au lecteur ; mêlant l'apparente anecdote à la réflexion philosophique, sans s’appesantir, il touche sans conteste à l'universel.

José Ángel Leyva, LES TROIS QUARTS / TRES CUARTAS PARTES, éditions alidades, 2024, 64 pages, 7 €.